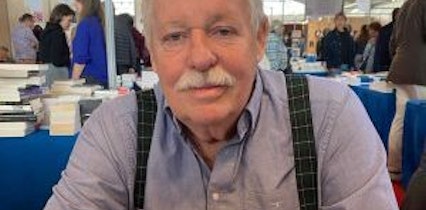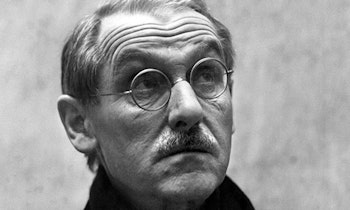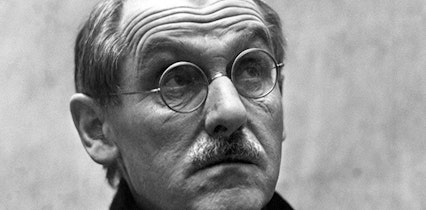Présenté dans la section Un Certain Regard lors du dernier festival de Cannes, Godland, le troisième long-métrage de l’islandais Hlynur Palmason, revient aux fondamentaux d’un certain cinéma nordique, où la religion et la nature confrontent les hommes à leur incapacité à cohabiter.

Impossible de ne pas penser à Carl Theodor Dreyer dans les premiers plans dépouillés du film montrant des hommes d’église. Le réalisateur pionnier d’un cinéma d’Europe du Nord à l’esthétique glaciale est connu pour la représentation allégorique d’une religion toute puissante. Deux hommes conversent autour d’une table, et, de Jour de Colère au Septième Sceau de Bergman, c’est tout un imaginaire qui se trouve convoqué : chasse aux sorcières, longs manteaux noirs, et surtout une langue, le danois et ses sonorités gutturales qui apporte à la séquence une certaine gravité. Pourtant, derrière cette introduction référencée, si Hlynur Palmason tient à ce point à venir se confronter à une histoire du cinéma illustre, c’est bien pour s’en détacher et présenter le plus rapidement possible les tenants de son intrigue. Un prêtre est envoyé en Islande pour y faire bâtir une église.
La voie de l’eau
Plein de bonnes intentions, le prêtre est aussi d’une naïveté confondante. Alors que l’église doit être construite sur la côte, il accoste de l’autre côté de l’île et préfère traverser le pays à cheval pour donner à sa mission l’allure d’un chemin de croix. Il se rendra bien vite compte que les obstacles qui se dressent devant lui ne sont pas d’ordre spirituel, mais matériel. Pour entreprendre ce voyage, Lucas sera guidé par Ragnar, son parfait contraire. Outre la barrière des langues ainsi que celle des corps, Ragnar et Lucas s’opposent dans la manière de concevoir leur vie. L’un découvrira que la nature ne peut être domptée, l’autre que l’adoration de Dieu requiert bien plus qu’une simple prière. La première partie de Godland est brillante. Avant de traiter de la religion et de sa confrontation directe avec la cruelle matérialité de notre monde, le film s’attarde sur une époque. De l’outil photographique, ramené par Lucas pour conserver une trace de son odyssée, jusqu’aux gestes les plus quotidiens (la découpe d’un mouton), la vie ordinaire est scrutée dans ses moindres détails.
Ce mode de représentation du monde est pertinent dans la mesure où il rappelle constamment, par l’outil cinématographique, le caractère sublime de la nature.
Le cadre particulier de Palmason, photogramme aux bords arrondis, qui ravive à notre mémoire la beauté troublante du western contemplatif Jauja de Lisandro Alonso, donne la curieuse impression de pouvoir traverser l’écran de cinéma. Sa recherche constante de profondeur accompagne la netteté infinie du cadre (on pense notamment aux scènes d’intérieur de la peinture flamande) et déploie les somptueux décors islandais en trois dimensions. La caméra devient un personnage tangible, comme en témoigne cette scène sur le navire où cette dernière tangue au même rythme que les vagues, déstabilisant aussi bien son héros que son audience. Ce mode de représentation du monde est pertinent dans la mesure où il rappelle constamment, par l’outil cinématographique, le caractère sublime de la nature. Le réalisateur n’enferme pas l’Islande dans une imagerie resplendissante digne du National Geographic, mais suggère plutôt sa beauté meurtrière. Le moindre cours d’eau, la moindre escalade peuvent provoquer la mort. De la plus verte des vallées au plus immaculé des glaciers, ce chemin de croix n’est en réalité que l’expression de la volonté de la Terre elle-même, élevée au rang de divinité. C’est elle qui décide vraiment du destin des hommes qui se fourvoient depuis toujours en croyant pouvoir la coloniser. Dans cette perte totale de repères spatio-temporels, il ne reste que le mouvement des éléments. L’air fouettant le visage gelé des personnages et surtout l’eau qui semble dicter les mouvements de la caméra, faisant ainsi plonger le film dans l’abstraction lors d’un magnifique plan ou la caméra semble glisser le long d’une cascade.
Image fantôme
C’est alors que le film change brusquement de registre. La mort rôde comme une menace à chaque bord de cadre et emporte finalement notre héros. Le film semble alors s’échapper du fil de l’eau et amorce un long panoramique à 360 degrés, à la fin duquel survient une étrange réincarnation. C’est la puissance de l’image, du cinéma comme des photos de Lucas que de capturer et d’immortaliser le réel pour nous rappeler les toutes premières sensations que suscitent un photogramme après avoir emprisonné un être fantomatique entre la vie et la mort. Tandis que la caméra de Palmason regarde, à l’instar de Werner Herzog dans La Soufrière, la puissance déchaînée de la nature qui prend la forme d’un volcan grondant, on s’imagine transporté dans un nouveau film qui aurait complètement délaissé les humains. Au détour d’un fulgurant raccord, Dreyer revient à la charge, puisque Lucas et ses pairs se retrouvent au point d’arrivée, dans cette ferme censée abriter la nouvelle église de la région. Le poids du film Ordet se fait sentir : disparition du mouvement (de la caméra et des personnages), sombre évocation d’un retour à la vie, la religion et le désir dérangent les âmes. Cette seconde partie est certes une réussite mais elle fait parfois pâle figure à côté du choc abrupt qui la précède. Exit la nature. Le prêtre, désabusé par son parcours, se retrouve plongé dans une vie communautaire troublante dans laquelle une explosion de violence semble pouvoir surgir de n’importe quelle interaction. C’est peut-être là que se trouve le véritable chemin de croix, dans l’acceptation de l’autre et de nos divergences, dans notre résistance à la tentation et aux pulsions de mort.
La fin du film est déchirée entre le pessimisme d’une impossibilité à vivre ensemble et la promesse d’une union éternelle avec la nature. Cette terre de Dieu, où se confrontent matière et spiritualité, nous rappelle la fin inéluctable de tout homme: redevenir poussière.
Godland, réalisé par Hlynur Palmason, avec Elliott Crosset Hove, Ingvar Eggert Sigurôsson et Victoria Carmen Sonne, en salles le 21 décembre.