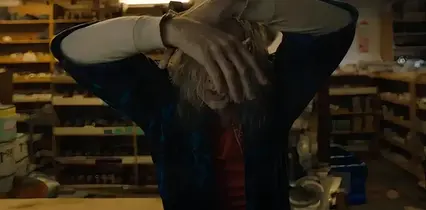Est-il une affection psychologique plus fameuse et méconnue que la « dépression » ? Les Editions Amsterdam publient la traduction d’une récente histoire de cette illustre inconnue : un ouvrage accessible, instructif et stimulant, L’empire du malheur. Une histoire de la dépression.
Historien de la médecine spécialisé dans la psychiatrie – il a notamment consacré un livre à la psychothérapie par électrochocs –, Jonathan Sadowsky nous offre ici un tour d’horizon historique, mais également géographique, de la myriade d’états psychologiques que recouvre le terme de « dépression », et des façons dont ils ont pu être traités.
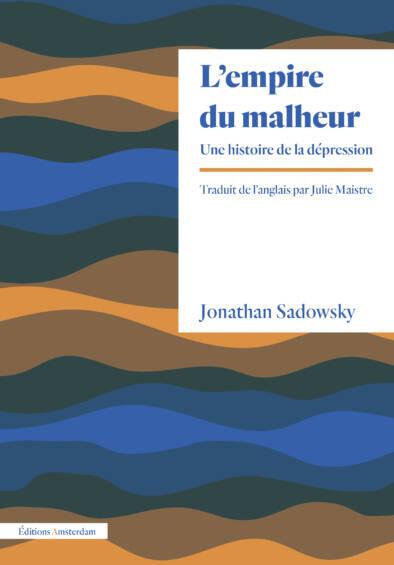
La saisie progressive d’une maladie aux contours mouvants
L’introduction et le premier chapitre s’attèlent à la difficile tâche de cerner le sujet, au travers de l’évocation des différentes controverses suscitées par la hausse du nombre des diagnostics de dépression. S’agit-il, par exemple, d’une maladie exclusivement occidentale ? et n’est-elle qu’une pure invention psychiatrique visant à garantir l’autorité – et la rentabilité – de la moins solide des spécialités médicales ? Répondant par la négative à ces deux questions – et le tour d’horizon mondial démontrant l’universalité de ce mal est particulièrement intéressant – l’auteur en profite pour aborder les différentes manières de définir la dépression.
Il retient finalement, au-delà d’une liste de symptômes possibles assez impressionnante, deux critères distinguant la dépression de la simple déprime : la durée (une tristesse d’un jour n’est pas une dépression) et la proportionnalité (accuser le coup face à un évènement tragique n’est pas un état pathologique), avant d’immédiatement souligner l’arbitraire de tout seuil pour chacune de ces deux dimensions. Plus encore que d’autres maladies, la dépression est une construction sociale dans le sens où, à la différence par exemple d’une fracture du tibia, il n’est aucune manière d’établir objectivement et universellement une définition de la dépression : cette dernière est différente selon les cultures, et même selon les individus. Cependant, « s’il y a une chose qui n’est pas en jeu dans les débats sur les dimensions culturelles de la dépression, c’est sa réalité. Les maladies liées à une culture ne sont pas moins réelles que les autres. […] Nos maisons, nos codes des impôts et l’internet ne sont pas moins ‘‘socialement construits’’. On ne les trouve pas dans la nature avant toute intervention humaine. Ils sont pourtant bien réels. »
Parmi les autres idées reçues évacuées en début d’ouvrage, nous citerons un peu longuement la façon dont l’auteur considère le lieu commun selon lequel le fait d’être « dépressif » serait lié à la possession d’un ou de plusieurs « dons », notamment créatifs ; car ce paragraphe est représentatif de son approche analytique et pondérée :
« Trois questions se posent. D’abord, combien d’autres maladies comptent parmi les patients qui en souffrent des personnes dotées d’un don particulier ? Plus une maladie est commune, plus il y aura au total, en valeur absolue, de personnes de talent parmi ses victimes. Ensuite, combien de personnes avec des symptômes dépressifs ne sont pas particulièrement créatives et célébrées pour leur talent ? Enfin, combien de personnes douées d’un talent remarquable n’ont laissé aucune empreinte dans l’histoire du fait d’un trouble dépressif qui les a empêchées de mettre en œuvre leur don ? La dépression oriente peut-être la façon dont s’exprime la créativité dont une personne est déjà douée, mais je doute qu’elle confère davantage de créativité. »
De la mélancolie au Prozac
L’auteur aborde ensuite, chronologiquement, les différentes manières de considérer et de traiter la dépression, d’abord sous les traits de la « mélancolie » jusqu’au début du XXème siècle, puis au travers de la théorie psychanalytique – deux chapitres riches, dans lesquels Jonathan Sadowsky nous fait le plaisir de se garder de tout mépris pour des théories passées dont il souligne, sans les idéaliser, la fécondité et, parfois, la prescience.
Revenant ensuite à la forte hausse des diagnostics de dépression à partir des années 1950, il en examine sous divers angles les causes, traitant notamment la question souvent posée d’un éventuel surdiagnostic des dépressions sans rien omettre des lacunes intrinsèques des diagnostics psychiatriques en général, et de celui portant sur la dépression en particulier.
Comme ailleurs dans l’ouvrage, et en prenant soin de le distinguer des diverses théories qu’il présente, l’auteur nous donne d’ailleurs son avis. Il identifie tout d’abord une « spirale ascendante » dans l’immédiat après-Seconde guerre mondiale, marquée par l’expansion de la psychiatrie au-delà des murs des seuls asiles ainsi que par la diffusion, dans de larges pans de la société, de connaissances en étant issues – que cela soit par la vogue de la psychanalyse ou l’intérêt de la presse populaire pour les thématiques psychologiques. Mais il pointe le fait que, à cette époque de massification générale des différents diagnostics psychiatriques, la première des maladies n’était pas encore la dépression, mais l’anxiété ; et il souligne que le déplacement massif vers la dépression ne s’est amorcé qu’au cours des années 1970.
« Les projets d’émancipation collective suscitent dorénavant des soupirs résignés. La critique postmoderne des ‘‘grands récits’’ ne se distingue qu’à peine d’un pur et simple scepticisme à l’égard des projets ambitieux de transformation sociale. […] De son côté, le néolibéralisme ne proposait rien qui pût s’apparenter à un bien commun. Son horizon est celui d’un bien strictement privé et individuel. Or, la dépression est précisément une maladie caractérisée par un désespoir privé et des liens sociaux distendus et fragilisés. »
« L’anxiété est l’expression de l’appréhension d’un danger à venir. La dépression est le sentiment d’une perte déjà éprouvée » : les angoisses d’après-guerre quant au risque de confrontation nucléaire entre les deux Grands auraient ainsi cédé leur place au désespoir face à un présent perçu comme bloqué, loin de la croissance économique et des conquêtes sociales des temps passés. Un désespoir généralisé que l’auteur associe au triomphe parallèle du postmodernisme et du néolibéralisme : « Les projets d’émancipation collective suscitent dorénavant des soupirs résignés. La critique postmoderne des ‘‘grands récits’’ ne se distingue qu’à peine d’un pur et simple scepticisme à l’égard des projets ambitieux de transformation sociale. […] De son côté, le néolibéralisme ne proposait rien qui pût s’apparenter à un bien commun. Son horizon est celui d’un bien strictement privé et individuel. Or, la dépression est précisément une maladie caractérisée par un désespoir privé et des liens sociaux distendus et fragilisés. »
Le chapitre suivant, passionnant, est consacré à l’apparition – souvent par pur hasard – des différents traitements physiques de la dépression : antidépresseurs notamment, mais aussi traitements spectaculaires tels que l’électroconvulsivothérapie – les fameux électrochocs de Vol au-dessus d’un nid de coucou. Déplorant le réductionnisme chimique et les illusions auxquels a donné lieu la vogue des antidépresseurs, l’auteur invite cependant à ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain car, si « ils ne permettent que dans de très rares cas de guérir les patients, […] [les antidépresseurs] atténuent parfois les symptômes des maladies traitées », symptômes dont l’intensité rend parfois les antidépresseurs nécessaires avant de pouvoir envisager toute autre forme de psychothérapie, notamment par la parole. Et il rappelle que la dimension corporelle de la maladie n’est pas davantage négligeable que son versant psychologique.
La dépression comme maladie individuelle
Le dernier chapitre est pour sa part consacré aux récits de la dépression, écrits par des individus l’ayant expérimentée en tant que malades ; ce chapitre est à la fois l’occasion de se confronter à nombre de témoignages – qui sont abondamment cités – et de confirmer plusieurs des certitudes dégagées des théories explorées au fil de l’ouvrage : en premier lieu, l’aspect indistinctement psychique et physiologique de la dépression, ainsi que la difficulté à séparer clairement les royaumes de la tristesse et de la dépression ; mais aussi la récurrence de l’absence d’un parent dans l’enfance des malades atteints de dépression, ou encore l’ambivalence des traitements qui soulagent sans aucun doute mais ne soignent jamais totalement.
L’épilogue-conclusion du livre est à l’image de ce dernier : mesuré, il en appelle à rejeter tout dogmatisme, qu’il s’agisse d’un réductionnisme qui ferait de la dépression une affection soit purement psychologique, soit simplement chimique, ou d’un jugement péremptoire sur les causes de la hausse des diagnostics de dépression – hausse qui ne peut être que multifactorielle, et doit être évaluée en gardant à l’esprit les fluctuations des limites mêmes de ce que l’on nomme « dépression ».
Aussi retiendrons-nous ce passage parmi les (toutes) dernières pages comme conclusion : « Plutôt que de vouloir à tout prix tracer un ligne bien définie [délimitant la dépression comme maladie], nous devrions admettre comme une chose nécessaire une certaine flexibilité et même une certaine incertitude. La dépression n’est pas une réalité monolithique. Il s’agit d’un ensemble d’états psychologiques qui portent un même nom en raison de leurs similarités. C’est plus un nom de famille qu’un prénom ».
Référence : SADOWSKI, Jonathan, L’empire du malheur. Une histoire de la dépression, Paris, Editions Amsterdam, 2022 (trad. Julie Maistre)