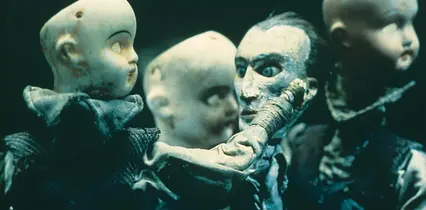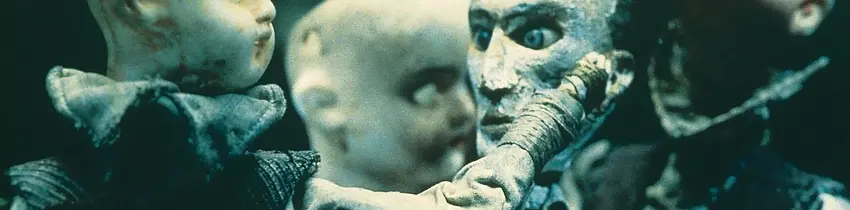Censuré en Chine, le dernier long-métrage de Li Ruijun explore, dans une démarche presque archivistique, le quotidien d’un couple de marginaux unis malgré eux par leurs familles. En arrière-plan se dessine le portrait d’une vie rurale qui se désagrège sous les coups de la modernisation.

Douces domesticités
Il n’y aura pas de cérémonie le jour de leur mariage, et il n’y aura pas d’union. C’est plus tard, au long des jours et des travaux aux champs que le couple se forme, autour de la solitude et du silence. Entre les deux exclus se crée bientôt une complicité, une affection de gestes et non de mots. Dans la marge, avec leurs manières incomprises des autres, ils s’apprivoisent et construisent un refuge, soignent leurs vies. La caméra, à leur image, est pudique. À l’exception de quelques moments de grâce — comme le contact de leur deux mains serrées — elle se tient à distance. Tout se fait avec lenteur, subtilité, si bien que nous ne prenons bien conscience du lien qui les unit que lorsque, sous une pluie torrentielle détruisant plusieurs jours de travail, il ne reste que le couple, enlacé, pleurant, riant, se raccrochant l’un à l’autre. La mise en scène reflète le calme tranquille de cette relation sans orages par des plans toujours soignés, toujours stables. Rien ne tremble et tout est à hauteur d’hommes.
Une telle symbiose laisse peu de place à ce qui se trouve en périphérie. Jamais Li Ruijun ne s’éloigne vraiment de ses personnages, ce qui donne une sensation d’intrusion lorsque, irrémédiablement, l’extérieur entre en contact avec l’intimité du foyer. Le voisin, le patron, le frère, tous semblent des étrangers, amenant leur lot de demandes, de réclames, d’ordres. Leur arrivée est une véritable ingérence, une rupture dans le regard. Nous passons de la tendresse attentive de la caméra aux réflexions sèches des villageois. D’un coup, les protagonistes sont renvoyés à leur rôle d’inféodés, à leur image d’exclus, et le dénuement dans lequel ils vivent — filmé jusqu’alors sans misérabilisme — devient objet d’incompréhension ou de mépris.
Oiseau des villes, oiseau des champs
Le réalisateur ne presse pas le temps, ne force pas les choses, et respecte un rythme lent, quitte à être répétitif.
C’est bien du dehors dont viennent tous les périls. Si les deux protagonistes étaient seuls au monde, le film aurait des allures d’histoire heureuse. Mais le monde existe en dehors de Ma Youtie et de Cao Guiying ; le drame est là, celui d’une autarcie sans cesse empêchée. Tout comme le couple est rattrapé par leur entourage, la vie rurale est rongée par la modernisation. Le réalisateur place ses personnages au cœur d’une campagne qui devient désertique, où ceux qui reviennent ne sont là que pour détruire leurs vieilles maisons, bientôt remplacées par de grands immeubles modernes construits par le gouvernement chinois. Un monde est en train de disparaître. Nous en prenons conscience par petites touches, par contrastes ; leurs vieux habits sont confrontés à des vêtements neufs, vifs, leur charrette poussée par un âne à une Mercedes. Peu à peu s’installe l’impression d’un siècle écrasant l’autre, grignotant ses parcelles, ses maisons, ses habitudes. Au milieu de tout cela, les inadaptés à cette vie moderne, qui aux yeux de tous sauf aux nôtres, sont déjà des vestiges d’un temps voué à disparaître.
Archive-fiction
Ces personnages et cette Chine rurale, Li Ruijun les aime et les connaît, cela se sent. Il leur laisse le temps de s’exprimer d’eux-mêmes, par de longs plans fixes. Le long-métrage ne craint pas de faire succéder à une scène de travaux aux champs une autre scène de travaux aux champs, souvent sans musique, voire sans dialogue. Les gestes — planter, semer, labourer — ne sont pas des illustrations mais des sujets en eux-mêmes, qui occupent tout l’espace de l’écran. Le réalisateur ne presse pas le temps, ne force pas les choses, et respecte un rythme lent, quitte à être répétitif. Un profond respect pour ce travail manuel se détache de l’ensemble, ainsi que la volonté, forte,de documenter, de filmer des gestes en train de se perdre. Pour ne pas les laisser s’effacer, peut-être, ou pour leur donner une certaine vérité, Li Ruijun et son équipe ont passé eux-mêmes plusieurs mois à travailler la terre, cultivant les champs, construisant la maison que nous voyons à l’écran.
Cette volonté contradictoire — celle d’accoucher d’une archive et celle de créer un film — est à la fois la beauté et la faille de Retour des hirondelles. Le temps naturel est laissé tel quel ; cette dimension documentaire, cyclique, rend parfois la fiction étrange, comme malvenue. Certaines tirades de Ma Youtie, tout droit tirées d’un bon sens populaire, paraissent trop écrites, et lui donnent moins de sagesse et de naturel que son silence. D’un autre côté, la construction étudiée des plans empêche d’oublier qu’il s’agit d’une fiction. Le film devient alors cet objet fascinant, à la fois conte et témoignage, l’archive rencontrant l’invention, parfois maladroitement, mais le plus souvent avec justesse. C’est par excès de tendresse que Le retour des hirondelles s’étend un peu trop longuement, laissant dans son envol la fiction derrière soi.
Le retour des hirondelles, un film de Li Ruijun, avec Wu Renlin, Hai-Qing, en salles le 8 février.