
Tout lecteur de Camus remarque assez rapidement – en particulier dans ses ouvrages philosophiques – la forte empreinte de Nietzsche sur sa pensée, empreinte que Gilbert Merlio a entrepris de retracer dans Sisyphe et l’homme révolté, paru en 2022 aux éditions R&N. Cet essai est à la fois une description précise de l’influence nietzschéenne sur l’auteur de l’Homme révolté, et une comparaison féconde et éclairante entre les pensées de ces deux hommes certes proches, mais dont les divergences ne sont pas moins signifiantes que leurs points communs.
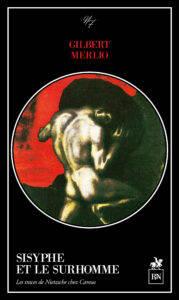
La connaissance profonde des deux penseurs par notre auteur est évidente, et donne un livre érudit sans être pédant – même si on eût préféré lire un peu moins de citations d’autres auteurs écrivant sur Camus, pour profiter davantage des réflexions pertinentes de Gilbert Merlio. S’appuyant avant tout sur les citations de textes ou du nom de Nietzsche par Camus, l’essai se concentre de fait sur la pensée explicitement philosophique de ce dernier, sans négliger cependant, loin de là, ses œuvres littéraires – dont l’usage mesuré lui permet de ne pas les tordre, comme cela arrive souvent lorsque l’on veut embrigader toute entière une littérature sous la bannière d’une pensée, même d’une pensée antisystématique comme l’est celle d’Albert Camus.
Sublimer le nihilisme
Camus préconise, à l’unisson de Nietzsche, un dépassement de ce nihilisme par la sublimation personnelle, notamment artistique.
La plus fameuse question autour de laquelle se rencontrent les deux auteurs avant de diverger par leurs réponses respectives est celle du nihilisme, qui occupe Camus dès Le Mythe de Sisyphe. Comme le relève G. Merlio, là où le père de Zarathoustra fait de ce phénomène le « résultat d’un processus décadentiel bimillénaire », Camus écrit pour sa part dans son essai qu’il est le fruit de ce qu’ « Il [l’homme] sent en lui son désir de bonheur et de raison. L’absurde naît de la confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde. »
Malgré cette différence de diagnostic, l’enfant d’Alger préconise alors, à l’unisson de Nietzsche, un dépassement de ce nihilisme par la sublimation personnelle, notamment artistique. Il prône une « éthique de la quantité », c’est-à-dire une accumulation d’actes certes insensés en eux-mêmes – car le monde n’a pas de sens – mais dont l’accumulation trace un chemin autour duquel l’homme peut se construire. Ainsi écrit-il, toujours dans le Mythe de Sisyphe : « Les conquérants savent que l’action est en elle-même inutile. Il n’y a qu’une action utile, celle qui referait les hommes et la terre. Je ne referai jamais les hommes. Mais il faut faire ‘‘comme si’’. Car le chemin de la lutte me fait rencontrer la chair. Même humiliée, la chair est ma seule certitude. Je ne puis vivre que d’elle. » Camus est alors assez fidèle à Nietzsche, et proche de son idée du surhomme qui accepte le destin tel qu’il est et s’affirme en agissant.
Les impasses de l’amor fati nietzschéen
Cependant la Seconde Guerre Mondiale ne pouvait que difficilement laisser inchangée cette option de l’amor fati (« aime ton destin ») héritée tout droit de Nietzsche ; et l’Homme révolté est le livre où s’exprime avec le plus de force le fécond divorce de Camus avec son maître. Il y relève que l’acceptation et même l’amour (amor fati) inconditionnel de la réalité peut, à son tour, précipiter l’homme dans le nihilisme : « L’ascèse nietzchéenne, partie de la reconnaissance de la fatalité, aboutit à une divinisation de la fatalité. Le destin devient d’autant plus adorable qu’il était implacable. […] Le mouvement de révolte où l’homme revendiquait son être propre disparaît dans la soumission de l’individu au devenir. » Si Nietzsche n’était pas nazi, son amour inconditionné de tout ce qui arrive forçait, de facto, à accepter et aimer le nazisme – et ce quand bien même l’auteur du Gai savoir a par ailleurs critiqué l’antisémitisme ou l’Etat : amor fati, quel que soit ce destin.
Aussi Camus note-t-il en 1948 dans ses Carnets : « Contre l’Amor fati. L’homme est le seul animal qui refuse d’être ce qu’il est. » Aussi refuse-t-il dans l’Homme révolté de soumettre l’homme à la seule fatalité et d’ignorer son exigence de justice – ce « désir de bonheur et de raison » dont on a vu qu’il l’évoquait déjà dans le Mythe de Sisyphe – lorsqu’il écrit : « Le trône de Dieu renversé, le rebelle reconnaîtra que cette justice, cet ordre, cette unité qu’il cherchait en vain dans sa condition, il lui revient maintenant de la créer de ses propres mains ». Cette révolte contre le monde absurde sera intrinsèquement collective : détournant Descartes, Camus écrit : « Je me révolte, donc nous sommes. » L’exigence de justice tient à la condition humaine, et rapproche donc des autres hommes : l’insistance nietzschéenne sur les grandes individualités est, à tout le moins, placée au second plan.
Comme le note G. Merlio, cette inflexion, qui est moins une rupture qu’un déplacement de focale depuis le monde absurde vers l’homme porteur d’une exigence, se traduit également dans la conception qu’a désormais Camus de l’art. Celui-ci ne doit pas ignorer la réalité, mais il ne doit pas s’y réduire, et « doit également sublimer la vie », d’une part « en lui montrant une alternative, une autre vie », d’autre part en « [témoignant] du passage de l’expérience individuelle à celle de la solidarité entre tous les hommes. »
Pour résumer : d’après Camus, le monde est certes irrémédiablement absurde – comme pour Nietzsche –, cependant l’homme mériterait mieux – contre Nietzsche, chez qui la grandeur de l’homme venait de son adhésion au monde. A rebours de son maître allemand, Camus, certes critique de la moraline et conscient de combien l’amour-propre motive souvent l’humanitarisme, se refuse cependant à rejeter toute morale – ce pourquoi nombre d’intellectuels, plus à l’aise dans l’outrance verbale gratuite que dans la prise en compte du réel, le riront souvent.
Camus face au christianisme
Merlio pose la question de l’éventuel christianisme non de Camus, qui n’a jamais renié son athéisme hérité de Nietzsche, mais du moins de sa pensée ; et, en particulier, de cet humanisme qu’il refuse d’abdiquer. Question d’autant plus valable quand on sait que, après le constat de l’absurde et la défense de la révolte, l’enfant d’Alger voyait dans l’amour à la fois l’origine et la garantie du succès de cette révolte salvatrice, qui sépare l’homme de l’animal.
Après un récapitulatif du trajet intellectuel camusien qui occupe les deux premiers tiers de l’ouvrage, G.Merlio considère ensuite sa pensée de plusieurs points de vue et, pour commencer, pose la question de l’éventuel christianisme non de Camus, qui n’a jamais renié son athéisme hérité de Nietzsche, mais du moins de sa pensée ; et, en particulier, de cet humanisme qu’il refuse d’abdiquer. Question d’autant plus valable quand on sait que, après le constat de l’absurde et la défense de la révolte, l’enfant d’Alger voyait dans l’amour à la fois l’origine et la garantie du succès de cette révolte salvatrice, qui sépare l’homme de l’animal. Comme l’écrit Gilbert Merlio, l’amour camusien « est en soi la mesure qui oblige au respect de l’homme et de sa dignité en tout temps, en tous lieux et en toute action ou création, qui s’oppose donc aussi bien à la pathologie de la révolte historique qu’à la divinisation démiurgique de l’homme. L’amour est le ferment de cette ‘‘fière compassion’’, c’est-à-dire de la solidarité, éprouvée de façon ‘‘métaphysique’’ dans la révolte. L’amour est ce qui doit empêcher la révolution de céder au ressentiment et de verser dans le crime. » Et, ajoute-t-il, « tout cela confirme l’origine affective, voire mystique ou non rationnelle de l’éthique camusienne ».
Alors, Camus chrétien ? La réponse de G. Merlio nous paraît excellente : « privé de la grâce, il donne parfois l’impression de vouloir continuer ou reprendre l’œuvre défaillante du christianisme » ; un peu comme il le fait avec Nietzsche, il reprend certaines questions éminemment chrétiennes, mais sans y apporter les mêmes réponses. Car il refusera toujours de repousser la rédemption dans un « arrière-monde », se préoccupera toujours de la condition des hommes ici-bas, et y accordera d’autant plus d’importance qu’ils n’auront pas de vie dans l’au-delà pour racheter les injustice qu’ils auront subies – ou commises.
Pour une morale sans moraline
Eclairant ensuite Camus par un autre angle et mettant au jour l’influence peu connue de Tocqueville sur ce dernier, G.Merlio résout l’apparente contradiction entre l’aristocratisme anticonformiste hérité de Nietzsche et la préoccupation « de gauche » de l’enfant d’Alger pour les humiliés : ce dernier n’est en effet pas tant préoccupé d’égalité que de « justice ». Comme chez Nietzsche, la vision camusienne de la justice – liée à celles de mesure et de limites – naît d’un goût esthétique pour la beauté d’un monde correctement ordonné ; ainsi Camus note-t-il dans ces Carnets : « Paris. La beauté c’est la justice parfaite. » Cependant et, à nouveau, à rebours de son maître allemand, l’auteur de l’Homme révolté ne saurait se contenter d’une contemplation béate du monde tel qu’il est : comme le note G. Merlio, « la justice ne répond pas uniquement à un critère esthétique et ne résulte pas non plus [comme chez Nietzsche] d’un rapport de forces, mais d’une exigence morale, c’est-à-dire du respect de la bonne mesure dans les relations humaines et dans la cité. Et ce bon équilibre doit être d’abord respecté dans l’égale importance accordée aux droits et aux responsabilités. » Ainsi retombons-nous sur cette exigence morale et collective que portait la révolte.
La pensée camusienne n’étant pas systématique, on ne trouvera pas d’exposé didactique de cette exigence morale – qui ressemble beaucoup à la common decency orwelienne. Cette exigence est d’abord vécue, puis pensée, et tire sa mesure pour bonne part de son pragmatisme. Ainsi, là où Nietzsche va jusqu’au bout de sa critique de la croyance en une Vérité intangible et finit par prêcher le recours au mensonge bénéfique, l’expérience vécue par Camus ne lui permet pas d’aller aussi loin. En 1944, c’est-à-dire au sortir de son expérience du mensonge politique organisé, il rend compte de deux ouvrages philosophiques et, dans le texte qu’il y consacre, affirme fermement la nécessité de l’honnêteté. Peu importe l’inaccessibilité de la Vérité absolue, il s’agit de vivre parmi ses semblables du mieux que l’on peut ; et Camus écrit que « la critique du langage ne peut éluder ce fait que nos paroles nous engagent et que nous devons leur être fidèles. »
Ainsi est l’humanisme camusien : sans fondement transcendant qui justifierait l’homme en le reliant à une réalité supérieure (notamment divine), et sans le systématisme que prend, parfois, l’aristocratisme nietzschéen – dont, comme le relève à plusieurs reprises G.Merlio, on ne peut que remarquer qu’il est moins nourri par l’expérience de son auteur que ne l’est la pensée camusienne. Ayant beaucoup vécu parmi ses semblables, et par ailleurs grand lecteur des moralistes du XVIIème siècle, Camus n’a guère d’illusion sur la nature humaine ; cependant – et c’est peut-être là « sa puissance et sa punition », comme l’était pour Hugo le doute chez l’homme – Camus se refuse à ne plus être solidaire de ses congénères. C’est ce qui l’écarte de la vision nietzschéenne d’une Histoire ayant pour unique but l’enfantement de grands hommes, au besoin en avilissant une masse d’esclaves. Et sans doute la profondeur de cet écrivain tient-elle à son écartèlement entre l’extrême lucidité qui est la sienne face aux médiocrités de ses semblables, et sa constance inflexible dans la revendication en leur nom d’une justice nécessaire et d’un amour salvateur.
Référence : Gilbert Merlio, Sisyphe et le surhomme. Les traces du Nietzsche chez Camus, R&N Editions, 2022

















