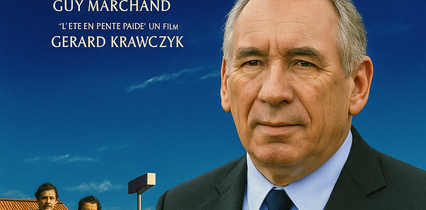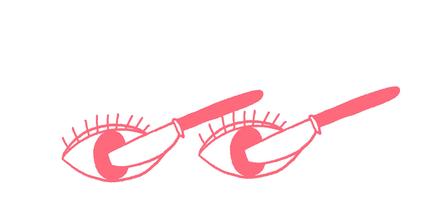Mi-homme mi-athlète, imaginer une course de chevaux qui s’élancent sur la piste. S’imaginer vainqueur en franchissant l’extrémité de la piste de course et presque entendre les clameurs des Corinthiens assemblés. Un texte de notre revue papier N°5 sur le Sport signé Louise Guillemot.
Voler ne me fait pas peur !
Je sens chaque caillou de la piste, je sens les remous dans mon ventre comme un ressac de poussière. Je suis la créature marine, le monde autour de moi est lent et silencieux, les clameurs me viendront après. Je suis Amphitrite, je suis le char de Poséidon, je suis l’écume. Amphibie, mi-homme mi-course. Je suis le souverain et l’esclave, je suis le cocher. L’aurige.
Une fois j’ai franchi en premier l’extrémité de la piste. Je n’ai pas eu de couronne. Les juments et moi sommes tous les trois hors d’haleine. Ma veine jugulaire galope. J’ai le regard fou du vite animal dont on dira : « Il a bien couru ! ».
Le vainqueur est Synésias de Corinthe. C’est lui qui possède les chevaux. Ils sortent tout piaffants de son écurie, c’est grâce à lui s’ils ont de l’avoine, si un esclave les brosse tous les jours, s’ils sont beaux, vites et vainqueurs. Et peu importe qui vole avec eux, peu importe quel cœur ils entraînent avec soi sur la piste au risque des cailloux, du sang, de la peau déchirée en lambeaux longs comme les Iliades. L’aurige n’est jamais vainqueur, le vainqueur c’est le maître.
Je suis né à Corcyre il y a vingt ans et je n’ai jamais aimé les athlètes. Ils ne combattent pour personne. Pas pour la cité, pas pour les cités. Pas pour la vérité ou la justice. Pas même pour trancher qui d�’Homère ou d’Hésiode est plus propre à agrandir la vie humaine. Enfant, j’ai plongé pour chercher des éponges. J’ai cru que ce serait ma vie, plonger pour les éponges, et puis non. Me voici à Corinthe, la cité mère qui enfanta Corcyre. Corinthe et ses hommes riches, ses prêtresses prostituées. Je ne suis pas pêcheur mais pêché. Mes courses sont les soubresauts du poisson sur le ponton.
Quand j’ai conduit à la victoire les chevaux de Synésias, c’était à Olympie. Maintenant, chez nous, c’est bientôt les Jeux Isthmiques. Curieux de leur donner le nom d’un goulet de terre, cette glotte étranglée entre l’Attique et le Péloponnèse et noyée par l’Égée. Ça n’aide pas à prendre son souffle.
Et il en faut pourtant, course courte, course longue, course en armes, course de chars à deux chevaux, course de chars à quatre chevaux, j’ai un point de côté rien qu’à entendre crier le public.
Heureusement que je ne fais qu’une course. Deux chevaux. Deux juments plutôt. Il faut prendre serré le virage à la borne et prendre garde de ne pas se laisser émincer comme l’Hector de l’antique recette quand Achille le traînait mort attaché à son char. Cet Hector eut plus de chance que nous n’en aurions, car les dieux préservèrent des chocs la beauté de son visage.
Ce que je n’aime pas, ce sont les noms. Les noms des vainqueurs répétés avec une ampleur énorme. Gravés sur les socles des statues. Chantés par les poètes, par ce Pindare et toute la clique. Leurs noms et leur cité de naissance — quelle blague ! Comme s’ils lui apportaient quelque chose. Comme s’ils montraient quelque chose d’elle.
Les noms sont sots à côté de la course. Il n’y a pas de dissociation plus parfaite que celle de la course de char, entre le nom et l’acte. Je suis l’ombre du vainqueur, il est moi-même à ...