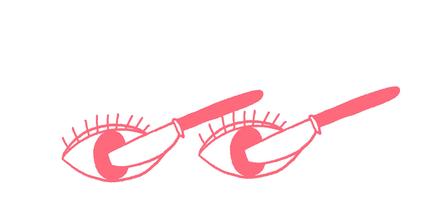Atteinte d’un trouble méconnu de la mélancolie – la maladie des jeunes filles, des jeunes hommes. TAS : trouble affectif saisonnier.
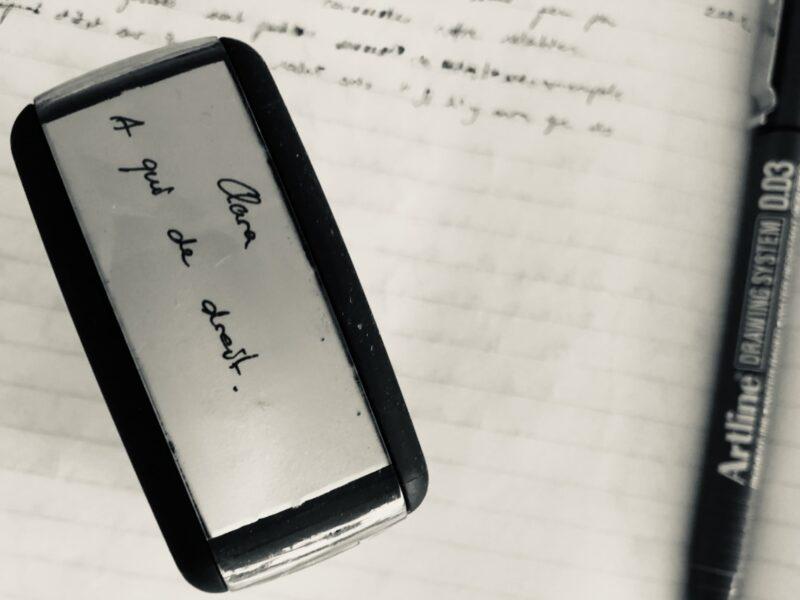
Sur l’A6 du retour, je m’arrête à ma station-service préférée : toilettes roses cendrées, miroir incurvé en forme de coquillage, et les speakers qui balancent un vieux Hit Chart Nostalgie. Britney Spears, Gimme (Gimme, more), si proche que j’ai l’impression qu’elle chante dans mon oreille. Puis les publicités : votez pour les VMA’s ce dimanche 7 septembre. Je me souviens que Tate McRae, hey cute jeans, you got a sports car (Oh-oh, ) we can uh-uh in it (Uh-mm), la nouvelle Britney, sera devant moi dans quelques semaines à peine, à Nashville – et qu’il faut d’ici là que je vote pour elle, et pour Billie (où Bad B).
Le speaker enchaîne sur les actualités, puis la santé. La nouvelle tombe par les haut-parleurs. Avec Britney, le mal qui me poursuit depuis des années sans nom, je comprends soudain qu’il en a un. Je vacille, je m’effondre. Les troubles affectifs saisonniers touchent environ 20 % de la population, dis-je, les yeux grands ouverts.
Lily sort alors du Kentucky Fried Chicken, gobelet fumant à la main. Je me dis que cette fois je ne vais pas tenir. Lily a cette capacité étrange : écouter sans jamais manifester d’anxiété, m’entendre monter en régime – de 90 à 130 BPM vers 11 h 30, pic de travail du matin – sans rien laisser paraître. Cette neutralité, autrefois rassurante, m’a souvent sauvée. Pourtant, cette fois, j’ai enfin un trouble étiqueté, le rêve secret de toute personne de mon âge : je suis atteinte de TAS.
Au moment où je me rends compte que les symptômes arrivent déjà, septembre naissant, je réalise que je suis bien dans la station essence de mon enfance, et que je tiens une peluche ourse en main (il me la faut, car mon héroïne du roman 2 en avait une en 1979). J’embrasse Lily et Carlos, et bois d’un trait la bouteille d’eau, il fait presque 40, Carlos vide la fin de sa bouteille sur nous, et on repart une dernière fois sur la route.
Depuis que je sais conduire j’ai perdu le peu de moralité qu’il me restait, comme si le simple fait de tenir un volant annulait toute pudeur, toute retenue, et rattrapant le temps perdu de mes 18 ans, âge où je n’ai pas eu mon permis.

La veille, Belle-Vue
Ni chaud ni froid. Mi-cuit, mi-tendre, ou autres amours de vacances.
Je me trouve au seuil, 28 août exactement, entre les derniers grains de sable coincés dans mes chaussures, un haut de maillot à fleurs et un tee-shirt jaune abandonné sur la terrasse de la maison du Sud. C’est ici, chaque fois, que je fuis pour m’enfermer à l’étage, dans ma chambre « Belle-Vue ». Et à chaque début de texte, la tentation de noter Bella Vista me prend, en écho à la nouvelle de Colette à Saint-Tropez, si juste, si proche de ce que j’imagine être la vraie vue de Colette, avant, pour toujours.
J’ai choisi une carte postale grise, nuances de platine doré, silvergold, pour India Lange. Depuis mes 18 ans, India me prend en photo ; elle possède sans doute le plus d’archives des années tourmentées, ainsi que des séances rares, réunies avec mon frère et ma sœur, les jumeaux, en 2023 et 2024. La photo n’est pas signée, seulement datée de 1940, la poissonnerie du port, derrière Sénéquier n’a pas changé. Et les photos d’India, cet œil semblable, cette chance du click, de l’instant d’après. India travaillera sur argentique ou pas, film ou photos : il y aura toujours chez elle l’un des déclencheurs les plus purs de la photographie, son œil même comme un objectif. Il est 11h39, et mes divagations débutent. Je traîne mes journées en éclatant les tâches en mille idées, et c’est ici que je m’attache le plus fidèlement à les raconter.
Écrire à India, c’était retrouver Valery Larbaud, mon premier ami du cercle fermé des livres. Il m’apprit que la ténacité et l’ampleur des travaux multiples – traductions, carnets, réécritures – sont toujours des biens, toujours des amis, des amants, des compagnons de voyage. Qu’il ne faut jamais tout recommencer, mais corriger au sein même du texte, à la manière d’un peintre après la grisaille. Le voyage est le même : on retouche amoureusement cette affreuse chose, surplus de nous-mêmes dont nous sommes créateurs avant d’avoir des enfants, ou de garder ceux-ci, jalousement, sans grandir.
Voyageur massif, enfant resté fidèle à l’amour de sa mère, tranquille jusqu’au bout. Sa Pléiade est la plus mince, mais chaque page compte, et jamais je ne fus triste de l’ouvrir. Pourtant, dans le désordre des choses et de leurs inverses, j’ai résisté jusqu’au début des vacances – quatre ans et deux cent cinquante-six jours – refusant d’ouvrir son premier roman (A.-O Barnabooth, son journal intime) retombant toujours à la fin des dernières pages de son journal. Je note toujours les dates de mes lectures au sein des livres (le journal de 1901 à 1935 dans la blanche, ses mille six cents pages, ses deux kilogrammes, son format géant, un défi physique, insupportable à tenir, assis comme debout – me glissa deux fois des mains.) C’était donc en 2021. Toujours, j’ai refusé de connaître son alter ego : le jeune A.O. Barnabooth, où Valery Larbaud lui-même, à vingt-cinq ans, se parodiait en un personnage extravaganza, cosmopolitique, et je craque ce soir, repoussant encore la lettre.

Si Larbaud me fascine, c’est qu’en dépit des voyages constants (je me suis exposée ce matin vingt minutes au soleil d’un omnibus) et plus éprouvants alors (j’ai mis dix jours à arriver à Brest), Larbaud à toujours cédé à l’inclination d’être avec sa mère, à qui il dévouait une admiration sans faille. Et sans faille non plus son intérêt pour le travail.
Au lieu d’exprimer seulement le caractère tranquille et travailleur de l’homme, je verrais ici plutôt une connivence avec le réel : même en plein travail de traduction de Samuel Butler, Savage Landor, J. Joyce, W. Whitman, Valery Larbaud, dont l’œuvre propre passait après ceux qu’il admira suffisamment pour leur consacrer ses plus grands travaux – en allemand, français, espagnol, italien, anglais – suffisamment pour savoir toujours s’émerveiller de là où la mer (mère) l’emmenait, et des cages dorées, hôtels, pensions, voitures-couchettes. Il aurait pu souhaiter se perdre dans ses maladies vénales de la mélancolie, mais jamais Larbaud ne fit fausse route. Et cette sagesse de savoir attendre (tels les plats d’un restaurant, ou simplement attendre, car dans mes souvenirs l’enfance consistait en une attente inexorable d’un futur meilleur, comme si la condition d’enfant ne se suffisait pas, mais se révélait au seuil de son transfert tel un candélabre sans bougies : aussi insipide qu’injustifiable, inutile) me fait aimer chaque point qu’il eut dépeint de son encre.
Ma vie donc se résume en une constante oscillation : de la plus pure adhésion classique à l’esthétisme – tant par sa pratique acharnée et constante que par ses pairs – à mes étourdissements répétitifs au cours d’une journée. L’été, j’atteins le climax de ce travail (je me lève, en période d’écriture romanesque, vers 5h30 – et depuis deux ans, 9h49, car je ne dors jamais avant 3h30, je vaque à des occupations nocturnes de cinéma ou de chant).
J’aurais bien du mal à expliquer que chaque jour y trouve son travail, sans vacances nulle part, puisque ces dits-métiers de substitution (aux grandes écoles, aux grands diplômes – trauma calviniste enfantin) sont de réelles sources de rétribution intérieurs. Et que, dans celles-ci, les changements de cap journaliers sont en soi une série d’événements formidables qui donnent la satisfaction de les retranscrire en journaux.
Qu’importe, je m’évade de ma pensée initiale, mettant en contradiction le classique et la forme la plus superficielle et banale d’aimer la vie par la pop : d’un côté, le regard en arrière avec une sorte de contrariété prestigieuse (comment, vous n’aimez pas lire ? je fronce les sourcils et fais du pied à mon voisin), de l’autre, j’aime écouter Miki en secret, acheter un t-shirt LN4 (Lando Norris– même si j’aime notre Isack Hadjar, 20 ans. Go Isack ! Pari : top 5 Dutch GP), défendre Shay, dire à tous que Yoa est suisse, que Raye aussi, et que de toute façon, si Timothée Chalamet et The Kid Laroi avaient quitté leurs conjointes respectives Kylie Jenner et Tate McRae, ça se saurait autant que s’il y avait plus de MDMA que d’héroïne. (Je suis ma propre héroïne, Je suis mon amphétamine, M.D)