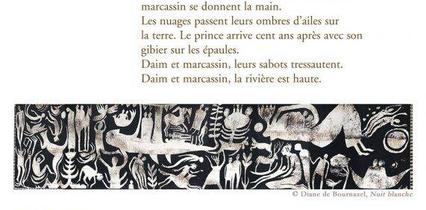Zone Critique vous propose un nouvel article en provenance de son partenaire, le magazine La Cause Littéraire. Retour aujourd’hui sur le succès américain de cette rentrée littéraire, Le fils, de Philipp Meyer.

Le mythe du Grand Roman Américain fait depuis longtemps courir les apprentis écrivains (américains, cela va de soi) et peut-être plus encore les critiques, prompts à dégainer l’expression pour la transformer en un superlatif censé montrer à quel point le romancier a su peindre l’âme américaine. Le fils, de Philipp Meyer, n’y échappe pas. C’est d’ailleurs écrit sur la couverture de l’édition française sous la plume d’un chroniqueur du Washington Post qui a toutefois la prudence d’utiliser un article indéfini. « Un grand roman américain » lit-on donc. Sans doute en l’occurrence ce journaliste a-t-il vu juste, d’ailleurs. Car si Le fils n’est certainement pas Le Grand Roman Américain, il est bel et bien un grand roman sur l’Amérique. Mais pas sur n’importe quelle Amérique. Sur celle des vainqueurs, les perdants étant destinés aux oubliettes de l’Histoire.
Pour dresser ce portrait, Philipp Meyer choisit trois narrateurs dont les récits alternent d’un chapitre à l’autre. On commence avec le Colonel Eli McCullough enlevé par les Comanches au sortir de l’enfance et qui va vivre avec eux quelques années avant de retrouver les Blancs et, après quelques années d’aventures, poser les fondations d’un empire terrien. Suit Jeanne-Anne, arrière-petite-fille d’Eli, redoutable femme d’affaires qui a continué de faire prospérer la fortune des McCullough grâce au pétrole. Puis arrive le tour de parler pour Peter, fils d’Eli, grand-père de Jeanne-Anne et certainement le seul de la famille à ne pas vouloir dominer le monde.
De ces trois récits imbriqués, naissent trois histoires que les liens du sang et les tiraillements familiaux qui résonnent de l’une à l’autre soudent.
À Eli donc de raconter un western épique, les longues chevauchés dans les Plaines, les combats et les chasses – au bison ou à l’homme – et de poser la philosophie qui sera la sienne et celle de sa famille :
« Après la raclée infligée par les autochtones [les Comanches, ndlr], le gouvernement mexicain recourut à une mesure désespérée pour coloniser le Texas : tout homme, d’où qu’il fût, prêt à s’établir à l’ouest de la Sabine River recevrait deux mille hectares de terre. Les petits caractères au bas du contrat étaient écrits en lettres de sang. La philosophie comanche à l’égard des étrangers était d’une exhaustivité quasi papale : torturer et tuer les hommes, violer et tuer les femmes, emporter les enfants et en faire des esclaves ou les adopter. Il y eut peu de gens du Vieux Monde pour accepter la proposition des Mexicains. En fait, personne ne vint. Sauf les Américains. Un vrai raz-de-marée. Ils avaient des femmes et des enfants à revendre, et puis cette promesse biblique : Au vainqueur, je ferai manger l’arbre de vie».
La vie comme un combat dans lequel tout ce qui compte est de se trouver du bon côté du manche et de détruire l’adversaire ou le concurrent. Une leçon qu’Eli vit dans sa chair et qu’il va appliquer à la lettre, construisant la fortune familiale dans le sang. Une leçon que Peter se refuse à assimiler, plaçant le sens moral au-dessus de la quête du pouvoir et de la richesse, mais qui lui vaut autant le mépris de sa famille que de la population du comté et même d’employés qui révèrent le patron qui les considère comme quantité négligeable et n’ont que peu de respect pour celui dont l’attention qu’il leur porte est vite taxée de faiblesse. Une leçon enfin que Jeanne-Anne a pour sa part totalement intégrée au point de vivre sa vie comme un tel combat qu’elle est destinée à la solitude.
De ces trois récits qui touchent pour l’un à l’épopée sauvage entre un monde qui disparaît et un autre qui se construit, pour l’autre au mélodrame et pour le dernier à la success-story aux accents dramatiques, Philipp Meyer tire une vertigineuse allégorie de son pays. De cette saga familiale au souffle épique, ressort avant tout la construction d’un pays dont les fondations sont moins scellées par les idéaux des Pères fondateurs que par le sang qu’eux et leurs descendants ont fait couler pour faire leur place et leur fortune. Le fils est ainsi avant tout la vision d’un pays, d’une société, qui ne peut avancer que dans la confrontation et la destruction de tout ce qui pourrait éventuellement représenter un frein à un développement condamné à ne jamais cesser.
Bref, un des grands romans de l’année pour un auteur qui, après un premier livre déjà remarqué (Un arrière-goût de rouille), prend une autre dimension
Grâce aux récits rudes de la formation et de l’ascension d’Eli et de Jeanne-Anne que vient contrebalancer la crise morale de Peter ; grâce aussi à cet entrelacement des époques qui vient appuyer l’idée de l’immuabilité du destin familial par la persistance, malgré les crises, d’un état d’esprit conquérant – et Eli, d’entrée de jeu, n’hésite d’ailleurs pas à jouer de la comparaison avec Alexandre le Grand – Philipp Meyer parvient à mettre en place un roman d’une rare maîtrise, tant dans le rythme que dans le fond. Il en ressort un livre d’une grande richesse, une aventure inouïe, violente souvent, romantique aussi et pas sans humour non plus. Bref, un des grands romans de l’année pour un auteur qui, après un premier livre déjà remarqué (Un arrière-goût de rouille), prend une autre dimension.
- L’article original
- Le fils de Philipp Meyer, traduit de l’anglais (USA) par Sarah Gurcel, Albin Michel, 673 pages, 23,50 €, septembre 2014.
Yan Lespoux