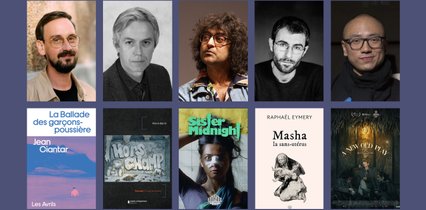Dans son premier roman, la jeune poétesse Alix Lerasle sonde la souffrance d’une famille dysfonctionnelle et donne à la maison familiale toute sa profondeur. Avec sa porte qui bâille, ses murs qui s’effritent, son parquet taché et ses chambres qui respirent la poussière, la maison devient un personnage à corps entier.
Une petite fille vit dans une maison, le père est parti, la mère est malade, l’aîné est absent et le cadet est son seul réconfort. Nous ne savons pas dans quelle ville ou village, ni dans quelle région, la maison se situe. Elle est hors-sol, petite planète à la dérive, mais hantée par la douleur.
Dès les premières lignes, il y a cet impératif “écoute-moi bien” qui nous engage à continuer la lecture. Une voix de petite fille nous parvient, elle semble revenir de loin. Elle est sans nom et sans âge. Elle veut nous raconter l’histoire “de la maison / et de nous dedans / tout est réel / et rien n’est vrai”. Et déjà, dans cette première béance entre la réalité et la vérité, un gouffre apparaît.
Cette petite fille nous dit d’emblée qu’elle se force à se taire “je fais ça je / plie ma langue / sur elle-même / je la fais glisser le plus loin dans ma gorge / c’est comme un jeu / pas vraiment drôle / mais au moins je me tais”. A travers cette écriture, ciselée au couteau, se niche une certaine violence. Le retour à la ligne systématique est cinglant, et révèle, graphiquement, l’indicible. Les pages sont presque toutes à moitié blanches et la ponctuation est éludée. En trouant ainsi le récit, Alix Lerasle parvient à créer une forme idoine pour retranscrire la litanie de pensées de la petite fille qui nous ouvre son cœur bariolé de douleur. Les vers ressemblent alors à des plaies qui, au fur et à mesure de l’avancée du roman, se transforment en cicatrices.
En trouant ainsi le récit, Alix Lerasle parvient à créer une forme idoine pour retranscrire la litanie de pensées de la petite fille qui nous ouvre son cœur bariolé de douleur.
Une petite fille se tait donc, et sa mère la trouve ridicule, se désintéresse d’elle, la laissant dans une solitude crasse. Un nouveau gouffre s’ouvre, celui de la violence du foyer. Mais d’où vient-elle, l’origine de cette violence ? Est-ce à cause du père qui, nous l’apprenons vite, sort un soir son fusil, met en joug un de ses enfants pour finalement tirer dans le plafond de la cuisine ? Cette marque dans la poutre, planant au-dessus de leurs têtes comme un couperet, est indélébile. De ce coup de fusil, tout semble découler. Car juste après, le père s’en va, brisant la cellule familiale. La narratrice ne l’appelle jamais par le qualificatif de père, mais par un nom bien plus symbolique : l’absent. “L’absent est un absent parfait / il a vraiment disparu / n’a laissé presque aucune trace / sauf dans ma tête / sauf dans tous nos cerveaux”
D’une famille de cinq, ils ne sont plus que quatre. Il y a la mère, physiquement malade, le “grand grand frère” dont on sait peu de chose, le “petit petit frère” Nathanaël, le seul à avoir un prénom, et puis la narratrice. Ils sont quatre, mais seulement trois à vivre dans la maison puisque l’aîné est en pension. Lui aussi a fini par s’enfuir dans la nuit.
Du seuil de la maison, au “jardin crevé”
Dans une tragédie familiale, quelle est la place de la maison ? On voudrait qu’elle soit protectrice, un foyer chaud, un nid douillet où panser ses plaies et se cacher de la nuit. Mais comment faire quand la maison est le lieu où germent les souffrances et où se produisent les crimes ? De témoin, la maison devient comme com...