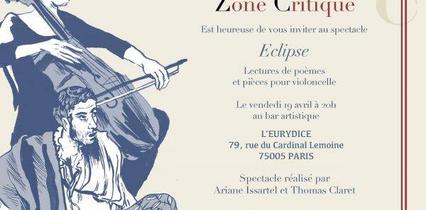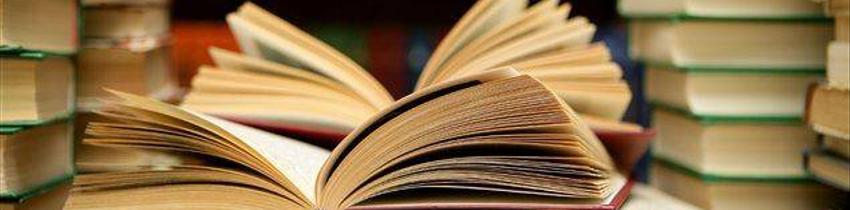Zone Critique rend aujourd’hui hommage à Claude Chabrol et à son égérie, Stéphane Audran, disparue cette semaine, et que le réalisateur a immortalisé dans Les noces rouges, Le boucher, ou La femme infidèle. De l’élégance mystérieuse de Stéphane Audran aux tiraillements d’Isabelle Huppert, promenade en liberté dans la filmographie du maître, qui n’a jamais cessé d’explorer différents genres cinématographiques au cours de sa carrière, du film noir à la comédies de mœurs.Claude Chabrol sait où il va. Son cinéma est bizarre, personnel, inattendu. Il peut vous faire Madame Bovary, l’Affaire Elf, Simenon, n’importe quoi. On l’imagine bien bouquiner des vieux romans des années 30 et se dire en s’endormant, « Tiens, ça me fait un film ça. » Du moment qu’il y a des gros sous et des secrets à saisir, il s’y connaît.
Du coup, on a l’impression que le sujet à traiter ne l’empêche pas de dormir. Il s’enfonce tranquillement dans ses drames, sûr de son rythme et de l’atmosphère qu’il installe. Pourtant il n’y a pas beaucoup de double sens à décrypter dans ses films, pas beaucoup de métaphores renvoyant à une réalité plus vaste ; tout y est. Pas question de profiter d’un fait divers flamboyant pour transformer un récit en fresque historique :
Violette Nozière (1978) échappe presque entièrement aux lois de la reconstitution ; les années 30, l’Allemagne, les « temps qui courent » occupent trois lignes de dialogues ; le reste est un portrait psychologique, un drame de famille. On ne s’aventure pas beaucoup dans un décor d’avant-guerre, on reste plutôt au plus près des acteurs.
D’ailleurs, Chabrol est moins intéressé par l’exactitude des faits que par le jeu de ses acteurs. Par le côté Isabelle Huppert de ses acteurs. Marie Trintignant dans
Betty (1992) ou Ludivine Sagnier dans
La Femme coupée en deux (2007), c’est toujours du Isabelle Huppert : des femmes tiraillées entre froideur et folie, intelligence perverse et perte de contrôle.
L’Ivresse du pouvoir (2005) commence par un avertissement ironique : «
Ce film ne prétend pas montrer une réalité connue. Toute ressemblance avec des personnalités existantes serait, comme on dit, fortuite. » En effet, la juge Charmant-Kilmann n’a pas grand chose à voir avec Eva Joly ; on comprend qu’il est question de Roland Dumas ou de Christine Devier-Joncour («
Vous l’avez habillée avec les deniers de la République, Monsieur Humeau »), mais le film prend bien soin de ne jamais être une explication de l’Affaire Elf (ce qui n’a pas plu à la vraie Eva Joly). À la place, on suit plutôt des personnages têtus, acharnés. Tout le monde « sait ce qu’il fait » ou « sait où il va » dans cette histoire ; et tout le but du film est justement de faire perdre à tout le monde cette assurance, cette certitude que procure « le pouvoir ». Au lieu d’un scandale politico-financier, on est encore une fois face à un drame psychologique.

Mentionnons ici une autre égérie du réalisateur : Stéphane Audran, c’est la féminité même. Épouse de Claude Chabrol, elle promène dans la filmographie des premières années du maître – avant sa période Isabelle Huppert – une élégance mystérieuse, légèrement inquiétante, une sensualité hautaine, une cruauté gantée de velours. C’est la femme qu’on cherche à perdre, qu’on tente de coincer, et qui déborde au contraire, qui irradie et emporte le morceau. Disséquée à longueur de films par la caméra-scalpel de son mari, Stéphane Audran en sort toujours indemne, stupéfiante de force et de calme, le regard aérien, la tête haute, l’honneur sauf. Tout peut bien s’écrouler autour d’elle dans un immoralisme généralisé, elle conserve cette beauté qui crie au miracle, cette beauté qui refuse de se sentir coupable, cette beauté qui serait prête à provoquer une guerre plutôt que de se flétrir. Pas étonnant que ses personnages, une fois sur deux, s’appellent Hélène.

Claude Chabrol a le don de nous emmener dans des lieux absolument improbables, en Suisse, au fin fond de la province, dans la haute bourgeoisie lyonnaise. Pour peu qu’on ne voie pas ces films, on ignorerait tout à fait l’existence de ces gens-là. Dans
Rien ne va plus (1997), on commence dans un casino sans nom de la côte d’Azur (j’imagine), on part brusquement à Sils Maria et on finit en Guadeloupe. Vous en connaissez d’autres, des films qui se passent à Sils Maria ou en Guadeloupe ? Cette façon de nous dire « Tout ça est à l’évidence complètement faux, mais vous allez y croire quand même » donne du panache au cinéma de Chabrol ; même mauvais, ses films poussent l’exploration du monde jusqu’à l’absurde. Nathalie Baye en femme politique (
La Fleur du mal, 2002) ou Jacques Dutronc en pianiste virtuose (
Merci pour le chocolat, 2000), a priori on n’y croit pas deux secondes ; et pourtant Chabrol n’hésite pas, ne fléchit pas. On le suit un peu dubitatif, puis on oublie le réalisme et on est ébloui par la qualité de la mise en scène, qui efface après elle les indigences du scénario. Une certaine idée du savoir-faire.
Jean-François Delpit