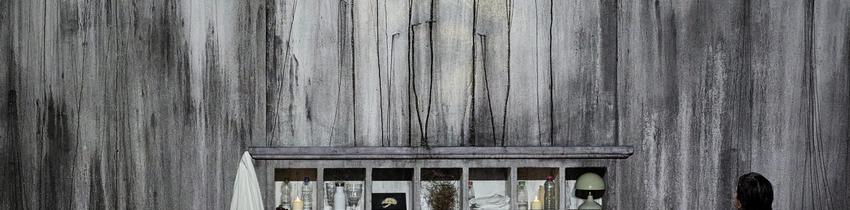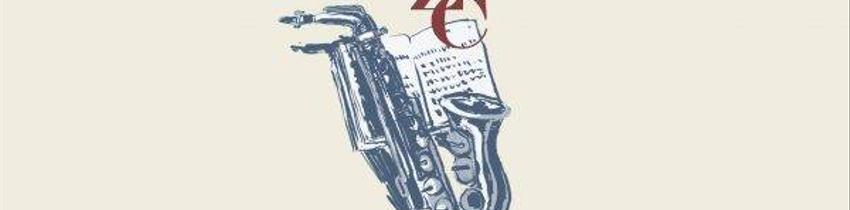Film énigmatique et captivant, Chili 1976 met en scène l’histoire politique à travers le regard d’une femme dont le quotidien se trouve soudainement bouleversé. Manuela Martelli signe un premier long-métrage stupéfiant de maîtrise et de tension.

Chili 1976 est en ce sens un film étrange. Tout semble nimbé d’une ambiance de peur et de terreur latente, comme si une catastrophe pouvait s’abattre à chaque instant sur la vie des protagonistes. Or, la catastrophe, ou du moins le risque, est d’emblée donné dans le titre du premier long-métrage de Manuela Martelli. La date clairement annoncée peut faire croire que le film consistera en une chronique politique de la vie et de la résistance chilienne sous la dictature de Pinochet, arrivé au pouvoir après un coup d’Etat en 1973. Il n’en est rien. Au contraire, c’est bien plutôt au rythme de la rénovation de la maison de vacances que le film se déploie. Carmen dirige les travaux, accueille ses petits-enfants, dresse une liste de courses à l’aide de sa cuisinière. Toute une vie préservée de la violence du régime de Pinochet, une vie bourgeoise, se déroulant presque à l’écart du tumulte du monde. De manière révélatrice, le nom même de Pinochet n’est jamais cité — ou alors incidemment par la voix d’un présentateur de journal télévisé, émanant d’un poste qu’on avait laissé allumé.
Un thriller psychologique
Pour Carmen, tout bascule presque sans qu’elle ne s’en rende compte, lorsque le vieux prêtre du petit village de bord de mer où se trouve sa maison de vacances lui demande de s’occuper d’un jeune homme blessé qu’il cache chez lui. Elle accepte, sans comprendre. Le jeune homme n’est pas un bandit — du moins pas un bandit pour tout le monde. Il a une plaie à la cuisse, qu’on comprend vite causée par une arme à feu. À compter de ce moment-là, l’existence de Carmen se dédouble pourrait-on dire, et la mise en scène de Manuela Martelli travaille à isoler le personnage des êtres et des choses qui l’entourent. La caméra se fait subjective et semble s’approcher toujours plus près du visage de cette femme, de plus en plus happée par une responsabilité qui la dépasse. Car Carmen s’occupe volontiers du jeune homme blessé. Il est hirsute, hagard, il boîte et n’a sans doute pas encore vingt ans. La cause de sa blessure et la raison de son combat ne seront jamais réellement révélés, mais on les devine trop bien : il s’oppose au régime de Pinochet. Son histoire personnelle importe peu. Car ce qui intéresse Manuela Martelli est bien plutôt ce que symbolise l’irruption de ce jeune homme dans la vie de Carmen. Son existence bourgeoise, rythmée par les déjeuners en famille et les jeux avec les enfants, se trouve non seulement bouleversée, mais prend alors un sens nouveau.
Le spectateur se surprend à trembler avec Carmen, comme si la violence sourde de ce pays soumis à l’arbitraire d’une dictature ignoble venait nous saisir le bras de sa main gantée de fer.
Dès lors, le rythme du film oscille perpétuellement entre une torpeur dans laquelle se meut toute la famille de Carmen, et l’inquiétude qui saisit peu à peu cette dernière. Elle est soudainement plus méfiante, plus étrangère aux habitudes de sa famille. Il lui faut trouver des antibiotiques et des antalgiques pour soigner le jeune blessé. Tout cela sans éveiller l’attention de personne. Ce sont alors les coups de téléphones discrets qu’il faut passer, les médicaments qu’il faut réclamer à l’hôpital prétextant que c’est pour son chien, et des rendez-vous dans des villages exilés pour que quelqu’un puisse venir chercher le jeune blessé afin de le mettre à l’abri. Tout cela confère à Chili 1976 une dimension de thriller psychologique où le personnage de Carmen se trouve peu à peu emporté dans un tourbillon de doutes, d’inquiétudes et de hantises. La subtilité du film est en ce sens de faire naître ce sentiment d’étrangeté alors même que Carmen ne quitte presque jamais sa maison de vacances. Les lieux mêmes en deviennent irréels. Cette maison face à l’océan, prétendument éloignée et préservée des heurts de la révolte contre Pinochet et de la violence de son gouvernement devient paradoxalement l’endroit où les tumultes de l’histoire viennent percuter de plein fouet la vie paisible d’une femme jusqu’ici peu concernée par la politique.
L’histoire et l’individu
L’intérêt de Chili 1976 est ainsi de réaliser d’un seul et même mouvement un film sur la violence sourde et l’impossible liberté de conscience dans le Chili de Pinochet, ainsi qu’un splendide portrait de femme. Car jamais ne seront clairement énoncés les motifs du soutien inconditionnel de Carmen à ce jeune blessé. Oisillon tombé par hasard sur le rebord de son monde paisible, ce jeune homme meurtri incarne tout ce que Carmen semble n’avoir jamais vécu — ou avoir toujours refoulé. L’engagement, le danger, la nécessité de survivre. La mise en scène n’éclaircit rien, mais travaille bien au contraire à laisser dans l’ombre les motivations profondes des personnages et les raisons de leurs agissements. La politique et l’engagement sont, pour ainsi dire, omniprésents dans le film de Manuela Martelli, mais ils ne sont présentés qu’au travers du regard de Carmen, seule et isolée au sein même de sa famille, se débattant pour soutenir une cause dont ne sait ce qu’elle pense réellement. Film à l’ambiance asphyxiante, Manuela Martelli signe avec Chili 1976 une œuvre d’une maîtrise impressionnante, tant dans la mise en scène que dans la force d’incarnation de sa protagoniste principale — incarnée par Aline Küppenheim, admirable dans le rôle de cette femme si assurée de sa démarche, et en même temps toujours prête à vaciller. Le spectateur se surprend à trembler avec Carmen, comme si la violence sourde de ce pays soumis à l’arbitraire d’une dictature ignoble venait nous saisir le bras de sa main gantée de fer.
Chili 1976, un film de Manuela Martelli, avec Aline Küppenheim, Nicolás Sepúlveda, Hugo Medina, Alejandro Goic. En salles le 22 mars.