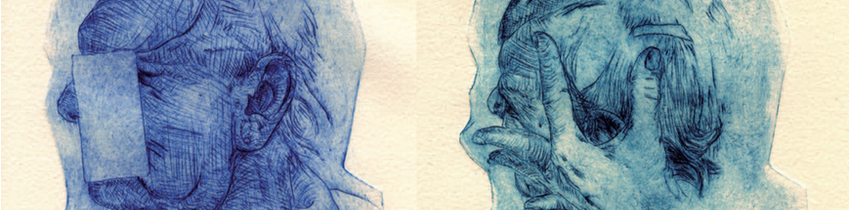La littérature peut-elle sauver les États-Unis ? À l’occasion de l’investiture de Trump, nous proposons un panorama de la littérature américaine contemporaine. Alors que le président est reconnu pour son mépris des minorités, les auteurs noirs-américains, amérindiens, d’origine asiatique, africaine ou latine occupent une grande place dans les lettres états-uniennes. De Lauren Groff à Stephen Markley, les écrivains américains leur donnent une voix et témoignent de la multiplicité de ce pays.
Chimamanda Ngozi Adichie est une célébrité dans le monde anglophone. Ses conférences TED ont été visionnées des millions de fois sur internet, on entend l’extrait d’un de ses discours dans une chanson de Beyoncé, et son slogan, « We should all be feminists » a été imprimé sur les T-shirts d’une marque de luxe bien connue. Mais il serait dommage que ce succès médiatique fasse oublier qu’elle est d’abord, et surtout, une remarquable écrivaine.
Issue d’une famille igbo[1] plutôt aisée, Adichie a grandi à Nsukka, ville universitaire du sud du Nigéria qui revient sans cesse dans ses récits, avant de partir faire ses études supérieures aux États-Unis. Bien qu’elle vive aujourd’hui entre les deux pays, elle n’a jamais adopté la nationalité américaine et se définit elle-même comme une autrice nigériane. Ce choix n’a rien d’anodin lorsque l’on considère l’importance qu’elle accorde à la question de l’identité, laquelle nourrit l’ensemble de son œuvre. Je me concentrerai ici sur ses principales œuvres de fiction, à savoir son recueil de nouvelles Autour de ton cou et ses trois romans.
Le premier, L’Hibiscus pourpre, raconte l’histoire d’une adolescente sous la coupe d’un père tyrannique membre d’une secte religieuse catholique. L’Autre moitié du soleil est une vaste fresque épique nous plongeant dans la guerre du Biafra (1967-1970) à travers le destin de sœurs jumelles. Enfin, Americanah, paru en 2013[2], est l’histoire contemporaine de deux étudiants qui partent vivre à l’étranger, elle aux États-Unis et lui en Grande-Bretagne.
Une écriture politique
Si, au fil de ses histoires, on rencontre une galerie très diverse de personnages, des hipsters américains aux expatriés anglais de Lagos en passant par les Haoussas et les Yorubas – deux ethnies d’Afrique de l’Ouest – ses héroïnes sont souvent, comme elle, des femmes nigérianes et igbos.
Ses textes fonctionnent comme des fenêtres ouvertes sur la vie de ces femmes.
Pourtant, les similarités s’arrêtent là. Car l’assurance et la sagacité d’Ifemelu, l’héroïne d’Americanah, tranchent avec la timidité et l’inexpérience de Kambili dans L’Hibiscus pourpre ou le caractère passionné d’Olanna de L’Autre moitié du soleil. Et c’est sans doute l’une des clés de l’écriture d’Adichie, ce qu’elle explique dans sa conférence Le danger d’une histoire unique[3] : « Le problème avec les stéréotypes n’est pas qu’ils sont faux. C’est qu’ils sont incomplets. » À travers ses personnages, elle exprime en effet la diversité des expériences et des vécus au sein d’un groupe qui peut, de l’extérieur, sembler homogène. Ayant constaté la pauvreté des représentations occidentales concernant les cultures africaines, elle choisit d’explorer la richesse et les ambivalences de celle qui lui est le plus familière, la sienne. Son projet est politique, sans �être didactique.
En cela, elle se distingue de toute une tradition littéraire, dont l’exemple le plus emblématique est sans doute Zola, mais qui existe toujours aujourd’hui, laquelle consiste à écrire ses personnages comme l’incarnation du milieu dans lequel ils évoluent : l’ouvrière, l’agriculteur, la prostituée, le patron et ainsi de suite. Empêtrés dans leurs déterminismes de classe, leur destin est souvent régi par une forme de fatalité sociale, et leur libre arbitre réduit.
Chez Adichie, une logique très différente est à l’œuvre. Cela est particulièrement frappant dans son recueil Autour de ton cou ; toutes les nouvelles, à l’exception d’une[4], racontent l’expérience d’une femme, nigériane et igbo, parfois dans son pays natal, parfois aux États-Unis. Ces textes fonctionnent comme des fenêtres ouvertes sur la vie de ces femmes. Ils montrent comment chacune d’entre elles, face à des enjeux souvent similaires, trouve ses propres réponses. Si la plupart d’entre elles sont par exemple confrontées à une forme de violence patriarcale, à travers leur mari, leur famille, leur employeur, elles y réagissent chacune de manière différente. Certaines l’acceptent, parce qu’elles n’ont pas les ressources nécessaires pour faire autrement. D’autres s’y opposent frontalement, par leurs paroles ou par leurs actes. D’autres encore résistent par des moyens détournés, parfois radicaux. Bien que l’on puisse supposer qu’Adichie s’identifie plus à certaines de ses héroïnes qu’à d’autres, son écriture ne laisse aucune place au commentaire, s’appliquant seulement à rendre compte de la rencontre entre un contexte et un individu. La récurrence des thèmes permet aux différents récits de s’enrichir mutuellement, chacun ajoutant une nouvelle nuance, une nouvelle piste de compréhension à l’ensemble.
Se réapproprier l’histoire
De la même manière, dans ses romans, les narrations sont éclatées entre plusieurs époques, plusieurs territoires, créant sans cesse des échos et des dissonances. Les personnages fonctionnent souvent en miroir, comme dans L’Hibiscus pourpre, où le père fanatique de Kambili s’oppose à la tante, Ifeoma, elle aussi catholique, mais qui pratique sa religion avec générosité et bienveillance. Ifemelu, dans Americanah, s’intègre avec succès à la société américaine, mais le séjour d’Obinze à Londres est marqué par les déceptions et les humiliations. Si cette écriture laisse peu de place à un jugement moral, l’empathie y joue au contraire un rôle central. Les héros construisent leur vie en tâtonnant, jonglant avec les circonstances particulières auxquelles ils sont confrontés, les hasards, et des choix personnels parfois discutables, mais toujours compréhensibles.
C’est à travers leurs yeux, plutôt qu’en adoptant une posture surplombante, qu’Adichie évoque d’une manière particulièrement nuancée et lucide les sociétés qu’elle connaît. Du Nigéria, elle décrit les aspects les plus sombres : la violence, la corruption, les tensions ethniques, les profondes inégalités sociales. L’Hibiscus pourpre, qui se situe dans les années 1980-1990, raconte ainsi avec une implacable sobriété l’instabilité politique de cette période, la terreur de la population, les assassinats de journalistes. Mais, dans le même temps, l’autrice rend hommage à tout ce qui fait la beauté et la spécificité de la culture postcoloniale dans laquelle elle a grandi, avec ses influences contradictoires. Bien que ses livres soient écrits en anglais – la langue officielle du Nigéria – les dialogues sont ponctués de mots igbos. Elle s’attache à décrire la nourriture, les vêtements, les coutumes, les croyances et les fêtes traditionnelles, aussi bien que la posture rationaliste des élites formées dans le monde anglo-saxon, ou les pèlerinages dans des villages où l’image de la Vierge est apparue.
Ce faisant, elle a conscience de s’adresser à un lectorat à la fois nigérian et international, dont une partie connaît mal, ou pas du tout, l’histoire de son pays. À ce titre, ses livres jouent un rôle double : montrer à ses compatriotes qu’ils peuvent exister en littérature au même titre que les Occidentaux, et bousculer les conceptions simplistes de ses lecteurs étrangers.
À ce titre, ses livres jouent un rôle double : montrer à ses compatriotes qu’ils peuvent exister en littérature au même titre que les Occidentaux, et bousculer les conceptions simplistes de ses lecteurs étrangers.
L’Autre moitié du soleil perpétue la mémoire des victimes de la guerre du Biafra, et particulièrement de la communauté igbo, qui fut la plus durement touchée. Mais il s’agit surtout de se réapproprier une histoire dont la couverture médiatique en Occident s’est souvent limitée à des publications sensationnalistes : ces photos d’enfants mourant de faim, atteints par le kwashiorkor. L’un des personnages interpelle ainsi le lecteur étranger : « Les photos s’étalaient dans les pages luxueuses de ton Life. Les as-tu vues ? As-tu eu de la peine, un instant, avant vite d’enlacer ta femme, ton amant ? […] Des enfants nus qui riaient, comme si l’homme n’allait pas prendre ses photos et puis partir, les laissant. » Dans ce livre bouleversant, Adichie revient sur les causes de cette guerre mal connue, les massacres, les camps de réfugiés, mais rappelle aussi l’espoir, les idéaux, qui ont mené à la création de cette nation éphémère. Elle donne la parole aux poètes, aux universitaires, aux militants séparatistes ou panafricanistes. « Je suis nigérian parce que l’homme blanc a créé le Nigéria et m’a donné cette identité. […] Mais j’étais igbo avant l’arrivée de l’homme blanc. » dit Onedigbo, le compagnon d’Olanna. Se pose aussi avec acuité la question du témoignage, de la légitimité : qui a la possibilité de raconter sa version des faits ? Qui est écouté ? L’amant de la sœur d’Olanna, le britannique Richard, tente d’écrire un livre sur le Nigéria sans trop savoir comment s’y prendre. Bien qu’il traverse lui aussi la guerre, il a conscience que ce combat, cette histoire, ne sont pas entièrement les siens – et la manière dont ce dilemme finit par être résolu est très symbolique.
Rendre aux oubliés de la littérature leur droit à la parole
C’est avec la même finesse qu’Adichie se penche sur les États-Unis d’aujourd’hui dans Americanah. Si le cadre peut paraître moins exotique à un lecteur européen, le regard qu’elle porte sur cette culture est d’une grande originalité. On apprend dès le début du récit que son héroïne, Ifemelu, vit aux États-Unis depuis quinze ans et en a assimilé tous les codes. Cependant, elle conserve un recul critique salutaire vis-à-vis de son pays d’accueil. Se définissant elle-même comme « une Noire non-américaine », elle tient un blog dans lequel elle partage ses observations sur les questions raciales auxquelles elle est confrontée depuis son arrivée. Avec humour et franchise, Ifemelu y analyse ce qu’elle appelle le tribalisme américain, fondé sur « la classe, l’idéologie, la région, et la race ». Elle raconte comment elle est « devenue » noire en Amérique, se retrouvant soudain dans la posture d’une minorité discriminée. Ironique, parfois mordante, elle montre toutefois un grand attachement vis-à-vis de son pays d’accueil – ce qui ne l’empêchera pas de revenir, plus tard, vivre au Nigeria.
Sa place d’outsider revendiquée lui permet d’élever une voix discordante et singulière dans des débats marqués par les certitudes, les idéologies clivées. Si elle dénonce le racisme de certains, elle garde aussi une distance amusée vis-à-vis de la gauche libérale, et notamment celle des Noirs américains. Elle découvre leurs convictions, leur rigidité morale, avec une sorte d’incrédulité attendrie. « Ils regardaient le monde avec un sérieux lumineux, utopique, qui l’émouvait sans jamais la convaincre », écrit Adichie. Elle ne voit pas pourquoi elle devrait refuser lorsqu’une femme blanche lui demande dans la rue si elle peut toucher ses cheveux, ou pourquoi elle devrait aller à toutes les manifestations auxquelles son petit ami se rend. Elle ne partage pas toutes ses indignations. Certaines lui sont étrangères, parfois même incompréhensibles. A ce propos, elle écrit : « il s’attendait à ce qu’elle éprouve des sentiments inconnus d’elle. »
La plupart du temps, plutôt que de se focaliser sur des théories abstraites, universitaires, Ifemelu préfère parler de ses problèmes du quotidien. C’est dans ces détails que se joue vraiment son expérience ; elle raconte par exemple la manière dont elle commence par imiter l’accent américain pour s’intégrer, avant de revenir délibérément à son accent nigérian. Si, dans la version originale du texte, Ifemelu s’exprime de manière très américaine sur son blog, l’élégante prose d’Adichie est d’ailleurs beaucoup plus nigériane – le vocabulaire et les expressions employées sont très différents. Comme son héroïne, Adichie montre ainsi qu’elle maîtrise parfaitement le style américain, mais choisit de rester fidèle à l’anglais qui est parlé chez elle, dans sa version la plus littéraire.
Être une femme dans notre monde, chez Adichie, est toujours un mélange de lutte pour l’indépendance et d’inévitables compromis.
La question des cheveux est aussi capitale dans le roman : aux États-Unis, simplement garder ses cheveux naturels pour une femme noire signifie être aussitôt cataloguée comme subversive, rebelle. Pourtant, s’indigne Ifemelu, leur donner un aspect plus européen est un processus coûteux, compliqué et douloureux, qui consiste à utiliser des produits souvent toxiques. Dans son blog, elle affirme que, bien qu’elle admire Michelle Obama, elle est convaincue que Barack Obama n’aurait jamais été élu si celle-ci ne se lissait pas les cheveux. L’importance qu’Adichie accorde à ces questions est le meilleur témoignage de son féminisme, pragmatique mais sans concessions. Comme son héroïne, elle ne cache pas son amour pour la mode, un sujet considéré futile. Le passer sous silence alors qu’il constitue une part si importante de son identité serait pour elle une forme d’hypocrisie. Elle refuse de se censurer elle-même en considérant qu’elle doit afficher des intérêts plus typiquement masculins pour être crédible. À ses yeux, le féminisme idéal n’existe pas, et les injonctions normatives, souvent paralysantes, ne peuvent s’appliquer à toutes et en toutes circonstances. Elle le montre aussi dans les très belles pages qu’elle consacre à la sexualité féminine, des premiers émois adolescents de Kambili dans L’Hibiscus pourpre à l’évolution d’Ifemelu dans Americanah. Encore et toujours, sur ces sujets, elle choisit de laisser la place à l’ambiguïté, aux paradoxes, et au désordre. Être une femme dans notre monde, chez Adichie, est toujours un mélange de lutte pour l’indépendance et d’inévitables compromis.
La fiction devient ainsi pour l’autrice le meilleur outil de la lutte pour le changement. Elle lui permet de toujours contextualiser son propos, de montrer qu’il n’y a pas une manière unique de vivre le racisme, le sexisme, les inégalités sociales, la violence politique. Et en fin de compte, elle ne dicte jamais à son lecteur ce qu’il doit penser. Comme elle l’explique dans Le danger d’une histoire unique, son objectif est en effet moins de défendre une thèse que de rendre aux oubliés de la littérature leur droit à la parole, leur complexité et leur dignité – une entreprise qu’elle mène à bien avec un talent magistral.
[1] S’écrit aussi Ibo. Ethnie du sud du Nigéria. Le grand écrivain nigérian Chinua Achebe, l’une des références d’Adichie, est également igbo.
[2] 2015 pour la traduction française
[3] https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg
[4] La nouvelle Fantômes est écrite du point de vue d’un homme