En cette quatrième journée de festival, on s’interroge sur les pouvoir de la parole et du silence pour faire surgir des images. Les voix sont muettes pour laisser être les animaux dans Homing et Modèle Animal, suggestives et poétiques dans Tú me abrasas, issues d’une mémoire militante dans Les mots qu’elles eurent un jour et La Laguna del Soldado
- Homing, Tamer Hassan (États-Unis, Brésil, 2023) / Modèle Animal, Maud Faivre et Marceau Boré (France, 2024)
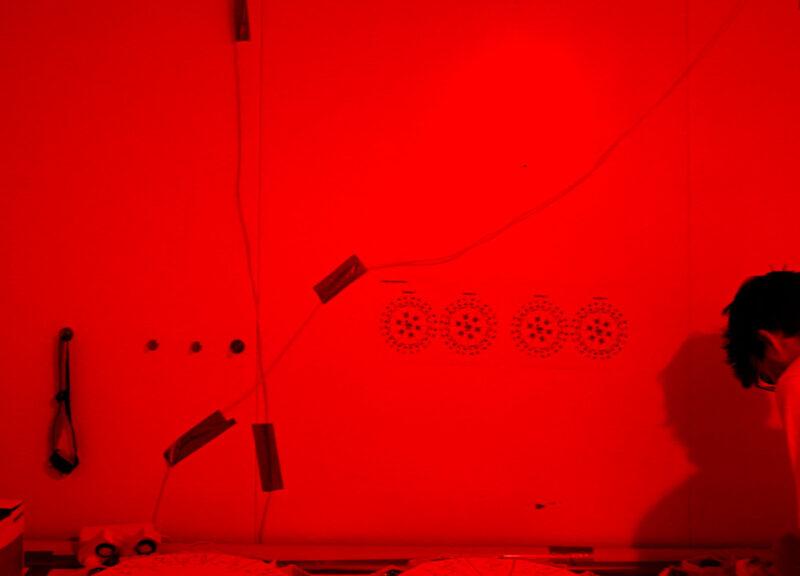
Pour ce programme de courts et moyen-métrages, la sélection a eu l’excellente idée de réunir deux films qui conversent entre eux et traitent de notre rapport aux animaux. Dans Homing, la caméra de Tamer Hassan suit la migration des hirondelles noires en Amérique. Deux régimes d’images participent à ce mouvement : des très gros plans, concentrées majoritairement sur la main humaine, en train de recueillir ces oiseaux dans la forêt ou de dépecer un de leurs cadavres ; et des plans beaucoup plus larges, toujours à échelle humaine, mais qui regardent vers le ciel, le ballet des nuées d’hirondelles. Aucun mot ne sera prononcé, on perçoit simplement un hypnotisant bruit d’ambiance, Homing provoque un certain apaisement devant ces mains qui travaillent, ces centaines d’animaux qui parcourent le ciel. Pourtant un propos semble se nicher au sein de ce court-métrage aux allures contemplatives : la mise en avant du travail des ornithologue dans la survie de l’espèce.
Modèle Animal suit d’autres scientifiques au sein d’une large structure qui étudie le comportement des animaux et, principalement des insectes. Si l’approche des cinéastes est d’abord phénoménologique, un certain malaise s’installe lorsque l’on assiste au traitement de ces animaux, mis en tubes et placés dans des situations que l’on imagine inconfortables, ils semblent presque maltraités. Mais il serait hypocrite de jeter l’opprobre sur ses chercheurs quand on sait combien il est souvent nécessaire d’expérimenter sur ces animaux pour faire progresser la science. Une scission se crée entre l’homme et son impact sur la nature : son appétit pour le savoir passe inévitablement par une forme de violence. Cependant, il est regrettable que les réalisateurs peinent à filmer avec grand intérêt les insectes, la caméra les surplombant en permanence, ne sachant jamais comment descendre à leur échelle. Les quelques images expérimentales qui proviennent des expériences sont trop courtes, trop peu nombreuses, et le film a du mal à se détacher de sa posture scientifique pour pleinement admirer ces êtres fascinants.
Théodore Anglio-Longre
Prochaine projection le vendredi 29 mars à 16h, Cinéma 1, Centre Pompidou.
- Tú me abrasas, Matias Piñeiro (Argentine, Espagne, 2024)

Tú me abrasas s’inspire du chapitre « Écume de mer » des Dialogues avec Leuco de Cesare Pavese, dans une perspective poético-antique que l’on peut rapprocher un peu trop étroitement du travail de Danièle Huillet et de Jean-Marie Straub voire de Jean-Luc Godard. Les voix, les corps de la poétesse lesbienne Sappho et de la nymphe Britomartis errent dans la ville et sur le rivage, interrogeant leur rapport au désir autour de pages lues et soulignées. Le refrain du titre (« Tu me brûles ») scande le film au gré de quelques séquences frénétiques, brèves et rythmées.
Ses syllabes en sont alors ânonnées sur fond d’images raccordées de manière abrupte, évoquant implicitement l’œuvre de la cinéaste surréaliste Maya Deren : une main cherche à ouvrir la porte d’un immeuble, un doigt presse agressivement le bouton d’un interphone, de l’eau coule dans un évier. À la fin, toutefois, la tentative d’élaborer le poème sapphique du futur par la reproduction de ce dispositif se heurte à une impasse : comment représenter la poésie dans l’image autrement que par la représentation de l’activité de la lecture ou bien par le collage sous forme de cadavre exquis de plans divers, soit la translation d’un procédé surréaliste au fond très spécifique ? Si le film achoppe en partie sur cette question et se ressent de ses influences, il se sauve par la richesse de l’entrelacement entre son et image. De façon fidèle à la nature orale de la poésie antique, les voix, qu’elles lisent, dialoguent, laissent des messages vocaux, mènent les séquences et entraînent à leur suite les plans. Le point de poésie le plus saillant du film se niche dans ces téléphones qui guident certains échanges entre Sappho et Britomartis et leur confèrent une force incantatoire. Mathias Piñeiro sort alors temporairement de l’impasse et adapte la touche Huillet/Straub aux temps présents. Qu’est-ce que la poésie ? Peut-être moins la création d’images que le désir brûlant de se consumer en paroles.
Hélène Boons
- Les mots qu’elles eurent un jour, Raphaël Pillosio (France, 2024)

Un groupe de femmes en noir et blanc. Jeunes. Les cheveux courts, ramenés en arrière ou en chignon, des verres fumés, des broches et des colliers, des cigarettes entre les doigts. Elles sont assises à même le sol dans une grande pièce, amassées les unes contre les autres, et elles parlent. Que disent-elles ? La bande sonore est absente, « perdue à jamais » indique la fiche technique de ce court document de 1962, tourné à la libération de ces femmes par Yann Le Masson. Qui sont-elles ? Militantes, agentes de liaisons, poseuses de bombes en tailleurs et chemisiers. Torturées, emprisonnées, condamnées à mort ou à perpétuité. Raphaël Pillosio en a retrouvé certaines. Cinquante ans après, elles regardent les images, elles se souviennent ou essaient. « Elle je la connais, mais je ne sais pas comment elle s’appelle » ; « Fatima, on l’appelait Fatété » ; « son nom de famille je ne sais plus ». Dans des appartements où monte l’appel du muezzin et la rumeur des rues d’Alger, dans une arrière-boutique ou dans une salle de réunion, celles qui sont devenues sénatrices, pharmaciennes ou journalistes regardent avec tendresse les rebelles qu’elles ont été. Avec amertume aussi, car l’avenir n’a pas tenu les promesses de 1962. « Les hommes ont peur de la femme qui a fait la révolution. »
Quels sont donc les mots qu’elles eurent ce jour ? On lit sur les lèvres. Elles parlaient de condition de la femme, de travail, de liberté, de révolution. Elles étaient jeunes et libres. Elles sortaient tout juste de prison et se tenaient par les épaules, serrées les unes contre les autres, comme des sœurs. Les images défilent, encore et encore, obstinément muettes. « Ces images, c’est tout ce qui restera d’elles. »
Tristan Tailhades
Prochaine projection le vendredi 29 mars à 18h30, FDI 300.
- La Laguna del Soldado, Pablo Álvarez-Mesa (Colombie, Canada, 2024)

Un épais brouillard glisse le long d’une colline, accompagnant la fuite d’un cours d’eau qui serpente entre les tourbières tandis qu’une tempête noire menace des montagnes emplies d’une « profonde tristesse ». Mais contrairement à ce que cette atmosphère romantique laisse penser nous ne nous trouvons pas aux abords d’un lac écossais jouxtant un château gothique abandonné. Nous sommes en Colombie, plus précisément dans le páramo de la cordillère des Andes. C’est dans ces contrées immenses où l’homme ne pose que rarement le pied que le réalisateur montréalais d’origine colombienne Pablo Álvarez-Mesa a fixé sa caméra, captant la beauté aride et désertique de ses paysages grandioses à travers de longs plans fixe et d’élégants fondus enchaînés.
Si les humains sont en grande partie absents de l’écran (exception faite d’un chauffeur de taxi, d’une scientifique…) ce sont les fantômes qui peuplent La Laguna del Soldado, notamment celui de Simon Bolivar qui ouvre le film par le poème « Mi delirio sobre el Chimborazo », accompagné du grondement sous-marin des luttes politiques de la campagne de libération. En juin 1819 les soldats d’El Libertador traversent les hauts plateaux de la cordillère Orientale par la voie du páramo de Pisba. Une centaine d’entre eux y laissera la vie dans un lagon transformé en cimetière naturel, celui même qui donne son nom au film. Fort d’expérimentations formelles amalgamant les sons et les couleurs dans un montage alternant les voix déchirées du passé et les revendications politiques des populations autochtones, le film constitue tout autant un plaidoyer pour la justice environnementale, sociale et raciale ; qu’une symphonie aquatique et contemplative, rythmée par l’écoulement des cours d’eau sur les roches ou le son mat de la pluie rebondissant sur les tiges des frailejones.
Sylvain Métafiot
Prochaine projection le samedi 30 mars à 16h au MK2 Beaubourg
Les journaux précédents :

















