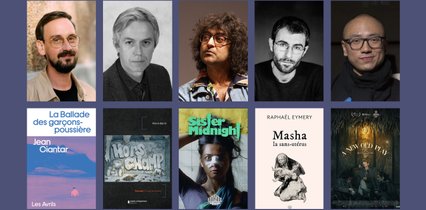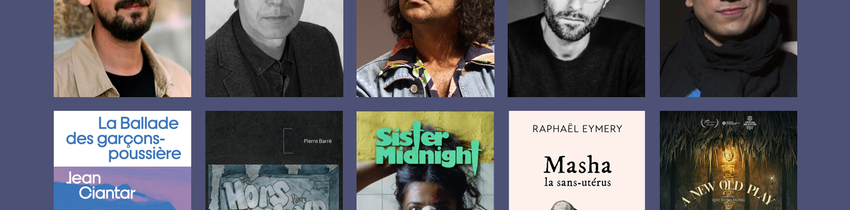En cette nouvelle journée, un grand nombre de films aux sujets très différents. Pêle-mêle, des feux d’artifices hypnotiques, les déambulations d’une jeune russe en plein Monaco sous la caméra de Virgil Vernier, un mystérieux projet au cœur du désert de Gobi, l’exil d’un afro-américain vers Cuba, un innocent Kurde emprisonné, et même des mails sans réponse adressés à John Rambo.
- Light, noise, smoke, and light, noise, smoke, Tomori Nishikawa (Japon, États-Unis, 2023) / Gama, Kaori Oda (Japon, 2023)

Écran noir. Light, noise, smoke & light, noise, smoke est à prendre très littéralement : ce court-métrage de six minutes consiste en une alternance de gros plans de feux d’artifices, dont la vitesse et le son ont été ralentis. Entre les ronrons réguliers et distordus, des points de couleurs, des traînées de fumée zébrent le ciel. Au fur et à mesure, Tomonari Nishikawa semble presque nous placer au fond de la mer, entre le bruit du ressac et les bras des méduses. Un spectacle hypnotique – si vous aimez les feux d’artifice – à garder sous les paupières.
Écran blanc. Un trop-plein de lumière avant de s’enfoncer dans la grotte – Gama en japonais – où, en 1945, 83 civils japonais se sont suicidés par peur d’être capturés par l’armée américaine. Dans l’obscurité parfois totale, un guide nous transmet l’histoire de cette grotte mais aussi de toutes les autres, car elles sont nombreuses dans la région, et des civils qui s’y sont réfugiés. Il raconte l’entraide, la peur, la perte. À travers de longs plans fixes, le réalisateur Kaori Oda laisse toute la place à ces récits, dans une volonté évidente de transmission. La démarche est émouvante. Malheureusement, Gama ne prend pas tout à fait la peine d’exister en tant qu’objet filmique et se laisse reposer sur la parole ininterrompue du conteur. Pour tenter de palier ce manque, une femme en robe bleue erre dans la grotte, comme un symbole maladroit du rapport entre passé et présent. Le sentiment d’assister à une visite guidée nous quitte cependant brièvement vers la fin du film, grâce à une image saisissante. Filmée en gros plan, une plage de coraux blancs amassés et emmêlés devient un vaste charnier d’os. Pensive, la femme en bleu les égraine, le passé perceptible sous ses doigts.
Pauline Ciraci
Prochaine projection le vendredi 29 mars, 18h30, Centre Pompidou, salle 1.
- Under a blue sun, Daniel Mann (Israël, France, 2023)

Pour Sylvester Stallone, le désert du Naqab ressemble à s’y méprendre à l’Afghanistan. Le tournage de Rambo III a eu lieu moyennant une petite entourloupe géographique. L’essentiel était de croire à la réincarnation de Lawrence d’Arabie à la conquête des dunes et des imaginaires. La supercherie au nom de la production d’images spectaculaires destinées à divertir un spectateur aliéné sert ici de cas d’école pour analyser la colonisation comme une réécriture fantasmée de l’histoire. Le gouvernement israélien, comme les Américains envahissant le Vietnam en leur temps, s’est approprié les terres qui appartenaient aux Bédouins. Et pour rendre à César – Rambo, toujours – ce qui est à César, le cinéaste propose de s’entretenir avec Bashir, l’homme chargé des effets spéciaux sur le tournage. Car si Bashir connaît des anecdotes savoureuses et possède des photographies inédites, il est surtout le dépositaire d’une mémoire qui a été usurpée et qui est bien plus ancienne que la création de l’État hébreu. Daniel Mann donne également la parole aux activistes d’aujourd’hui qui tentent de s’opposer à la destruction des villages non reconnus en filmant les bulldozers. Ainsi, les imaginaires coloniaux se croisent et se nourrissent les uns des autres, faisant apparaître les images du documentaire comme dissidentes. Les témoignages actuels et les récits d’antan sont entrecoupés de mails que le réalisateur adresse à Stallone pour lui expliquer ce qu’il a refusé de comprendre et lui exposer les implications du tournage d’un film de propagande militariste dans le contexte du siège de Beyrouth. Évidemment, Under a blue sun tombe à propos au jour 174 de la guerre Israël-Hamas. Reste que le discours analogique et l’hommage rendu à la culture bédouine tendent à se confondre (ce qui est aussi lié à l’étroitesse du territoire concerné) et à affaiblir la charge critique du propos. De bout en bout, il est question de cinéma faussaire auquel il faudrait rendre sa force de dévoilement mais les appels adressés à John Rambo demeurent sans réponse.
Marthe Statius
Prochaine projection le vendredi 29 mars à 13h15, Mk2 Beaubourg.
- Ozr el wezzah, Mahdy Abo Bahat et Abdo Zin Eldin (Egypte, Royaume-Unis, 2023) / Imperial Princess, Virgil Vernier (France, 2024)

Des chants et des musiques soufis dont la transe contamine le plan, une jeune femme qui se filme en dansant dans le miroir tandis que son smartphone accompagne ses pirouettes. Les deux courts-métrages que le festival a choisi de réunir forment un programme hypnotique. Ozr el wezzah est le premier film de deux étudiants égyptiens. Son geste accompagne l’épure de son propos : un homme mystérieux pénètre un village et demande à un vieux paysan de lui raconter ses rêves. Mais ces choses-là ne se racontent pas et le vieil homme prétend faire des rêves normaux. Superstition et prophétie se murmurent au creux de plans où la caméra essaie timidement de prendre place. Souvent statique voire très éloignée de son sujet, elle libère quelque chose d’étrange, un esprit qu’elle aurait capturé. Progressivement caméra et présence ésotérique vont de pair, cherchant à s’inscrire parmi les hommes de cette communauté, jamais déstabilisés par celles qui pénètrent leur univers. Alors le réel et le sacré se fondent dans un film en forme de poème incantatoire.
En marge de la réalisation de son prochain long-métrage, Virgil Vernier réalise Imperial Princess, titre qu’il emprunte au nom d’un yacht et qui célèbre déjà la fille d’un oligarque russe. Iulia a 23 ans. Suite aux sanctions, son père est contraint de retourner en Russie. La jeune fille a choisi de rester à Monaco. Vêtue de ses oripeaux, elle campe un appartement vide avec vue imprenable sur les tours. Derrière, on aperçoit les montagnes qui dissimulent le monde qui existe par-delà ce sordide royaume maculé de joyaux. Iulia est seule et filme ses promenades tandis que ses obsessions occupent la voix-off – des caméras cachées, des messages menaçants, des fruits empoisonnés aux arbres de la ville. La jeune femme est menacée mais elle reste volontiers prisonnière. Son monde est là, elle n’en connaît pas d’autre. Les couronnes et autres parures défilent. Filmées sur un écran, elles s’annulent à mesure qu’elles s’accumulent, ersatz du beau devenus de simples représentations de ce dont rêvent les jeunes filles. Plus rien n’est désirable dans ce cauchemar. Filmé en caméra-subjective, ce lugubre quotidien monégasque étouffe. Seuls demeurent les miroirs comme promesse d’échappatoire.
Anastasia Marchal
Prochaine projection le samedi 30 mars à 15h, Forum des Images.
- On the battlefield, Ray Whitaker, J.P. Sniadecki, Lisa Marie Malloy, Theresa Delsoin (États-Unis, 2024) / The Periphery of the base, Zhou Tao (Chine, 2024)

Du sud de l’Illinois au désert de Gobi, on voit une même éternelle bande de terre hostile avec un point de fuite insaisissable. Curieusement, les deux films partagent un geste : celui de rendre compte d’un non-lieu – des champs plats où vivait la communauté noire d’une ville près du Mississipi dans On the battlefield, un paysage désertique en attente d’un mystérieux projet d’infrastructure dans The Periphery of the base. Le premier court-métrage est une œuvre collective. Elle est portée par trois artistes membres du groupe Little Egypt qui entreprend un travail archéologique. Il s’agit d’exhumer la mémoire des militants pour les droits civiques alors que leur monde est tombé depuis longtemps en ruine. Le souvenir émerge du son : à l’écran, on voit un homme promener sa perche dans des terrains vagues, et capter çà et là, des fragments de prêche, des bribes de discours enflammés qui furent prononcés dans les années 1960. Paradoxalement, ce champ ouvert à tous les vents ressemble à une grotte arpentée par le preneur de son qui s’improvise spéléologue. Tout au fond du trou, sous les couches de mensonge et d’oubli historique, se cache peut-être la vérité de ce que fit la communauté de Cairo.
Chez Zhou Tao, on a l’impression de marcher sur la lune, dans des paysages minéraux déshumanisés alors même qu’ils ont été façonnés par une activité agricole et industrielle frénétique. Les plans d’ensemble vertigineux ne servent pas à poser un contexte mais à écraser les individus qui paraissent microscopiques. The Periphery of the base mêle la recherche plastique au travers de formes expérimentales à l’analyse sociologique de la condition ouvrière. Lorsque le vent se lève et que la poussière jaune recouvre les silhouettes, c’est une apparition digne des Mad Max de George Miller. Que l’être humain paraît petit au lendemain de l’apocalypse !
Marthe Statius
Prochaine projection le jeudi 28 mars à 18h, bibliothèque Bulac.
- Leaving Amerika, Marie-Pierre Brêtas (France, 2024)

Chez Kafka, Amerika est synonyme d’un roman d’apprentissage, où le personnage va de catastrophe en catastrophe, pris au piège dans son propre récit et dans l’univers qu’il parcourt. Nul hasard donc si Marie-Pierre Brêtas a choisi ce terme pour nommer son documentaire qui porte sur le destin d’un homme noir aux États-Unis, Derek Johnson, un dealer repenti. Après avoir choisi, dans La Lumière des rêves, de faire le portrait de Michel Jouvet, dont le travail tout entier portait sur les rêves, elle raconte l’histoire d’un homme qui a vécu, à bien des égards, un cauchemar éveillé. Souhaitant s’y soustraire, il choisit alors une autre terre d’accueil, Cuba. Ainsi, comme beaucoup d’hommes noirs, Derek Johnson a été soumis au racisme institutionnel américain – sur le mot Amerika, plane aussi l’ombre du Klux Klux Klan –, au mépris, et à la précarité. Marie-Pierre Brêtas documente avec beaucoup de délicatesse le départ de celui s’avère être son ami. Avant de partir, Derek, qui ne possède plus grand-chose, à part sa voiture et quelques caisses d’objets entreposées dans un garde-meuble, se livre à un long inventaire. Sous la caméra de la cinéaste, il va voir sa famille, ses amis, rassemble ses affaires, et égrène ses vingt dernières années : son séjour en prison pour homicide involontaire, ses aventures de taximan, son rapport à sa famille. Si l’envers de l’american dream a beaucoup été documenté au cours des dernières décennies, et que la forme du film reste quelque peu conventionnelle, la force de Leaving Amerika tient à son personnage qui se projette à l’aube d’une nouvelle vie.
Romane Demidoff
- Remanence, Sabine Groenewegen (Pays-Bas, 2024)/Capture, Jules Cruveiller (France, 2024)

Dans Remanence, la cinéaste néerlandaise Sabine Growenewegen combine des sources imagées récemment découvertes et des cassettes vidéo pour évoquer le mouvement pacifiste féminin et antifasciste néerlandais qui opéra des années 1935 à 1939. Par un travail de collage, elle parvient à reconstituer cinq ans de luttes qui ont depuis sombré dans les abîmes de l’histoire. L’importance de Remanence tient dans son projet qui puise dans la force de ses archives et qui mêle ces voix de femmes sur un mode choral et témoignent de la frénésie d’une époque.
Dans le très ingénieux Capture, c’est au tour du réalisateur français Jules Cruveiller de retracer le destin d’un héros, qui, cette fois-ci, l’est devenu contre son propre gré. Il raconte la manière dont son ami Cihan, un jeune kurde, a passé deux ans en prison, suite à un procès abusif. La beauté du film tient dans son dispositif de superposition. Le narrateur raconte l’histoire de Cihan tout en faisant défiler sous nos yeux un autre univers visuel : tandis que la voix-off raconte le procès, la caméra s’appesantit sur des animaux dans un vivarium. Aux images à jamais disparues – celle du passé Cihan – , il lui oppose celle d’un passé qui paraît désormais bien lointain. Une réflexion sur le présent, peut-être : notre mémoire ne cesse de s’étioler face à sa force. Une réflexion sur le récit, aussi : lorsqu’un ami nous raconte une histoire aussi impensable que celle-ci, aucune image ne nous vient et nous lui substituons des images que l’on connaît. Une réflexion sur le cinéma, enfin, et sur sa capacité à redonner une plastique aux récits refoulés.
Romane Demidoff
Prochaine projection le vendredi 29 mars à 21h, Forum des Images.
Les autres journaux :