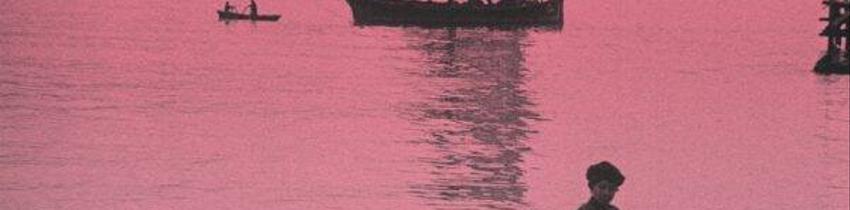22H – Cour du lycée Saint Joseph – FESTIVAL IN AVIGNON
Je suis allée voir Delirious Night dans le cadre du festival d’Avignon. Il s’agit d’un spectacle chorégraphique mis en scène par Mette Ingvartsen dont j’avais entendu ça et là du bien et du mal. Pour ma part, je ne saurais pas vraiment dire si j’ai aimé. De toute façon, je ne vais pas au théâtre pour aimer ce que j’y vois.
L’ami assis à côté de moi a dit en se levant de son siège : « cet objet scénique n’est pas intéressant » et je n’ai pas pu m’empêcher de rire en pensant qu’au fond il avait peut-être raison. Pourtant, j’ai eu envie d’approfondir cette expérience sensible de 22h Cour du Lycée Saint Joseph, en faisant le lendemain matin quelques recherches. Alors de pages Instagram en photos de corps distordus, et parce que l’esthétique de cette metteuse en scène a attiré mon œil et mon cerveau, j’ai eu envie d’écrire cet article, à propos de Delirious Night donc, mais pas que, parce qu’il y a eu tout un flot de pensées pendant la night dont j’aimerais témoigner ici, parler aussi de One song, du bal des folles et d’une rave party en Bretagne.

Pendant les vingt premières du spectacle, pour être tout à fait honnête avec vous, je m’ennuie passablement. Neuf dansereu.ses sont entré.es au plateau, torses nus, visages dissimulés sous des masques d’animaux, de squelettes, de boules à facettes, parfois parcourus de clignotements lumineux. Ensuite, iels se mettent à danser en sautillant et traversent de long en large la scène, ce qui évoque immédiatement d’une part l’univers du bal folk, d’autre part l’ambiance des rave partys. Les corps sont libres et relâchés, ça virevolte dans tous les sens si bien que j’ai plutôt le sentiment d’assister à un long moment d’improvisation plutôt qu’à une chorégraphie brodée au cordeau. J’ai dû mal à voir la différence entre une teuf dans la montagne en comité réduit et Delirious Night à Avignon. On nous dit souvent de « cacher les coutures » au moment de créer un objet scénique, de ne pas exhiber l’endroit de fabrication, de donner une impression de facilité. Là on ne peut pas nier que les coutures ont été effectivement très bien dissimulées, au point que mon ami a pensé pendant toute cette première partie – je le cite – que Mette Ingvartsen avait décidé de travailler avec des « amateur-ices ». À la sortie, un autre ami me dit tout le contraire : « c’est dingue, c’était tellement précis et millimétré cette première partie ». Alors peut-être qu’avec mon ami numéro 1 nos regards n’ont pas été assez affûtés et que nous nous sommes laissés endormir par ce tourbillon d’allers-retours et de sautillements.
Ayant déjà participé à quelques bal folks et rave partys, je me suis demandée pendant cette première partie, si on est coutumier.es de ce genre d’endroits, alors à quoi sert ce spectacle ? Est-ce que c’est pour montrer aux bourgeois.es comment faire la fête ? Leur afficher sous le nez ce à quoi iels n’ont pas accès ? Et je me suis rappelée que deux ans auparavant, dans ce même lieu, j’avais assisté à un spectacle qui s’ouvrait également par un long moment de fiesta collective : Extinction de Julien Gosselin. Sauf que cette fois, les spectateur.ices étaient invité.es à monter sur le plateau pour incarner eux-mêmes les corps en transe, dans les toum toum de la techno. Pendant quarante-cinq minutes, le plateau était donc saturé de présences remuant sur un seul et même rythme, des spectateur.ices devenu.es figurant.es.

Est-ce qu’il est dès lors possible de faire ressentir ce qu’est la fête sans abolir le quatrième mur qui sépare public et artistes, bourgeois.es et punks ? Beaucoup de spectacles s’essayent à représenter la fête, l’extase, l’ivresse et là, en ce qui concerne Delirious Night il me semble qu’en ce début le parti-pris a manqué de clarté. Et pendant que je continuais de m’ennuyer, j’ai repensé à cet autre spectacle qui a été joué il y a trois ans, dans ce même lieu, devant les mêmes gradins bleus – décidément, les étoiles techno-pouffes sont alignées : One song de Miet Warlop. Non pas une batterie au plateau mais six et des artistes courant à toute vitesse d’un endroit à un autre pour faire entendre leur musique. Un chanteur sur un tapis-roulant, un pianiste attelé à faire des tractions pour appuyer sur les touches, des supporters dans les gradins, un coach sportif au mégaphone pour supporter l’équipe. Là, pour moi, on tenait un parti-pris fort, précis et méga palpitant. Mais cet article malheureusement n’est pas à propos de One song.
Au bout d’un moment, à force de scruter ces neuf dansereu.ses au plateau super énergiques, qui ont l’air super contents d’être là, quelque chose d’autre arrive. Je commence à douter de leurs sautillements, de leurs joies, de leurs sourires. Derrière les masques doivent se trouver d’autres masques. En me concentrant très fort, comme si mon regard allait gratter du vernis, d’un seul coup Delirious Night commence à résonner autrement. Ce n’est plus un simple exutoire émotionnel où les corps sont exposés dans toute leur splendide jeunesse mais boum : une prison dorée. Ces artistes – qui définitivement ne sont pas des amateur.ices car je commence à voir apparaître les patterns millimétrés dont parlait mon ami numéro 2 – subissent en réalité leur propre image : iels essayent d’être beaux-belles, de montrer comme iels bougent bien, sautent bien. Iels tentent de se vendre, peut-être même de trouver l’amour. Je suis assise au rang E32, pas si loin de la scène. Peut-être qu’iels essayent de se vendre à moi, à mes genoux repliés contre le siège en plastique de devant. Je cherche à faire des eye-contacts. J’arrive à en faire un. Je me sens presque un peu spéciale.