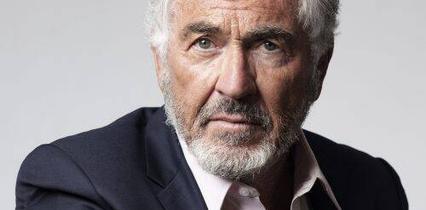Après Les Villes de papier (prix Renaudot de l’essai 2020), Dominique Fortier poursuit son exploration de la vie d’Emily Dickinson dans son nouveau roman Les ombres blanches, paru aux éditions Grasset au début du mois de janvier. Dans ce nouveau volume, il est désormais question de la première publication de l’œuvre de la poétesse américaine alors tout juste décédée. Avec finesse, Dominique Fortier nous fait voyager dans l’imaginaire de la hantise, où les vivants et les morts ne forment plus qu’une seule et même âme, celle, enivrante, de la littérature.
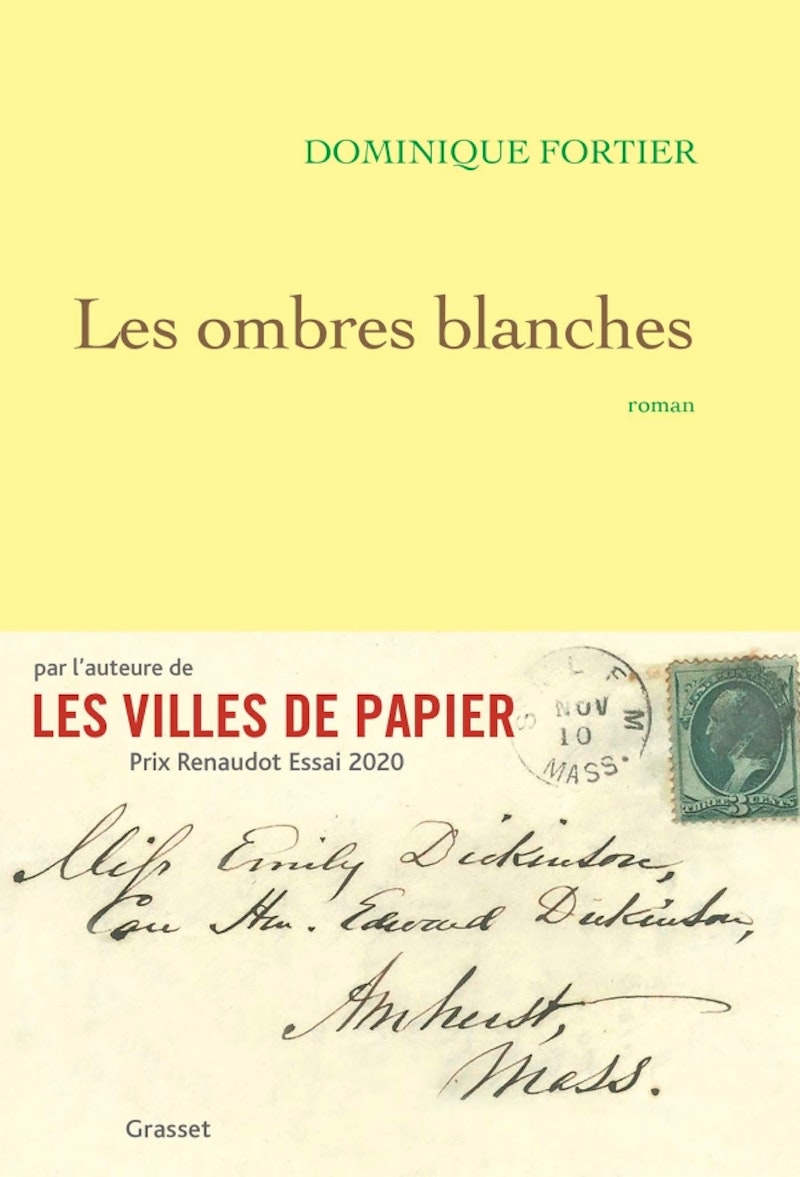
Visage du spectre, poétique de la trace
Le livre est ainsi construit en labyrinthe, comme pour mieux traduire cet entrelacement des contraires, exprimer cette sortie hors de soi, cette extase intérieure propre aux « formules magiques » de la littérature, avec une alternance des points de vue des sœurs et celui de l’auteure. Cette dernière opère une filiation directe entre cet impératif formel de toute œuvre littéraire avec l’image du « feu », à la fois dérivé de focus (foyer) et de fatum (destin). Le feu est aussi bien extérieur qu’intérieur, ce qui consume et fait vivre à la fois. La tension des opposés est maintenue par l’inscription de la trace, l’apparition du spectre : les livres sont en effet des « fantômes », car ils réussissent à incarner, à chaque lecture, la mémoire au présent, à réactiver l’altérité inconnue au plus profond de nous-mêmes. La trace devient alors une poétique, l’enjeu de la création renouvelée du temps, de la conjuration du manque en plénitude du désir, abolissant les frontières entre « les vivants et les morts » réunis dans l’osmose transcendante de la parole écrite de la poétesse disparue : « Jamais papier n’a été si vivant ». La hantise d’Emily est la concrétion de cet absolu, ce témoignage, par la présence vive de son absence, qu’avec la force des mots, l’émotion d’une image, « la nuit triomphe en plein jour ».
« Une vie par poème », la lumière des ombres blanches
L’ombre d’Emily précède les poèmes publiés, mais ce qui en ressort sont des « feuilles traversées par la lumière ». Tout le livre décrit avec minutie le travail de la matière, que ce soit la fabrication du recueil ou la confection de plats et gâteaux. L’écriture est alors associée à une transmutation des éléments, une savante alchimie du souvenir qui ne peut être exercée qu’à partir du décor prosaïque des sœurs, véritable terreau du temps changé en or, où la lumière de l’écrit ne fait qu’une avec l’éclaircissement de tous ces petits actes qui nous rattachent à la vie, rendent hommage aux morts : « La lumière qui coule dans le champ tandis qu’elle revient vers la maison est aussi dorée, aussi épaisse que son caramel d’abricots ; le soleil, un fruit mûr ».
L’écriture est ce désir, cette faim de vivre qui animent les spectres de nos existences, l’éclosion de l’infini dans notre finitude, l’humilité de notre quotidien. Pour combler le manque, renouer avec l’origine perdue, l’être disparu, il suffit peut-être de réapprendre à voir, d’ouvrir notre perception à l’invisible, au sublime de l’ordinaire : «Ces poèmes sont des ombres blanches, des textes tissés à même les silences entre les mots, une maison faite en fenêtres ». Les ombres blanches sont ces pages du livre composé, qui révèlent, une à une, le miracle d’une éternité extraite de la contingence du vide à leur origine : en lisant, en écrivant, le passé est transfiguré, le spectre se métamorphose en ce « petit infini ouvert » entre nos mains. La littérature est dès lors « le contraire du renoncement » : grâce de l’instant, miracle du temps, elle réalise l’impossible étreinte de la vie et de la mort dans l’évanescence d’un style, la sensibilité d’une écriture en lesquelles se confondent l’esprit d’Emily Dickinson et la plume de Dominique Fortier.