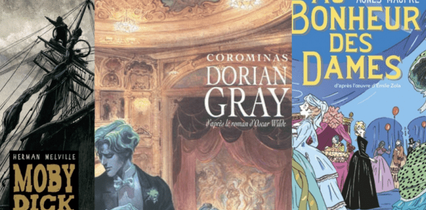L’ancien reporter et documentariste, aventurier et voyageur Peter Heller, le peintre de l’Ouest américain en général, et du Colorado en particulier, poursuit, avec le Guide (son cinquième roman, aux éditions Actes Sud), les aventures de Jack, dont le lecteur avait fait la connaissance dans la Rivière (Actes Sud, 2021). Jeune cow-boy intrépide et pêcheur averti, Jack est embauché en tant que guide de rivière au Kingfisher Lodge, complexe luxueux et isolé réservé au délassement d’une clientèle fortunée. Alors qu’il s’adonne à la pêche à la mouche avec sa cliente Alison, une célèbre chanteuse profitant d’un fugitif anonymat, Jack se rend compte que tout ne tourne pas rond et que la demeure du voisin, le mystérieux misanthrope Kreutzer, recèle bien des secrets inavouables.
Dans la lignée d’Hemingway, Jim Harrison et de Werner Herzog, Peter Heller, poète de l’extrême, de la Nature sauvage, tout aussi hostile qu’accueillante, et des grands espaces imposants où règnent le majestueux wapiti, le féroce puma et le véloce faucon des prairies, livre avec le Guide un récit tout en délicatesse de la pêche à la truite qui vire avec brio au thriller haletant et angoissant.
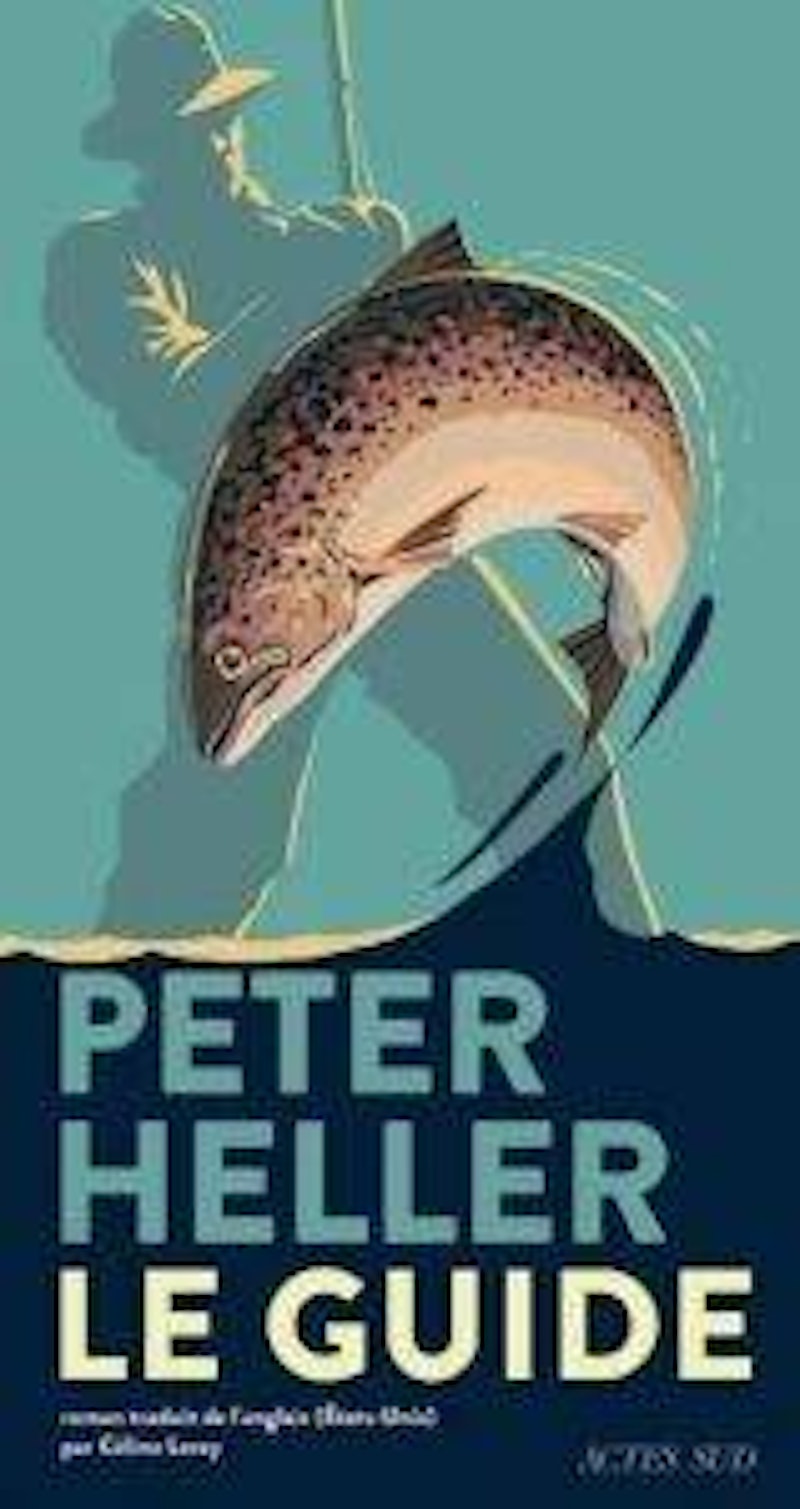
Je commence toujours mes romans en écrivant la première ligne, sans avoir d’intrigue en tête ni de plan. J’ai d’abord été poète ; par conséquent, j’ai toujours été beaucoup plus intéressé par la musique de la langue et sa sonorité que par l’intrigue ou l’histoire.
Par ailleurs, j’ai passé les trente dernières années, parfois en tant que professionnel, parfois non, à parcourir des rivières en kayak. Et s’il y a une chose que j’aime particulièrement quand je dévale les rivières, surtout celles qui n’ont jamais été décrites dans la littérature, c’est bien de prendre un virage serré sans savoir ce qui nous attend derrière. Il peut s’agir d’un puma en train de boire, d’une chute d’eau (et dans ce cas, il faut rebrousser chemin très vite), d’un vol d’hirondelles éclairé par le soleil… On ne sait jamais, on ne peut être sûr de rien. J’aime ce frisson et cette surprise que la nature nous réserve. C’est ce sentiment que j’ai voulu retrouver en écrivant de la fiction. Je voulais vivre cette expérience. Comme je l’ai dit, je n’ai pas de plan prédéfini. Je commence par la première ligne, je définis le contexte narratif et je voyage dans ce nouveau territoire de l’histoire.
Ainsi, dans Le Guide, on entrevoit d’abord une cabane, la magnifique rivière, puis un homme qui dépose son sac sous le porche : c’est Jack ! J’étais très heureux, et en même temps surpris, de le revoir. Je m’étais inquiété pour lui car, comme vous venez de le dire, nous l’avions laissé, dans le livre précédent, dans un sale état. J’ai pensé : « C’est bon de te revoir ! ». Puis j’ai appris, au fil des pages, qu’il avait trouvé un emploi de guide de pêche dans ce coin. J’en ai découvert sur lui au fur et à mesure que j’écrivais.
J’étais plutôt satisfait de voir qu’il avait trouvé quelque chose qu’il aime vraiment et que ce serait bénéfique pour lui. Au moment où le livre commence, il a besoin de reprendre sa vie en main.
J’étais loin de me douter de ce qui allait se passer à cet endroit…
Vous venez d’évoquer la musique de la langue qui vous intéresse plus que l’intrigue. Cet élément, ainsi que la poésie du paysage, les descriptions, la retranscription d’une certaine atmosphère… semblent, en effet, l’emporter sur l’intrigue elle-même pendant la première moitié, voire les 3/4 du livre. L’intrigue est-elle, pour vous, secondaire par rapport à la peinture du cadre dans lequel elle évolue ? Ou préférez-vous simplement prendre le temps d’installer le lecteur dans une certaine ambiance ?
Il s’agit de m’installer dans l’histoire car je ne sais jamais ce qu’il va se passer. J’entre dans l’histoire tout comme le lecteur, c’est ainsi que je fonctionne.
Il est certain que la musique de la langue, la cadence, le rythme du début sont les éléments les plus importants pour moi. Je dois tomber amoureux de la langue et du lieu. Pour cela, je suis un processus spécifique : j’écris dans un café de Denver, je mets un casque qui diffuse le bruit de la pluie et je me dis : « Ne pense pas. Ne pense pas. Écoute tout simplement ». Puis je me retrouve transporté dans un endroit imaginaire dont je peux explorer les moindres recoins, puisque c’est mon moi intérieur. Généralement, il s’agit d’endroits que j’affectionne : des lieux sauvages, des torrents… Je me retrouve dans cet espace imaginaire, jusqu’à ce qu’un personnage se présente à moi. Il y a toujours un personnage, avec une voix particulière ; cette fois-ci, c’était Jack. Puis, d’une manière ou d’une autre, des événements commencent à se produire, qui se révèlent parfois extrêmement dramatiques ou comiques. Je peux, au beau milieu du café, me mettre à rire à gorge déployée ou bien éclater en sanglots, avec des larmes dégoulinant le long du menton et sur la table ; les autres clients finissent par regarder tout autour d’eux, en se disant : « Ce pauvre gars, il traverse une mauvaise passe, il est en train de divorcer, il a perdu son chien ». Mais la réalité, c’est que je suis plus excité que je ne l’ai jamais été car je suis complètement immergé dans cette histoire que je vis.
Jack est un solitaire, plein de culpabilité et de remords (il s’accuse de la mort de sa mère). Il trouve refuge et réconfort dans la pêche, ce qui l’amène à accepter un emploi de guide de pêche dans un pavillon pour riches. Vous avez été guide de rivière et moniteur de kayak dans le passé. Pouvez-vous nous dire ce que cela signifiait pour vous ? Que vous a appris la pêche ?
J’ai été moniteur de kayak pendant de nombreuses années, sur des bateaux de sécurité à descendre des rivières de classe V. Puis, assez tard, vers l’âge de trente ans, j’ai appris à pêcher à la mouche. J’avais lu peu de temps auparavant un livre sur la pêche, Et au milieu coule une rivière, de Norman Maclean, qui m’avait impressionné : il décrivait la pêche comme une sorte d’art mystérieux et très spirituel. Je n’étais pas sûr d’être capable d’arriver moi-même un jour à retranscrire les mêmes impressions.
J’ai élu domicile dans un petit village de l’ouest du Colorado. Bobby, le gérant de la station-service, m’a un jour dit qu’il avait remarqué ma canne à pêche et qu’il savait que je pratiquais la pêche à la mouche. Il m’a confié une astuce : « Une truite a un cerveau de la taille d’un petit pois. Il suffit de lancer la mouche et le poisson se laisse attraper tout seul. » Il m’a conseillé quelques bons endroits et m’a montré la meilleure manière de lancer. Mais ce que je n’avais pas prévu, c’est que c’est finalement moi qui ai mordu à l’hameçon ! J’ai attrapé mon premier poisson cette nuit-là, tout seul au beau milieu d’un paysage de rêve : une superbe rivière, des bois de sapins et d’épicéas en aval, la montagne et les wapitis en amont. Je me suis alors dit : « Voilà, c’est ça que j’aime ! »
Vous prenez le temps de contempler le paysage.
Il ne s’agit pas tant de contempler. Vous vous concentrez intensément sur des détails particuliers comme la direction du courant, du vent, toutes ces petites particularités ! Et plus je me concentre sur ces détails particuliers, plus ma conscience du pays tout entier grandit. C’est la chose la plus étrange dont j’ai pris conscience.
Il ne s’agit pas tant de contempler. Vous vous concentrez intensément sur des détails particuliers comme la direction du courant, du vent, toutes ces petites particularités ! Et plus je me concentre sur ces détails particuliers, plus ma conscience du pays tout entier grandit. C’est la chose la plus étrange dont j’ai pris conscience.
La pêche semble être le passe-temps qui permet le mieux de se rapprocher de la nature. Certains diraient aussi la chasse, mais c’est une activité mortelle. Dans votre livre, la pêche n’est jamais mortelle ; les poissons sont toujours rejetés dans l’eau. Nous ne sommes pas dans Moby Dick ou Le Vieil Homme et la mer, qui sont des récits de chasse à mort. Était-ce important pour vous ? Cela témoigne-t-il d’un certain respect pour la faune et la flore ?
Ils ne sont pas rejetés. Au contraire, ils sont délicatement relâchés dans l’eau. Jack les retient jusqu’à ce qu’ils se rétablissent, qu’ils reprennent leur souffle et qu’ils soient libérés.
Je pense qu’il était important de montrer la douceur de Jack et son respect pour les poissons, cela témoigne de son point de vue sur le monde. Même s’il se méfie quelque peu des gens, il reste une personne très honnête et protectrice et se soucie des autres. Il n’est pas du tout violent ni colérique ; s’il a recours à la violence, c’est parce qu’il y est contraint. Au début du livre, il est vulnérable. Je ne pensais pas que cette sensibilité, qui m’est apparue de manière évidente au fil de l’écriture, prenait une telle importance chez lui. Mais après avoir rédigé la première scène de pêche, j’ai trouvé merveilleux qu’il se préoccupe tant des poissons et qu’il prenne le temps de s’assurer qu’ils vont bien avant de les relâcher.
La nouvelle Big Two Hearted River d’Hemingway a-t-elle eu une quelconque influence sur votre travail ?
Oui, une grande influence. À l’âge de onze ans, je me promenais dans la bibliothèque de mon école à New York, à la recherche d’un livre. J’avais le béguin pour la bibliothécaire. Elle était anglaise. Quand elle m’a dit « Peter, tu cherches quelque chose à lire en particulier ? » avec son accent anglais, je suis tombé amoureux immédiatement et je l’aurais volontiers épousée ce jour-là ! Elle suivait toutes mes lectures depuis l’âge de cinq ans et savait ce que j’attendais d’elle. Elle s’est dirigée vers le rayon romans et en a sorti De nos Jours d’Ernest Hemingway. Vous devez vous imaginer un petit gamin lire cette aventure dans son petit appartement de New York. Mon cœur est littéralement sorti de ma poitrine ! Je voulais moi aussi camper près de cette rivière, porter un sac à dos, faire une randonnée dans les bois, préparer du café sur un feu de camp, sans me brûler la langue à la manière de Nick. Et je voulais pêcher ces magnifiques truites. Mais ce que je désirais par-dessus tout, c’était écrire comme ce type. Cette histoire a été ma première expérience d’une prose qui me soit littéralement entrée dans la peau, qui ait su parler à mon cœur et à mon cerveau. C’était une expérience tellement magique et puissante.
On pourrait presque dire que le paysage, les grands espaces « incommensurables » du Colorado que vous décrivez remarquablement, est presque un personnage à part entière. Ou même le personnage principal. Êtes-vous d’accord avec cela ?
C’est ce que je recherche ! Je pense que ce qui définit le western américain, les films de John Ford, etc., toute la littérature de l’Ouest américain, c’est cette capacité à ériger le paysage en personnage principal, la Nature en vrai héros du récit. Tous les drames humains relatés dans ces histoires semblent futiles par rapport au paysage grandiose où ils se déroulent, dans un contexte qui en impose.
Alors que votre précédent livre s’attachait à montrer une nature dangereuse et hostile, comme dans un film de Werner Herzog, ici la nature est bienveillante et le danger provient exclusivement des hommes. Peut-on dire qu’il s’agit d’une histoire de survie, non pas face à la Nature, mais face à l’Homme ?
Bien sûr. J’ai participé à de nombreuses expéditions dangereuses. Ainsi, ma toute première mission a consisté en une expédition fluviale sur la Dadu, un affluent du fleuve Min, au bord du Plateau tibétain, pour le magazine Outside. Un homme est mort dans mes bras pendant cette mission. Il était tombé à l’eau et s’est retrouvé bloqué par un tronc d’arbre, alors que la rivière montait inexorablement. Nous lui avons maintenu la tête hors de l’eau et avons essayé de le sortir de là avec des cordes et des poulies. Mais nous n’y sommes pas parvenus et la rivière l’a englouti. Je me suis alors rendu compte du côté réellement impitoyable de la nature. Mais je pense qu’en général, la plupart des problèmes proviennent des êtres humains.
Jack n’est pas seulement un enfant de ranch ou un cow-boy, dur, courageux et débrouillard, il est aussi cultivé et lit de la poésie, en particulier des haïkus. Cela fait de lui un gentleman parfait et complet, avec un esprit sain dans un corps sain.
En effet ! J’adore Jack ! Dans La Rivière, le personnage de Wynn est inspiré d’un de mes très chers amis, Jay, un artiste éphémère et un homme de plein air accompli. Cela a fait de moi un double de Jack, en quelque sorte, même si je ne suis pas comme lui. Il est dix fois plus coriace, mais son contact avec les gens est très similaire au mien, même s’il est un peu plus méfiant. Il est du genre « on ne te fait confiance que si tu es digne de confiance. »
Vous évoquez une discussion fictive entre Jack et l’écrivain Marilynne Robinson. Il lui demande ce qu’est le Mal, et elle lui répond : « l’empêchement d’être ». Cette citation est-elle authentique ? La faites-vous vôtre ?
J’ai intégré tardivement l’Iowa Writers’ Workshop, à l’âge de trente-trois ans, et je me suis inscrit à la fois à l’Ecole de Fiction et à l’Ecole de Poésie pour augmenter mes chances d’y entrer. Et j’ai été accepté dans les deux. C’est un atelier d’écriture très réputé et j’ai été l’un des premiers à suivre les cours de poésie et de fiction en même temps, ce qui était une expérience plutôt jouissive.
Marilynne Robinson était mon mentor à l’Ecole de Fiction, nous avons fini par devenir amis. Un jour, alors que nous étions dans son jardin à boire du thé glacé et à discuter, je lui ai demandé ce qu’elle pensait du Mal (car elle s’est beaucoup penchée sur le thème de la religion) et elle m’a répondu du tac au tac : « l’empêchement d’être ». J’y ai réfléchi pendant plusieurs années et il m’est apparu que cette expression ne concernait pas tant le fait, par exemple, qu’un puma chasse et dévore un élan ou un cerf, qu’une subversion de l’ordre naturel des choses. Or, c’est ce qu’il se passe dans mon livre, dans ce complexe hôtelier, et c’est la raison pour laquelle j’ai inclus cette citation, qui est bien authentique.
Une autre menace silencieuse et d’actualité est le Covid. Était-ce une façon d’ancrer l’histoire dans une certaine réalité, un contexte très spécifique ?
J’ai écrit mon histoire en pleine épidémie de Covid. Cela a été une période très compliquée pour moi : même si pouvais écrire à la maison ou faire du kayak avec mes amis, j’ai été endeuillé par la mort de mon père, qui n’a pas survécu à l’épidémie ; le plus frustrant étant que je ne pouvais pas lui rendre visite sur son lit d’hôpital, la situation était trop risquée. Des amis sont tombés également très malades, et cela a été très difficile à supporter. Lorsque j’écris, j’essaie de me fonder sur des faits réels à même de constituer des éléments d’une intrigue beaucoup plus vaste. En d’autres termes, ce qui se passe et me touche le plus dans la vraie vie se retrouvera dans le roman et formera l’histoire. J’ai donc choisi d’évoquer le Covid car il a eu un impact très important sur moi. Il fallait qu’il apparaisse.
Tous les personnages semblent cacher des secrets. Les secrets sont synonymes de soupçons et de conspirations, surtout pendant le Covid, où les théories du complot étaient très répandues. Pensez-vous que nous vivons une époque de méfiance généralisée ? On ne connaît jamais son voisin et on ne sait jamais ce qui peut se passer à côté de chez soi. Et c’est le cas ici parce que les gens cachent des secrets et que nous ne savons pas exactement ce qui se passe dans la maison de Kreutzer.
Je pense qu’il y a deux situations qui se rencontrent. Dans certains endroits, les communautés se serrent les coudes et prennent soin les unes des autres, c’est ce que je constate là où j’habite, à la campagne. Et dans le même temps, dans d’autres endroits, la peur s’empare des gens, qui se replient sur eux-mêmes, et se recroquevillent dans leur propre cercle de connaissances, leur clan, leur tribu, voire leur famille. Ils ne font pas confiance à leurs voisins, car ils ont peur. Et toutes ces fusillades que nous devons endurer n’arrangent pas les choses….
Je pense qu’il existe une grande tension en Amérique. Dans les petites communautés où tout le monde se voit et se connaît, les gens se réunissent sans problème. Mais les milieux urbains plus denses, en particulier dans ces horribles banlieues stériles et sans âme où les gens sont tassés (mais sans qu’ils se fréquentent pour autant), sont un terrain propice à toutes sortes de méfiance et de désinformation.
Dans votre précédent livre, Jack découvrait le vrai sens de l’amitié. Ici, il découvre l’amour, avec Alison, une chanteuse célèbre. Ils ne sont plus un couple d’amis aventureux, mais des amants aventureux. Dans les deux cas, c’est une course contre la mort. L’histoire de l’initiation de Jack est plutôt mouvementée.
Votre question est intéressante, personne ne me l’avait jamais fait remarquer auparavant. Et pourtant, c’est vrai ! L’amitié qu’il portait à Wynn a été rudement mise à l’épreuve dans la Rivière et cela les a rapprochés. Je pense que c’est également le cas dans le Guide, mais cette fois d’un point de vue amoureux. C’est sa première véritable expérience de l’amour romantique : ces deux-là sont très soudés et se complètent vraiment. Je me réjouissais d’écrire leurs scènes de dialogue en raison des affinités qui les lient. Ils comprennent tous les deux le sens de l’humour de l’autre, ils ont l’esprit vif et sont volontaires.
Alison peut être un mentor pour Jack. En effet, elle lui donne une véritable leçon de vie. « Elle savait se donner entièrement à ce qu’elle faisait. Il avait remarqué ça chez les gens qui avaient appris à maîtriser une discipline quelle qu’elle soit, cette capacité à s’immerger. La concentration était une chose, et elle était nécessaire, mais là, cela impliquait aussi de l’action. L’énergie passait de celle qui agissait à l’activité. […] Il avait révélé que chez tous les grands maîtres, la concentration se transformait rapidement, voire immédiatement, en une absorption totale dans l’acte lui-même. La personne agissante se donnait tout entière et c’était comme si […] l’énergie repartait en sens inverse. […] Se déversait dans celle qui agissait. » Nos actions nous définissent, c’est presque de l’existentialisme.
C’est exact. Il s’aperçoit enfin que l’énergie circule de l’activité vers l’acteur, de sorte que ce dernier est emporté par le flux. C’est la première fois qu’il se trouve confronté à cela et qu’il parvient à le formuler avec ses propres mots. Je pense que cela est très formateur pour lui.
Dans La Rivière, vous écrivez à propos de Jack : « Tous ceux qu’il aimait le plus, il les a tués. D’une manière ou d’une autre. » Ici, (et sans vouloir révéler la fin), il ne tue plus involontairement mais il sauve. A-t-il trouvé une sorte de rédemption ?
Bien sûr, la dernière scène, sans la dévoiler, évoque un abandon. Jack s’abandonne au sentiment de confiance qu’il peut enfin éprouver pour autrui et c’est ce que signifie, à mon sens, cette toute dernière scène. C’est vraiment rassurant pour lui, surtout après qu’il a traversé une période aussi difficile.
Le Guide a un côté humaniste : le livre peut être vu comme une critique de la marchandisation des corps, de l’isolement des riches. C’est peut-être parce que vous êtes un homme avec un fort sens de l’engagement social et écologique (je pense en particulier à votre expérience avec Sea Shepherd sur le massacre des baleines et des dauphins au Japon).
Je suis convaincu que l’écart de richesse croissant – je ne me prononce pas pour l’Europe, mais aux États-Unis, c’est le cas – entre les très riches et les pauvres est obscène et ruine notre société. Cela me rend fou. Il est consternant de voir que des gens sont obligés de cumuler deux emplois pour subsister. Avant de pêcher, par exemple, je me rends au Starbucks, je prends mon café et je discute toujours avec la serveuse qui m’avoue joindre difficilement les deux bouts et pouvoir à peine payer son loyer… Je parle aussi aux serveurs lorsque je vais dîner au restaurant, ils me disent tous qu’ils vivent loin du centre de la ville, à une demi-heure de là, bien souvent en colocation, et beaucoup d’entre eux cumulent deux emplois…. Je pense qu’une grande partie du pays est au bord du gouffre. Et à côté de cela, il y a les chanceux. Pour ma part, j’ai beaucoup de chance de pouvoir aller pêcher et de faire ce que j’aime. Mais cette situation inégalitaire rend bien sûr les choses beaucoup moins amusantes. Il est difficile de profiter d’un certain train de vie privilégié lorsque tant de gens autour de vous souffrent et survivent à peine. Et je pense que cela n’a rien à voir avec des situations individuelles ni d’un soi-disant manque d’humanité. Cela a à voir avec un système enraciné dans notre histoire et notre culture, cette manière terrible par laquelle, je déteste dire cela, le capitalisme s’exprime aux États-Unis. Je ne suis pas communiste. Mais je crois au modèle social-démocrate que je vois un peu en France, ou en Scandinavie, et à son système de sécurité sociale et de revenu minimum, où personne (ou presque) ne peut s’enrichir de manière obscène sans que les autres puissent bénéficier de soins ou d’un logement.
Les États-Unis devraient ressembler davantage à la Suède. C’est mon avis.
Kelly, l’employée du service client et du marketing, incarne ce côté artificiel, consumériste, déconnecté de la vie réelle. Elle est soumise à une logique comptable d’efficacité, peu ouverte à la beauté des choses, à la poésie. Même si Jack se rend compte qu’il doit nuancer le portrait qu’il fait d’elle, pensez-vous que nous ayons perdu la capacité de contempler la Beauté ? Surtout lorsqu’il s’agit de la nature ?
Je pense que beaucoup d’entre nous l’ont perdue. Il y a trop d’informations qui nous parviennent, nous mettons trop l’accent sur l’argent et le statut social. Et nous avons oublié l’importance qu’il y a à tout arrêter et écouter le bruit de l’eau d’une rivière. J’étais à Saint-Malo dernièrement, cela m’a permis de recharger mes batteries et de me poser les questions qui comptent vraiment, prendre le temps de se déchausser, marcher sur le sable mouillé, écouter les mouettes, sentir le vent du large. Nous avons besoin d’un temps pour nous reconnecter aux choses les plus élémentaires. N’oublions pas que l’Homme a commencé par vivre dans des petites tribus : nous avons vécu abrités sous des rochers, exposés aux éléments (la pluie, les intempéries…), nous dépendions des migrations des troupeaux etc. C’est dans notre ADN.
La devise de Jack, « qu’est-ce qui pourrait être mieux ? », est une sorte de leitmotiv, comme s’il essayait de se convaincre lui-même. Encore une fois, cela souligne le contraste entre le paysage idyllique où il vit et la laideur de ce qui s’y passe. Est-ce quelque chose que vous vouliez souligner ?
Bien sûr. C’est quelque chose que je me dis moi-même très souvent sur le chemin pour aller pêcher.
Quand je me sens un peu déprimé, cela me sert de méthode Coué : je m’auto-persuade et je me souviens des bons moments. Autrement, c’est une expression de gratitude. Je voulais que Jack ait la même manie car nous sommes très semblables, tous les deux.
Nous ne révélerons pas la fin, mais elle relève pratiquement d’un film d’action. Une adaptation cinématographique vous a-t-elle déjà traversé l’esprit ?
Oui, et j’espère que quelqu’un le remarquera ! Je pense que cela ferait un film merveilleux. J’espère que cela se concrétisera.
Vous avez d’abord publié des reportages et des ouvrages non romanesques. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la fiction ?
C’est ce que j’ai toujours voulu faire depuis que j’ai lu la nouvelle d’Hemingway dont on a parlé. Je voulais écrire de la fiction. A l’université, j’ai étudié la littérature comparée et la biologie. Je pensais qu’il était important de connaître la différence entre un épicéa et un pin, de reconnaître les différentes espèces d’oiseaux et de plantes, car je savais que j’allais écrire sur la Nature. Puis j’ai quitté l’université et j’ai dû gagner ma vie ; j’ai donc commencé à écrire pour des magazines, dont Business Week. Cela peut surprendre mais il y a une explication : le rédacteur en chef que je suivais de magazine en magazine m’a un jour proposé la chose suivante :
« Veux-tu écrire pour Business Week ?
- Non merci, ai-je répondu.
- Pourquoi donc ?
- Parce que c’est Business Week, je ne veux pas écrire d’articles sur le monde des affaires.
- Ecoute, tu peux écrire ce que tu veux. Il suffit que tu mettes à un moment donné un graphique en camembert avec quelques dollars et le tour est joué. »
C’est fou tout ce qu’on peut écrire avec un graphique !
Quoi qu’il en soit, ils payaient très bien ; j’ai donc rédigé quelques histoires pour eux. J’ai ensuite bénéficié d’un congé sabbatique de neuf mois, que j’ai pu consacrer à la rédaction du roman que je voulais écrire depuis l’âge de onze ans. C’était La Constellation du chien, que j’ai écrit en sept mois, à raison de mille mots par jour. Tous les jours, je me disais : « Assieds-toi, ne pense pas, écoute tout simplement ». J’ai alors entendu la voix de Hig, comme s’il était de l’autre côté du feu de camp, par une nuit d’octobre, qui me racontait ce qui lui était arrivé. C’est la chose la plus excitante que j’aie jamais vécue. Pour moi, écrire de la fiction relève davantage d’un retour aux sources que d’un changement dans mes habitudes. En effet, lorsque j’écrivais pour des magazines, j’avais recours, autant que je le pouvais, à certaines techniques, lyriques et poétiques, et je les ai développées afin de les réutiliser plus tard pour la fiction. Ce n’était donc pas une perte de temps. C’était comme un terrain d’entraînement.
Votre prochain roman sera The Last Ranger (titre non encore traduit), publié en août prochain. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Il s’agit tout simplement de l’histoire d’un garde forestier du Parc National de Yellowstone qui préfère les loups aux humains, ce qui lui vaudra quelques ennuis. C’est une histoire d’amour, tout comme Le Guide, que j’ai eu beaucoup de plaisir à écrire. J’adore me rendre à Yellowstone l’automne. Ces dernières années, je me suis isolé dans une partie reculée du parc ; je campais pendant deux semaines en plein milieu de l’automne, je remontais les rivières pour pêcher, je voyais des loups, des bisons et des élans. A chaque fois, ce fut une expérience merveilleuse.
J’ai donc pensé qu’il serait très amusant pour moi d’écrire un roman dont l’action se déroulerait dans cette région.
VERSION AMERICAINE
Peter Heller : “Nature is the true hero of Western American literature”
Former reporter and documentarian, adventurer and traveler Peter Heller, the painter of the American West in general, and Colorado in particular, proposes with The Guide (his fifth novel) to continue the adventures of Jack, whom readers first met in The River. An intrepid young cowboy and skilled fisherman, Jack is hired as a river guide at Kingfisher Lodge, an isolated luxury resort reserved for the relaxation of a wealthy clientele. While fly-fishing with his client Alison, a famous singer enjoying fugitive anonymity, Jack realizes that things aren’t going well, and that the home of the neighbor, the mysterious misanthrope Kreutzer, harbors many unmentionable secrets.
In the tradition of Hemingway, Jim Harrison and Werner Herzog, Peter Heller, poet of the extreme, of wilderness as hostile as it is welcoming, and of vast, imposing spaces where the majestic elk, the ferocious moutain lion and the swift prairie falcon reign unchallenged, delivers with The Guide a delicate tale of trout fishing that brilliantly turns into a breathless, agonizing thriller.
The Guide is the sequel to your last book, The River. We find our hero Jack three years later, a young ranch kid from Colorado working as a fishing guide and mourning the death of his best friend Wynn. What made you want to continue the adventures of Jack, who had already suffered so much?
I always start my novels by writing the first line, without having a plot in mind or a plan. I came up as a poet first; consequently, I was always much more interested in the music of the language and the sound of it than the plot or the story.
Also, I spent the last thirty years, as sometimes a professional, sometimes not, running rivers in kayak. And if there’s one thing I particularly love about running rivers, especially those that have never been described in literature, it’s taking a sharp bend without knowing what’s behind it. It could be a mountain lion drinking, a waterfall (and in that case, you have to get out real quick), a flight of swallows backlit by the sun… You never know, you cannot be sure of anything. I love that thrill and surprise that Nature has in store for us. That’s the feeling I wanted to recapture by writing fiction. I wanted that experience. So as I said, I don’t write an outline. I start with the first line, I put on that narrative context and I travel into this new territory of the story. Thus, in The Guide, we first catch a glimpse of a cabin, the magnificent creek, then a man dropping his bag on the porch, and that’s Jack! I was so glad, and in the same time surprised, to see him again. I had been worried about him because, as you just said, we left him, in The River, in pretty rough shape. I thought : “it’s good to see you!“ Then I learned, as the pages went by, that he’d found a job as a fishing guide in this area. I found out more about him as I wrote.
I was rather pleased to see that he had found something he really likes and that it will be good for him. By the time the book starts, he needs to get on with his life. Little did I know what was going to happen at this place…
You’ve just mentioned the music of language which interests you more than the plot. This element, as well as the poetry of the landscape, the descriptions, the retranscription of a certain atmosphere… seem, indeed, to prevail over the plot itself for the first half or even 3/4 of the book. Is the plot, for you, secondary to the painting of the setting in which it evolves? Or do you simply prefer to take the time to settle the reader into a certain mood?
It’s about settling myself because, as I said before, I never know what’s going to happen. I move into the story just as the reader does, that’s how I work.
For sure, the music of the language, the cadence, the rhythm in the beginning are the most important elements for me. I need to fall in love with the language and the place. For this, I follow a specific process: I write in a coffee shop in Denver and I put on headphones that diffuse the sound of rain and I tell myself: “Don’t think. Don’t think. Just listen“. And then I transport into this place where I can go anywhere, because it’s my inner self. And so I usually end up in places that I adore: wild spots, beautiful streams… I find myself in this imaginary place and a character introduces himself to me (there’s always a character, with a particular voice); this time it was Jack. And then somehow, stuff starts to happen and it sometimes turns out to be extremely dramatic or comical. In the middle of the coffee shop, I can laugh out loud or burst into tears, streaming off my chin onto the table, and the other clients will start to be looking around, saying to themselves: “that poor guy, he’s going through a bad divorce or he’s lost his dog“. But in fact, what’s happening is I’m more thrilled than I’ve ever been in my life because I’m completely immersed in this story.
Jack is a loner, full of guilt and remorse (he blames himself for his mother’s death). He finds refuge and solace in fishing, which leads him to accept a job as a fishing guide in a lodge for rich people. You’ve been a river guide and kayak instructor in the past. Can you tell us what that meant to you? What has fishing taught you?
I would spent many years as a kayak instructor, in safety boats on class V rivers, it’s something I’ve experienced a lot. And then, when I was about thirty, I learned to fly-fish (I came to fly-fishing late…). I had read this book, A River runs throughit, by Norman Maclean, about fishing. It scared me because it made fishing seem like a kind of mysterious and very spiritual art. I was not sure I’d ever be able to do that. But then, I moved to this little tiny village in Western Colorado and the guy who ran the gas station, Bobby, said to me that he saw my fishing rod and he knew I was interested. He said: “A trout has a brain the size of a pea. You just throw the fly out there and you’ll catch fish.“. He told me where to go and showed me how to cast. But I was the one who got hooked! I caught my first fish that night, all alone in the middle of a dream landscape: a beautiful mountain creek, just spruce and fir woods coming down, mountain upstream, elk… I was like “I love this!“
You take time to contemplate the landscape.
Well, it’s not so much a matter of contemplating. Your focus is so intense on the particular details like the direction of the current, the wind etc., it’s an odd thing! The more I focus on these particular details, the more my sense of awareness of the entire country grows. It’s the oddest thing I’ve become more aware of.
Fishing seems to be the hobby that best enables connection with nature. Some would also say hunting, but that’s a deadly activity. Fishing, in your book, is never lethal; the fish are always thrown back into the water. We’re not in Moby Dick or The Old Man and the Sea, which are tales of the hunt to the death. Was this important to you? Does that show some kind of respect to wildlife?
They’re not thrown back. On the contrary, they’re gently guided back into the water. Held until they recover, catch their breath and then let go.
I think it was important to show Jack’s gentleness and his respect for the fish, because it speaks to a certain way he is in the world. Though he’s a little wary of people, he’s still a very decent and protective person. He cares about others. He’s not at all a violent nor an angry person; if he resorts to violence, it’s because he’s forced to. At the beginning of the book, he’s fragile. I didn’t think this sensitivity was important because, as I said, it just happens as I write. But after I wrote the first scene of him fishing, I thought it was wonderful that he was so caring about the fish that he took the time to make sure it was okay before he released it.
Was Hemingway’s short story Big Two Hearted River an influence of some sort on your work?
Yes, a big influence. When I was eleven years old, I was walking around my little library in New York City. I had a crush on the librarian. She was English. When she said “Peter, are you looking for something to read?“ with her English accent, I fell in love immediately and I would have married her that day! She had followed my reading since I was five, in the same school. She knew what I was ready for. She came over to the fiction shelf and pulled down InOur Time by Ernest Hemingway, with that story in it. You have to imagine a kid bringing that home to New York. My heart jumped out of my chest! I wanted to camp by that river! I wanted to have a backpack, walk in the woods, make coffee on an open fire, not burn my tongue when I ate something hot, Nick style. And I wanted to catch those beautiful trout. But most of all, I wanted to write like this guy. This story was my first experience of prose that went through my skin, into my heart and sort of bypass the head. And it was such a magical, powerful experience.
One could almost say that the landscape, the “immeasurable” wide-open spaces of Colorado that you describe remarkably, is almost a character in its own right. Or even the main character. Is it something you agree with?
That’s what I love! I think that what defines a Western, an American Western,
the movies of John Ford and so on, all the Western literature is the ability to show the landscape as their main character, Nature as their true hero. All the human drama is thrown up against this grand landscape. I think that’s very interesting because in the end, with that perspective, it makes the human drama seem sort of little less significant in the grand scheme of things.
While your previous book focused on showing a dangerous and hostile nature, as in a Werner Herzog film, here nature is benevolent and the danger comes exclusively from men. Could we say that this is a tale of survival, not from Nature, but from Man?
Of course. I’ve been on a lot of dangerous expeditions. My very first magazine assignment was a river expedition on the Dadu river, on the edge of the Tibetan Plateau, for Outside magazine. A man died in my arms. He had fallen into the water and found himself trapped in a tree trunk, as the river rose inexorably. We held his head and tried to pull him out with ropes and pulleys. But we couldn’t. The river rose over his head, swallowed him up and he drowned. So I have seen the pitiless, unforgiving quality of Nature. But I think in general, most of the trouble comes from human beings.
Jack is not only a ranch kid or cowboy, tough, brave and resourceful, he’s also cultured and reads poetry, especially haiku. That makes him a perfect and complete gentleman, with a healthy spirit in a healthy body.
Indeed! I love Jack! In The River, Wynn was based on a very dear friend of mine, named Jay, an ephemeral artist and consummate outdoorsman. That made me a little bit like Jack, even though I’m not like him. He is ten times tougher, but his approach to people in the world is very similar to mine, even though he’s a little more wary. He’s like a sort of we-trust-you-when-you’re-worthy-of-the-trust guy. One could say he’s a little bit of a doppelganger.
You mention a fictional discussion between Jack and the writer Marilynne Robinson. He asks her what Evil is, and she replies: “the impediment to being”. Is this an authentic quote? Do you make it your own?
I went to Iowa Writers’ Workshop late, at the age of thirty-three, and I applied to both the fiction and the poetry schools to double my chances. I got into both. It’s a very famous workshop, and I was one of the first to do the poetry and the fiction together, which was a really fun experience. Marilynne Robinson was my mentor in fiction, and we became friends. One day, as I was in her backyard, we were drinking iced tea and chatting. Since she writes a lot about religion, I asked her what she thought Evil was and she didn’t hesitate to answer: “impediment to being“. I thought about that for years and it occurred to me that this expression wasn’t so much about the mountain lion hunting and devouring the elk or the deer but it was more about a subversion of the natural order. And that’s what I think is happening in my book, at this lodge, it’s the reason why I put the quote in there.
Another silent, topical threat is COVID. Was this a way of anchoring the story in a certain reality, a very specific context?
I was writing my story along, in the middle of the COVID epidemic. It was tough for me because, though I still was writing at home and I could go kayaking with my friends, my father died during this epidemic ; and I couldn’t go visit him when he was sick, it was too risky. Other friends got very sick too, and that was, for me, a real hard experience. When I write, I try to base myself on real facts that can form elements of a larger plot. In other word, what’s going on that’s most concerning to my heart is going to make it into the book and form the novel. And so, I chose to deal with COVID because it had a big impact on me, personally. It had to make an appearance, and it did.
All the characters seem to be hiding secrets. Secrets are synonymous with suspicions and conspiracies, especially during COVID, when conspiracy theories were widespread. Do you think we’re living in an era of generalized mistrust? You never know your neighbor, and you never know what might be going on next door. And it’s the case in here because people hide secrets and we don’t know exactly what’s happening in Kreutzer’s house.
There are two radically opposite things going on in the American society. Indeed, in some places, communities are pulling together to take care of each other. And I see that out in the country, where I live. But on the other hand, elsewhere, places get gripped by fear and people retreat into their own circle, their clan, their tribe, maybe even their house, their family and they don’t trust their neighbors, they are scared. Besides, we have to endure all these shootings….
I think there is a big tension, an impulse in America. In small communities where everyone sees and knows evereyone else, people are encouraged to get together. But urban settings, especially the horrible, sterile, vacuous suburbs where people are pushed together (but spaced out enough that they don’t know each other), are a breeding ground for all sorts of mistrust and disinformation, so I think there’s both going on.
In your previous book, Jack discovered the true meaning of friendship. Here, he discovers love, with Alison, a famous singer. They’re no longer a couple of adventurous friends, but adventurous lovers. In both cases, it’s a race against death. It’s a rather eventful initiation story for Jack.
That’s interesting because no one’s ever said that before. That’s really true! His sense of friendship was put on the fire in The River to the ultimate test and they came together. And I think that’s true in The Guide, from a love point of view. It’s his first real experience with romantic love and those two together are very strong, they really complement each other. And it made me so happy every time I wrote a scene where they had dialogue because they have such a sympathy, they both understand each other’s sense of humor. They have a quick wit and they’re game.
Alison may be a mentor to Jack. Indeed, she gives a real life lesson. “She knew how to be absorbed. That was something else Jack had noticed about people who had attained a mastery in a chosen discipline, that ability to be immersed. Focus was one thing and necessary but it was active. […]. The energy went from the actor to the activity. […] What he’d noticed in all true masters was that the focus turned soon, or immediately, into full absorption by the act itself. The actor surrendered, and it was as if, like a change in tide, the energy was now flowing in the opposite direction – from the river […] into the one who was doing.” Our actions define us, it is almost existentialism.
That’s right. He finally notices that the energy flows from the activity to the actor, so that they are swept up in the flow. It’s the first time he’s witnessed that flow and articulated it. And I think that brings a lot to his own education.
In The River, you write of Jack, “Everybody he loved most, he killed. One way or another.” Here, he no longer kills involuntarily but saves, without revealing the ending. Has he found some kind of redemption?
For sure! I think the last scene, without giving it away, speaks to a relinquishing him; in the end he relinquishes himself to trust he can finally feel for others, and that’s what the very last scene means to me. And that’s really reassuring for a man who says he’s been through such a difficult time as he has.
The Guide has a humanistic side: the book can be seen as a critique of the commodification of bodies, the self-isolation of the rich. Maybe it’s because you’re a man with a strong sense of social or environmental commitment (I’m thinking in particular of your experience with Sea Shepherd on the slaughter of whales and dolphins in Japan).
I feel strongly that the growing wealth gap – I don’t know about Europe, but certainly about the United States – between the very rich and the poor is obscene and is ruining our society. It makes me crazy. It’s appalling that people have to hold down two jobs to survive. When I go fishing, for example, I go to Starbucks, have my coffee and always talk to this barista who admits she can barely pay her rent… I also talk to the waiters when I go out to dinner, and they all tell me that they live half an hour away from the center of town, often in shared flats, and many of them also hold down two jobs… I think so much of the country is living one paycheck away from disaster. And then there are the lucky ones. I feel so lucky that I can go fishing and do what I love to do.
This, of course, makes things a lot less fun. It’s hard to enjoy a certain privileged lifestyle when so many people around you are suffering and barely surviving. And I don’t think this has anything to do with individual situations, with the human heart or a so-called lack of humanity. It has to do with an entrenched system, rooted in our history and culture, this terrible systemic way in which, I hate to say it, capitalism expresses itself in the United States. I’m not a communist. But I do believe in the social-democratic model that I see a bit of in France, or Scandinavia, and its system of social security and minimum income, in which no one (or almost no one) can get obscenely rich without others being able to benefit from healthcare or housing.
The United States should be more like Sweden. That’s what I think.
Kelly, the customer service and marketing employee, embodies this artificial, consumerist side, disconnected from real life. She is subject to an accounting logic of efficiency, not open to the beauty of things, to poetry. Even if Jack realizes that he needs to qualify his portrait of her, do you think we’ve lost the ability to contemplate Beauty? Especially when it comes to Nature?
I think many of us have! There’s too much information coming in, too much emphasis on making money and status. We’ve forgotten how to just stop and listen to a mountain stream. I was in Saint-Malo lately, it allowed me to recharge my batteries and ask myself the questions that really matter: how to take the time to remove your shoes, walk along the wet sand, listen to the seagulls, feel the sea wind. We need a time to reconnect with the most basic things. Let’s not forget that we came up in small tribes, we lived under shelves of rock, exposed to the elements (the rain, the weather…) and dependent on herd migrations etc. This is in our DNA.
Jack’s motto, “What could be better?” is like a leitmotif, as if he’s trying to convince himself. Again, this emphasizes the contrast between the idyllic landscape where he lives and the ugliness of what happens there. Is it something that you wanted to point out ?
Sure. It’s something I tell myself often while I’m driving down the road to go fishing. If I’m feeling low, it’s a way of convincing myself and remembering. But other times, it’s just an acknowledgement of gratitude. And I just wanted Jack to have this sort of same practice that I have because he’s a little bit like me.
We won’t reveal the ending, but it’s practically like being in an action movie. Has a film adaptation ever crossed your mind?
Yes and I hope somebody picks it. I think it would be a wonderful movie. I hope it happens.
You originally published reportage and non-fiction books. What made you take the plunge into fiction?
It’s what I’ve always wanted to do, ever since I read the Hemingway short story we talked about. I wanted to write fiction. At college, I studied comparative literature and biology. I thought it was important to know the difference between a spruce and a pine, to recognize the different species of birds and plants, because I knew I was going to write about nature. Then, I got out of college and had to make a living, so I started writing for magazines.
I was writing for Business Week. It can be surprising but I had followed an editor through a bunch of magazines and one day, he called up and said:
“Do you want to write for Business week?“
“No, I replied.“
“Why not?“
“Because it’s Business Week, I don’t want to write business articles.“
“Look, you can write about anything you want. Just make sure you put a pie graph in there with some dollars.“
It’s amazing what you can write about with a pie graph!
Anyway, they were paying very well; so I wrote some stories for them. I then had nine months free to devote to working on the novel I’ve wanted to write since I was eleven. So I wrote The Dog stars in seven months, a thousand words a day. I told to myself: “just sit down, don’t think, just listen“. I heard Hig’s voice like he was on the other side of the campfire on an October night, telling me what had happened to him, it was the most thrilling thing that I’ve ever experienced. Writing fiction for me was more like coming home than making a big change. Indeed, when I was writing for magazines, I used certain techniques, such as lyricism and poetry, as much as I could, and I developed them so that I could reuse them later for fiction. So it wasn’t a waste of time. It was like a training ground.
Your next novel will be The Last Ranger, which will be published in August. Can you tell us more about it?

It’s simply about a enforcement ranger in Yellowstone National Park who likes wolves better than people and it gets him in some trouble. It’s a love story, just like The Guide and it was very fun to write. I love going to Yellowstone every fall. For the past few years, I’ve gone up into a remote part of the park and camped for a couple of weeks right in the fall, gone up the creeks, fished and seen wolves, bisons and elk. Each time it was a wonderful experience. So I thought it would be really fun for me to write a novel place set there.
Crédit photo : © Guillaume Narguet pour Zone Critique