Dans son dernier ouvrage, Un Jeune Homme simple, Dominique Fernandez, de l’Académie française, évoque des sujets d’une actualité brûlante : la trépidante vie parisienne, que découvre un jeune provincial auvergnat, soumise aux injonctions de la mode et de l’actualité martelées par les réseaux sociaux et qui menacent d’excommunication quiconque ne désire pas les suivre ; l’uniformisation du mode de vie des homosexuels, autrefois communauté marginale qui tend à perdre son côté contestataire en se compromettant avec les normes majoritaires ; la compromission du monde de l’édition avec des impératifs commerciaux, qui la contraignent à accorder sa priorité au lucratif et à l’immédiateté au détriment de la qualité littéraire.
Dans un roman percutant, à la plume parfois caustique et désabusée mais toujours empreinte d’humour, Dominique Fernandez parvient à restituer avec une grande fidélité, en peintre de la vie moderne, les travers de notre époque superficielle.
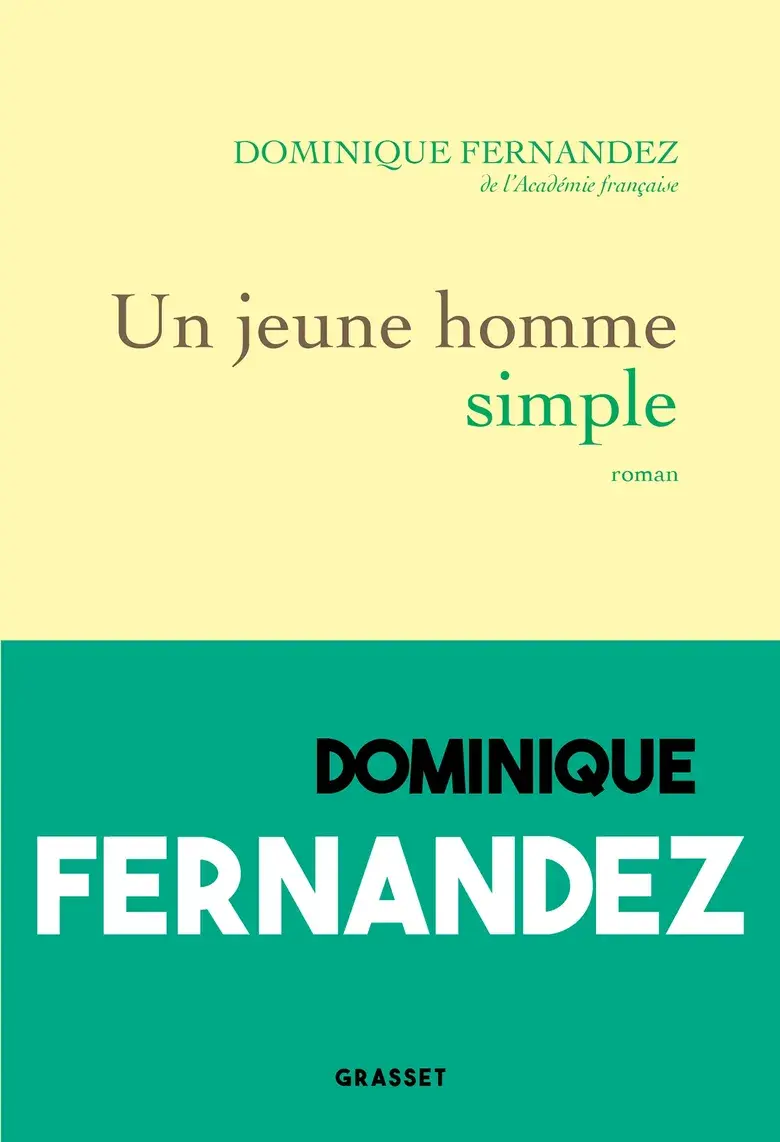
Un Jeune Homme simple raconte l’histoire d’un jeune provincial encore innocent issu d’un petit village d’Auvergne qui, selon l’expression consacrée, monte à Paris pour faire l’apprentissage de la vie, terminer ses études et espérer se lancer dans une carrière littéraire. Peut-on dire qu’il y a du Candide et du Lucien de Rubempré chez le jeune Arthur ?
Je dirais plutôt Candide l’ingénu que Lucien. Arthur est ce jeune provincial issu d’une région très enclavée et qui découvre Paris en même temps que la modernité. J’ai préféré insister sur son côté naïf et pur plutôt que de mettre l’accent sur l’arrivisme, qui est la particularité de Rubempré et pas du tout celle d’Arthur.
Cet ouvrage se lit comme un conte moderne ou un roman à thèse. Il est, dans sa structure (avec des dialogues qu’on pourrait qualifier de socratiques entre le maître et le disciple), dans son contenu, ses thèmes et même le titre, similaire à votre précédent ouvrage en deux volumes, l’Homme de trop. Sans évoquer une suite, car les personnages sont différents, peut-on dire d’Un Jeune Homme simple qu’il se situe dans sa lignée ?
Oui, dans la mesure où ces deux ouvrages sont une critique indirecte de l’évolution des mœurs, et en particulier des mœurs gays et de leur embourgeoisement. C’est en effet un thème qui est commun aux deux titres.
Vous aviez habitué votre lectorat à des odes à l’Italie ou à la Russie, qui apparaît dans l’Homme de trop. Ici, c’est la pascalienne Auvergne qui obtient vos faveurs et que vous dépeignez minutieusement. Qu’est-ce qui vous a séduit dans cette région ? Son côté encore un peu sauvage, janséniste, voire puritain ?
Cela s’explique tout d’abord par le fait que ma mère était auvergnate. Elle venait d’un petit hameau, un peu perdu dans les montagnes, encore plus modeste que celui que je décris dans mon roman. Et c’est cela qui m’a tout d’abord inspiré. Je possède aussi une maison de campagne près de Perpignan, je m’y rends tous les étés en voiture. Et à chaque fois que je parcours le trajet depuis Paris, je traverse l’Auvergne (Clermont-Ferrand, Millau…). Pour moi, c’est une très belle région que je trouve encore très protégée, avec des paysages sauvages ou désolés, comme ces grands plateaux déserts qui s’étendent à perte de vue. L’Auvergne fait partie des provinces françaises qui restent préservées du gâchis touristique et qui conservent encore leurs traditions.
Tout l’enjeu de l’ouvrage réside dans l’écart entre une vie provinciale authentique, parfois rude et austère, et la vie parisienne foisonnante, intellectualiste, artificielle et qui suit les dernières modes. Le risque était de verser dans le manichéisme. Comment avez-vous évité cela ?
Cela s’est fait naturellement, sans que j’en aie forcément conscience. C’est un fait que cette province-là (même si j’excepte les grandes villes comme Clermont-Ferrand, qui a beaucoup évolué), celle des petites villes ou des villages modestes, est très en retard par rapport au mode de vue urbain, mais est-ce un mal ? Il n’y a pas de trains, les routes ne sont pas très entretenues… Je me livre plutôt à un état des lieux, sans opposer la capitale à la province. Et si c’est cette impression qui domine à la lecture du roman, je répondrai que ce n’est pas moi qui suis manichéen, c’est la réalité qui l’est.
Le décalage avec l’Auvergne est d’abord temporel, comme si elle était restée bloquée des années en arrière. Arthur est issu d’une famille d’instituteurs aux idéaux socialistes de la IIIe République. Ses parents l’enjoignent de trouver une promise. Est-ce une manière pour vous de forcer le trait ? La figure de l’instituteur prescripteur n’est peut-être plus aussi importante et trouver une fiancée plus forcément un impératif.
Mon grand-père (le père de ma mère) était instituteur, dans un petit village. J’ai donc grapillé quelques éléments de ma vie et de celle de ma famille qui m’ont inspiré pour la rédaction du livre. Je respecte beaucoup ce métier, je considère que les instituteurs sont des gens formidables. Je pense qu’il s’en trouve encore de « la vieille école », très méritants et dévoués à leur travail qui, il faut bien le dire, est plutôt ingrat. Ils sont mal payés et ne sont plus tellement considérés, comme ils pouvaient l’être sous la IIIe République. Je dirais que je me livre ici à un hommage à cette profession et loin de moi l’idée de les critiquer.
Vous dépeignez une vie parisienne où s’épanouissent une sexualité autrefois marginale et maintenant prisée, un féminisme militant jusqu’à la caricature, les nouveaux moyens de mobilité comme la trottinette. C’est un portrait de notre modernité mais de ce mot, nous ne pourrions finalement conserver que les quatre premières lettres, la mode. Notre époque moderne serait celle des injonctions en tout genre, sans vouloir faire de jeu de mots ?
Oui, c’est aussi celle d’une pensée unique ou, du moins, d’un état d’esprit conforme à ce qu’il faut dire, penser, à une certaine manière de se comporter en société. Pour prendre un exemple personnel, il y a, à proximité de mon domicile, un restaurant italien qui s’appelle Pink Mamma et devant laquelle se forme tous les jours (matin et soir) une queue gigantesque. Les gens arrivent à 11h30, patientent et n’entrent qu’une heure plus tard, qu’il fasse froid, qu’il neige ou qu’il pleuve, alors qu’il y a pléthore d’autres restaurants italiens tout autour. Je ne me prononce pas sur la qualité des plats qu’on y sert mais il existe une injonction qui, j’imagine, circule sur les réseaux sociaux qui sont comme des tour-opérateurs : « il faut absolument se rendre à cet endroit ! » C’est absurde. On y trouve de jeunes étrangers, touristes de passage, mais on y repère également beaucoup de Français parisiens. Voilà un exemple d’obligation de se comporter comme tout le monde, d’adopter les mêmes attitudes et habitudes, oserais-je dire des rituels. Ce phénomène est bien plus prégnant de nos jours et j’ai tendance à considérer que cela s’aggrave. C’est une mode, assez terrible, imposée par le commerce : vous achetez des espaces publicitaires qui vous ordonnent presque de venir dans ce restaurant et qui vous culpabilisent si vous ne cédez pas ; dans ce cas, vous n’êtes pas « branchés », vous avez raté quelque chose et votre séjour n’est pas aussi réussi qu’il aurait pu l’être. Nous sommes dans une société de l’apparence et de l’uniformité. C’est curieux car autrefois, les jeunes voulaient au contraire se marginaliser, se distinguer, alors qu’aujourd’hui, ils ne souhaitent qu’une chose : se fondre dans la masse. J’ai l’impression, mais je peux me tromper, que c’est plus prononcé à Paris qu’ailleurs. Il me semble que cette injonction, cette soumission à la mode est moins forte en Italie par exemple. Cela dit, j’ai remarqué qu’à Naples, où je me suis rendu il y a quelques mois, tous les garçons ont maintenant une coupe de cheveux particulière, rasés sur les côtés et longs dessus. C’est une mode assez curieuse. Quant aux filles, elles mettent du rouge à lèvres très criard et les cheveux de toutes les couleurs ne sont pas rares. C’est une manière de se distinguer tout en étant conformiste.
La modernité serait l’époque de l’exhibition, du voyeurisme, qui répondent donc à des impératifs commerciaux. Comme vous l’écrivez en prenant l’exemple du cinéma : « l’exhibition du désir ravale le sentiment amoureux. » L’amour pur et désintéressé a-t-il encore sa place à notre époque ? Et pensez-vous qu’il puisse vraiment être épargné à la campagne ?
Je l’espère ! Je pense que l’authenticité des sentiments est toujours préservée, même à Paris. L’amour pur est toujours moins visible que l’étalage des sentiments faux ou factices, même s’il est un peu démodé aujourd’hui. Ce n’est plus forcément l’amour qu’on recherche aujourd’hui, mais la consommation du désir et le sexe. Les relations commencent à un âge très jeune et l’échangisme vient rapidement. Je connais bien sûr de nombreux couples jeunes et fidèles, mais il y a davantage de consommation de sexe qu’autrefois.
Vous faites de nombreuses références à l’actualité. Ainsi, Paris est polluée, en perpétuels travaux, le nom d’Anne Hidalgo est d’ailleurs mentionné. Tout y est facile et superficiel : « Il n’y a plus d’aventure, plus d’inconnu. » Quel regard le Parisien que vous êtes porte sur cette ville et ce qu’elle est devenue et êtes-vous pessimiste quant à son évolution ?
Il y a des choses que j’approuve malgré tout. La place Pigalle est actuellement en travaux mais elle sera très belle quand ils seront terminés. Les projets d’aménagement de la mairie du 9e sont bien pensés. Mais il y a de nombreux autres endroits qui sont très critiqués. Il est difficile de juger car nous sommes en pleine transformation. Les villes évoluent, plus vite que le cœur des mortels comme disait Baudelaire, mais c’est normal. La rue où j’habite depuis plus de quarante ans n’a pas changé dans sa structure, elle est homogène et elle est restée telle qu’au XIXe siècle. C’est le quartier de la musique, on y dénombre quantité de boutiques d’instruments de musique, surtout les guitares, la percussion. Il y a de nombreux jeunes, c’est vivant. L’évolution de la rue a surtout été sociale : quand je suis arrivé, c’était un quartier populaire mal vu et peu cher, où circulaient des prostituées. Puis, il a changé de caractère et s’est boboïsé au fil des ans. La population moins fortunée a dû partir en banlieue ou ailleurs et une nouvelle jeunesse s’y est installée, des cadres pour la plupart, qui ont attiré les boutiques de luxe, belles mais assez inaccessibles et souvent ridicules avec des noms loufoques comme l’Empereur du saumon ou l’Artiste du cheveu. Mais cela concerne Paris intra-muros dans sa globalité, même les 19e et 20e arrondissements. Bientôt, il y aura une véritable séparation entre Paris et la banlieue. C’est dommage car autrefois, il y avait un certain caractère, celui du Paris populaire. Maintenant, la prostitution a disparu, les filles se retrouvent près du périphérique ou dans les bois de Vincennes ou Boulogne. Elles n’ont rien gagné, c’est d’une hypocrise sans nom. J’ai connu la dernière, qui s’est retirée il y a trois ou quatre ans ; elle était dans une situation très triste, à soixante ans avec son faux sac Chanel en bandoulière ; elle portait sa vie malheureuse sur le visage. Il y a toujours des sex-shops sur le boulevard de Clichy, je pense à l’énorme Sexodrome par exemple, mais ce n’est plus ce que c’était.

Vous reprenez l’un des thèmes de l’Homme de trop, qui consiste à dénoncer l’inauthenticité des rapports humains, la consommation intensive et le marché du sexe, la satisfaction immédiate du désir, la disparition de la séduction et du risque, notamment au sein de la communauté homosexuelle. Pourquoi, à votre avis, est-elle davantage touchée ? N’est-ce pas aussi le lot des hétérosexuels, dans une logique de commercialisation des rapports sociaux ?
Autrefois, les hétérosexuels étaient libres. Les homosexuels, quand j’étais jeune, étaient des parias, combattifs mais toujours à la marge. Les gays de nos jours (j’en connais qui sont beaucoup plus jeunes que moi) se sont embourgeoisés à une vitesse incroyable. Ils ne ressentent plus aucune envie de jouer un rôle quelconque, ils profitent de la consommation, du système général. Je suis bien sûr content qu’ils soient libres, mais je trouve cela cher payé. Ils n’ont plus besoin de rien dans la société, ils sont comme les autres, des petits-bourgeois. Ils perdent leur spécificité. Être gay dans ma jeunesse, c’était être exclu de la société et parce qu’il était exclu, le gay formulait une vive critique de la société et de ses valeurs : la famille, le mariage etc. Maintenant, ils fondent eux-mêmes des familles, se marient… Tant mieux s’ils sont heureux, j’ai même milité pour le mariage, tout en l’excluant pour moi-même, car je trouve cela un peu ridicule pour un homo. Mais un contre-pouvoir s’est perdu, annihilé devant l’uniformisation du tout. Les conditions de vie se sont améliorées mais en réclamant le droit à l’indifférence, pour reprendre la formule de Jean-Louis Bory, ils ont perdu la différence, donc leur originalité.
Être différent des autres permet de les juger, voire de les mépriser, tout en les enviant en et en souffrant.
« Être homo, c’était une attitude générale devant la société : le refus de penser que les règles imposées par la société sont de bonnes règles. » C’était donc en effet un acte politique de revendication. Ce qui est paradoxal, c’est que les homosexuels n’ont jamais autant revendiqué qu’aujourd’hui pour bénéficier de nouveaux droits.
Ils sont politisés « dans le sens du poil », non pour combattre, mais pour profiter des avantages qu’ont les autres. C’est assez triste. Je remarque cela depuis une vingtaine d’années. Ce raisonnement est apparu avec le Pacs, pour lequel j’ai milité farouchement, car il est en effet très différent du mariage : il permet de bénéficier d’avantages matériels (impôts, héritage…) alors que le mariage est, à mon sens, superfétatoire. Et ensuite, la mentalité a évolué. Puisque les homos ont obtenu le Pacs, pourquoi s’arrêter à cela et ne pas obtenir toujours plus d’égalité de droits ?
« La seule fierté que nous ayons, c’est celle d’avoir vécu dans la honte ! ». Peut-on voir cela, chez vous, comme quelque chose de romanesque ?
Oui, la culpabilité, la honte, le paria, le sentiment d’être exclu, c’est toujours excitant d’une certaine façon. Être différent des autres permet de les juger, voire de les mépriser, tout en les enviant en et en souffrant. C’est tout le tragique de l’existence qui est révélé ici. Mais quand on est semblable aux autres, on n’est plus rien du tout. Que peut dire un roman de personnes toutes semblables les unes aux autres et qui ne se démarquent pas ? Cela dit, l’indistinction n’est pas tout à fait applicable à la vie à la campagne, où il reste beaucoup de discriminations et d’homophobie, même si celle-ci n’ose plus tellement se manifester au grand jour car elle est passible de sanctions pénales. Mais elle reste malgré tout tapie dans l’ombre, sournoise, et quand elle peut s’exercer aux dépens des plus faibles, au sein des villages notamment où tout le monde se connaît, la situation n’est pas facile. Être gay dans un village est quasi impossible car on risque d’être ostracisé, la seule solution est de déménager. C’est vrai aussi dans certaines cultures, comme chez les musulmans où il y a beaucoup de non-dits. Alors que tout le bassin méditerranéen est gay ! Au Maghreb, comme les relations avec les femmes sont interdites avant le mariage, les garçons font leur éducation sexuelle entre eux.
Dans la Littérature occidentale et le Moyen Age latin, Ernst Robert Curtius analyse un poème anonyme du XIIe siècle, le Débat de Ganymède et d’Hélène (Ganymède auquel vous avez vous-même consacré un ouvrage, le Rapt de Ganymède). Ce poème compare les amours masculines et féminines et avance l’idée que l’amour des garçons est un signe de goûts aristocratiques et cultivés, tandis que ce sont les paysans qui préfèrent les femmes. La même logique semble ici à l’œuvre : le paysan Arthur reste hétérosexuel malgré les tentations de la vie parisienne et son colocataire citadin Stanislas est homosexuel. Pour autant, validez-vous cette vision, déjà ancienne, des rapports entre hommes et femmes ou pensez-vous qu’il faut l’actualiser au regard d’une certaine mode qui voudrait « qu’il faut en être » ?
Cette différence se trouvait déjà chez Platon. L’idée qu’il y avait la Vénus noble, désintéressée (l’amour des garçons) et la Vénus procréatrice qui est inférieure est décrite très clairement dans le Banquet. Cela s’est reproduit au fil des siècles. Aux temps modernes par exemple, il y avait d’un côté les bourgeois qui voulaient fonder une famille et de l’autre les esthètes. Aujourd’hui, encore une fois, cela s’est uniformisé : si les homosexuels ne peuvent pas se reproduire, ils peuvent adopter, recourir à la PMA ou la GPA.
Les derniers rebelles romantiques sont les transsexuels, non binaires, qui refusent le modèle majoritaire du mariage, de la famille. Vous portez un regard nuancé : d’un côté vous reconnaissez leur volonté de se différencier mais de l’autre, vous craignez les risques que comporte le caractère irréversible qui se traduit par l’opération du changement de sexe. Stanislas y voit l’expression d’une souffrance, d’un mal-être. Le phénomène ayant pris plus d’ampleur et de visibilité ces derniers temps, s’agit-il d’une réaction à l’injonction de se fondre dans la masse ? Ou est-ce un autre avatar de notre société de consommation qui pousserait à une nouvelle mode, celle de la non-binarité ?
Il y a beaucoup de trans ou de candidats à la transsexualité. J’ai des amis enseignants qui me disent avoir parmi leurs élèves des garçons qui viennent en cours habillés en femme, maquillés… Je ne suis pas assez compétent pour avoir un avis tranché dessus. Je crois qu’il s’agit d’un véritable problème, d’ailleurs assez douloureux car il y a des opérations qui se déroulent mal et l’on ne peut pas revenir en arrière, ce n’est pas anodin. Ou bien les parents s’opposent au choix de vie de leur enfant et tout le monde en souffre. Je suis comme Stanislas, j’observe mais de manière inquiète car on ne sait pas vers quoi l’on se dirige. C’est un phénomène trop récent pour émettre un jugement. Mais cela existe et a toujours existé, même si l’on n’en parlait pas autrefois. Maintenant, on en parle davantage, c’est plus visible. Ce qui pose des problèmes dans les lycées : que peut-on permettre ? Jusqu’où aller sans dépasser de limites ? En général, les camarades acceptent, paraît-il, mais cela peut toujours faire l’objet de ricanements, d’humiliations. Je voulais montrer que ce problème existe, de même que les troubles que cela comporte.
Vous opérez un renversement des valeurs en mettant en scène, à l’intérieur du roman, une sorte de mystère médiéval dans lequel Stanislas joue un homosexuel repenti qui se « convertit » à l’hétérosexualité car elle serait une nouvelle forme d’anticonformisme (puisqu’être gay est devenu conformiste) et de minorité. Vous maniez avec brio l’ironie voltairienne. Ce recours à l’ironie est-il le reflet d’un constat très désabusé, amusé ou agacé de votre part sur l’évolution des mœurs ?
Cela m’a amusé, c’est une hypothèse, une chimère, qui traduit aussi mon agacement devant ce désir des homos d’assimiler toutes les caractéristiques des hétéros.
N’y a-t-il pas une limite dans le raisonnement de Stanislas, à savoir que chercher l’anticonformisme pour le plaisir de l’être reviendrait à adopter de fait un certain conformisme ? Le conformisme de l’anticonformisme.
Cela reste malgré tout, vous me l’accorderez, moins conformiste que le conformisme actuel ! Je n’ai pas encore vu d’exemple de conversion à l’hétérosexualité. Stanislas est un précurseur.
Un autre grand thème abordé dans le roman est celui de la dévaluation de la littérature et son corollaire le monde de l’édition, soumis à des impératifs économiques. Ainsi, l’objectif est la rentabilité et, pour ce faire, il faut que les romans soient hors sol, des romans-monde pour citoyens du monde, sans attaches ni racines. D’où l’insuccès du roman du terroir d’Arthur, qui est rabaissé et dévalorisé. Pensez-vous qu’il est encore plus difficile pour les bons romanciers aujourd’hui de se faire une notoriété et d’être publiés ?
Je travaille depuis toujours dans l’édition. Quand j’ai débuté, il y a très longtemps, le jugement littéraire était primordial. Si je trouvais un manuscrit excellent, on le faisait circuler et il était publié. Aujourd’hui, on peut trouver un manuscrit bon mais le plus important est de savoir qui est l’auteur, s’il a un réseau, s’il aura droit à des articles, s’il pourra faire vendre, s’il fera du chiffre. Les réponses à ces questions forment les trois quarts du jugement et, parfois, on écarte le bon manuscrit car on pense qu’un auteur inconnu ou un sujet un peu inactuel ne se vendra pas. L’aspect commercial a pris de plus en plus de place, de même que la mode du moment qui est liée. Le commerce et la mode dépendent l’un de l’autre. Aujourd’hui, il s’agit du genre, de la non-binarité… Demain, ce sera encore autre chose.
Aujourd’hui, on peut trouver un manuscrit bon mais le plus important est de savoir qui est l’auteur, s’il a un réseau, s’il aura droit à des articles, s’il pourra faire vendre, s’il fera du chiffre.
Dans votre roman, l’éditeur cède aux lubies du moment : il défend en effet la théorie du genre, la non-binarité… Cette irruption du fait sociétal, du politique en littérature ou en art (par exemple, le fait que des personnages noirs au théâtre doivent être interprétés par des acteurs noirs) est-il plus dangereux que jamais ou cela passera-t-il, comme toutes les modes ?
Cela concerne pour l’instant surtout le théâtre. Je donne, dans le roman, l’exemple de la mise en scène d’Aïda par Lotte de Beer en 2021, à l’opéra Bastille. L’interprète, une femme blanche, chantait au fond de la scène et sur le devant, on animait un mannequin noir qui faisait semblant de chanter. C’était le comble du ridicule. Aïda étant éthiopienne, il fallait qu’elle soit noire… Il n’était pas convenable qu’elle soit chantée par une blanche.
Dans l’édition, les grands sujets à la mode sont ceux qui traitent de l’actualité (les femmes violées et battues, le climat, l’éco-responsabilité…), ce n’est plus de la littérature mais du témoignage. Ces romans-là ont plus de chances d’être publiés que des livres qui traitent de sujets hors mode.
Vous mettez en évidence dans votre roman les contradictions inhérentes aux bien-pensants : ils veulent paraître altruistes et se donner bonne conscience alors que leur propre comportement est peu reluisant. Aristophane ou Molière avaient déjà évoqué cette duplicité en leur temps. Est-ce un travers habituel de la nature humaine ou pensez-vous que notre époque est plus violente de ce point de vue ?
Cela a en effet toujours existé mais j’ai l’impression que c’est, aujourd’hui, plus hypocrite, d’autant plus que cela est soutenu par des mouvements radicaux organisés qui militent pour l’interdiction de tout un pan de la pensée. Et c’est un phénomène nouveau, qui découle du féminisme radical américain né dans les années soixante-dix (avec Valerie Solanas etc.), et qui s’est très répandu.
Vous critiquez le recours au format court, dans un contexte où les capacités d’attention se sont modifiées, pour ne pas dire dégradées. Ce nivellement par le bas, qui consiste à s’adapter aux nouvelles modalités de lecture entre deux notifications sur Instagram, plutôt que de prendre le temps de l’analyse et de la réflexion, vous paraît-il irréversible ?
Pour les jeunes, c’est dramatique. Les lycéens ont les yeux rivés à leur écran, chez eux ou à l’extérieur, ils ne lisent presque plus et gobent toutes les fausses informations qui circulent. C’est un vrai problème, je ne sais pas comment on peut le résoudre… Il y aura toujours une minorité de lecteurs, certes, mais on risque de retourner au Moyen Âge où la lecture était l’apanage d’une élite de cinq cents moines qui diffusaient la littérature gréco-latine. Il y a une déculturation générale due à l’usage excessif des écrans.
Ironie du sort, le journal 20 Minutes vous a consacré un court article sur son site Internet intitulé « Un Jeune Homme simple de Dominique Fernandez feuilleté en deux minutes. » Y voyez-vous une illustration de ce que vous déplorez et qui, malicieusement, s’applique à votre propre ouvrage, comme une mise en abyme ou un cercle vicieux ? Le combat serait-il vain ?
Les critiques lisent de moins en moins les livres. Ils recopient la quatrième de couverture et cela leur sert d’article. Il n’y en a plus qui fassent autorité, comme Jacqueline Piatier du Monde par exemple, qui lisait deux fois le livre qu’elle critiquait et qui téléphonait à l’auteur quand elle ne comprenait pas quelque chose. Le journalisme littéraire a quasi disparu, du moins dans les grands médias.
Le seul domaine où les académiciens exercent une réelle compétence, c’est dans la rédaction du dictionnaire.
Vous faites plusieurs fois référence avec humour à l’Académie française. Vous décrivez ainsi des académiciens chenus plutôt ridicules. Est-ce une manière de verser dans l’auto-dérision ? Pensez-vous que l’Académie peut exercer une influence dans la lutte contre la marchandisation de la culture ?
L’Académie est là mais elle n’a pas un grand pouvoir contre cela. Et puis, tous ses membres ne sont pas brillants… Il n’y a pas beaucoup de marge de manœuvre : on écrit de temps en temps aux ministres, aux éditeurs, pour leur recommander de faire ceci et leur déconseiller de faire cela, sans grand effet. La force de frappe est limitée car elle n’a pas de pouvoir prescripteur. Elle exerce une sorte de magistère moral et une certaine influence dans les médias, elle produit des tribunes… Le seul domaine où les académiciens exercent une réelle compétence, c’est dans la rédaction du dictionnaire. Je fais d’ailleurs partie de la commission du dictionnaire. On réfléchit sur la définition de chaque mot, on pèse et soupèse. C’est un travail de longue haleine.
- Crédit photo : © JF Paga

















