Thanato-archéologue, Jennifer Kerner publie chez Les Arènes en 2021, aux côtés de Thomas Cirotteau et Éric Pincas, le très remarqué essai Lady Sapiens, Enquête sur la femme au temps de la préhistoire. Véritable succès, il paraît en poche en 2023 dans la collection « Proche ». La même année, l’autrice publie aux éditions Gallimard Le Mari de nuit, un livre hybride entre un récit de deuil et un essai sur les pratiques funéraires dans le monde. Son premier roman Le Tissu de crin, paru en avril dernier au Mercure de France, achève sa consécration en tant que romancière.
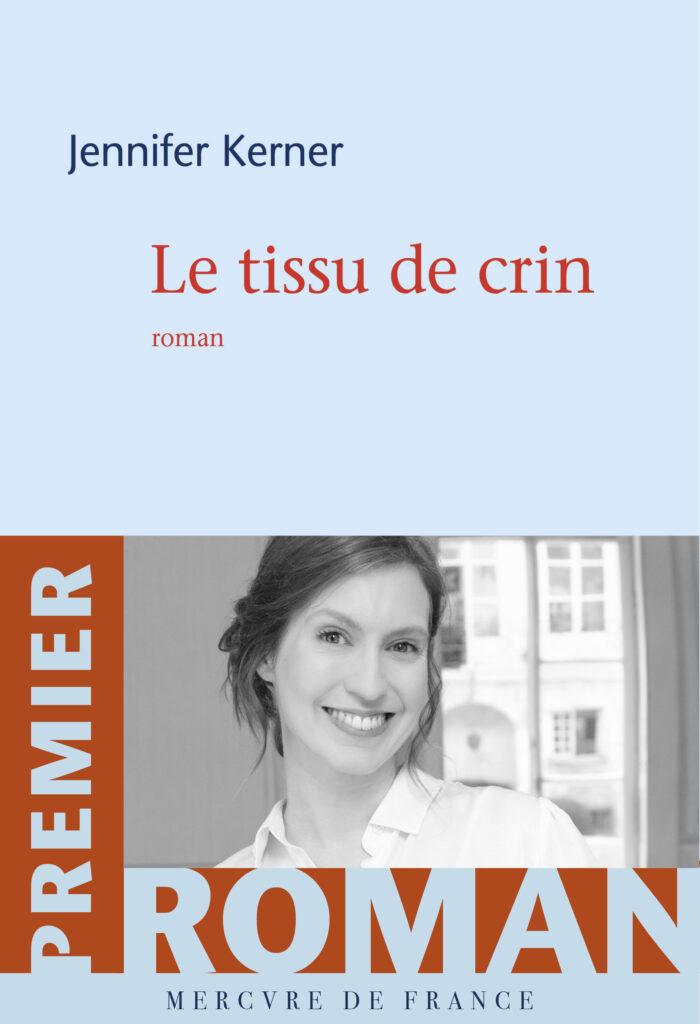
Estelle Normand : Le Tissu de crin est avant tout l’histoire d’une emprise, celle d’une première d’atelier d’une maison de haute couture, Ida, sur un mannequin cabine, Jean, jeune homme atypique aux prises avec un passé douloureux. Ce qui marque dès les premières pages de votre roman, c’est la profusion de détails historiques qui nous immergent tout de suite dans le Paris des années 1950, comment avez-vous procédé pour arriver à un tel degré de précision ?
Jennifer Kerner : Grâce aux archives de l’Institut national de l’audiovisuel. C’est mon côté archéologue. Je suis très friande de tous les petits détails du passé et surtout des choses du quotidien quelle que soit la période historique comme, par exemple, la couleur de la matelassure des bancs dans le métro. C’est le genre de choses qu’un écrivain peut inventer mais je trouve ça plus intéressant d’aller vers du détail historique puisque c’est ma formation. J’ai passé des heures à regarder des photos et des vidéos INA, à squatter dans les bibliothèques pour me donner l’impression d’être vraiment dans le décor. Je pense que je ne pourrais pas écrire sans cela.
Pour les sensations, c’est pareil, je suis très sensorielle dans ma manière d’écrire, je démarre toujours mes séances d’écriture en décrivant des sensations physiques dont je me souviens, qui m’ont marquée et que je trouve intéressantes d’un point de vue narratif parce que ça dit quelque chose sur mon état intérieur.
Ce qui m’intéresse dans l’écriture c’est la façon dont mon état intérieur se heurte à la réalité, aux interactions que je peux avoir avec l’extérieur.
EN : D’ailleurs, cette recherche de sensorialité a pu vous mettre en danger, notamment pour l’écriture d’une scène du livre qui se passe dans la tour Jean Sans Peur.
JK : Ça a été très dur. J’ai passé trois heures dans cette tour, je suis ressortie de là en étant glacée. Je voulais avoir la sensation physique. J’ai monté et descendu les marches inlassablement. Si je décris l’essoufflement, la matière de la pierre sous la semelle, c’est parce que je viens de le vivre. Je ne sais pas comment font les auteurs qui écrivent à partir de rien ou des choses vagues. Moi, j’ai besoin d’avoir l’air de la tour dans les poumons. Un air de crypte qui oppresse et met mal à l’aise, qui comprime les poumons sans être en action. Mon épuisement dans l’écriture participe, je pense, à l’immersion du lecteur.
EN : Vous êtes docteure en archéologie, vous avez été enseignante, la vulgarisation est un de vos dadas. L’inclusion d’anecdotes historiques participe bien à la mise en contexte, c’est très malin. Ressentez-vous un besoin de transmettre par le biais de la fiction ?
JK : J’aime beaucoup qu’on me transmette des anecdotes un peu rigolotes, un peu étranges. Des neurologues ont d’ailleurs fait des études là-dessus et ont montré que lorsqu’on apprend une information cocasse, étonnante, de culture générale, on reçoit des pics de sérotonine, d’endorphine, de bonheur ! C’est pour ça que sur internet ça marche si bien les infos étonnantes, les dix animaux les plus bizarres du monde… On aime ça. Et, comme je suis un « petit producteur de sérotonine », pour reprendre l’expression de Boris Cyrulnik, c’est-à-dire que je suis quelqu’un d’un naturel assez triste, je cherche ça pour moi en permanence et j’ai tendance à l’insérer dans mes écrits pour susciter le plaisir chez les autres. Je cherche davantage à donner du plaisir par l’apport de connaissances étonnantes plutôt qu’à faire passer un savoir académique.
EN : Votre livre est également traversé par de nombreuses références artistiques.
JK : Oui, l’esthétique y occupe une place importante. La sensorialité du tissu est présente, notamment quand Ida regarde une statue et s’attarde sur la manière dont le tissu est rendu dans le marbre. C’est fascinant. Cette figure-là m’intéressait particulièrement parce que le tissu c’est la chaleur, c’est la sensualité, tandis que le marbre c’est le froid, c’est la rigidité donc c’est la réalité d’Ida qui se confronte à ce qu’elle aimerait être en tant que femme et de ce qu’on aimerait toutes être en tant que femmes. Peut-être pas de manière instinctive, mais parce que c’est ce que la société nous ordonne de vouloir pour nous-mêmes.
EN : On sent bien cette contradiction chez Ida, une femme extrêmement froide qui brûle pourtant d’un désir fou pour Jean. Au début du roman, c’est une femme de cinquante ans, indépendante, forte. Elle existe en tant que telle, elle ne se définit pas par son mari ou par son enfant. Mais, peu à peu, son désir naissant pour ce jeune homme va tourner à l’obsession, et elle va commencer à se grimer, à tomber dans les diktats de la société.
JK : Complètement oui.
J’avais envie de montrer à quel point les codes sociétaux sont plus forts que tout quand on est en position de vulnérabilité psychologique et émotionnelle.
EN : Et comme elle ne sait pas se maquiller, ça donne quelque chose de terrible. C’est très étonnant de voir que cette femme dominante va finalement se mettre dans une position de soumission face à ce jeune homme.
JK : J’avais envie de montrer à quel point les codes sociétaux sont plus forts que tout quand on est en position de vulnérabilité psychologique et émotionnelle. Ida n’a jamais été amoureuse. Comme elle est émotionnellement détachée, elle peut se permettre d’être pleinement elle-même et de dire merde, si j’ose dire, à l’ordre établi. Mais, quand elle est en fragilité parce qu’elle a envie de séduire et de plaire, elle se raccroche à ce qu’on ordonne aux femmes d’être depuis toujours. Elle, elle commence à le faire à cinquante-trois ans, ce qui est quand même un peu étonnant.
Les femmes de nos jours le font très tôt, on nous l’impose très vite, on se confronte à ça très rapidement. Je trouvais intéressant de montrer une femme qui va acheter sa première crème à cinquante ans, son premier rouge à lèvres, qui tâtonne et se découvre autrement. Parce qu’on sait qu’on n’est pas la même avec ou sans maquillage, pour le meilleur ou pour le pire, ça dépend ! (Rires) J’avais envie de montrer à quel point c’est aussi une manière de contrer la vulnérabilité.
EN : Pour replacer l’histoire dans le contexte de l’atelier, puisque c’est une sorte de huis clos même si quelques scènes se passent à l’extérieur…
JK : En fait, je l’ai écrit comme un huis clos à la base. Au départ, il n’y avait absolument que les scènes à l’intérieur de l’atelier. Toutes les scènes qui se passent à Saint-Guilhem-le-Désert sont des scènes rajoutées pour la cohérence du personnage de Jean, pour le comprendre. À un moment donné, je me suis posé la question de les traiter en flash back mais je trouvais que c’était sensoriellement moins riche. Donc j’ai ajouté ces scènes tout en gardant l’ambiance du huis clos.
EN : Et ça participe à l’oppression. On sent que les personnages sont soumis à la domination d’Ida, pas seulement Jean mais aussi les petites mains, les cousettes. À ce propos, qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire sur le milieu de la haute couture ?
JK : C’est ma grand-mère qui m’a donné un imaginaire puissant de ce milieu. Déjà, j’ai grandi dans son atelier à elle. Enfant, j’ai joué dans les tissus, les boutons, le bruit de la machine à coudre et de la surfileuse… Tout ça est très ancré en moi, c’est pour ça que j’ai pu immerger le lecteur dans cette maison. Et puis, les histoires que ma grand-mère me racontait m’ont donné envie de faire mes propres recherches.
Ce que j’aime dans la haute couture ce n’est pas l’aspect mercantile d’aujourd’hui, l’aspect commercial. Maintenant, quand on parle de haute couture, on pense influenceurs, Dubaïotes… Moi, ce que je trouve intéressant c’est l’aspect artistique, la sculpture sur tissu. C’est un art très à part car c’est un des seuls arts qui ne peut vivre que sur les corps. La projection mentale de l’objet artistique en tissu et la manière dont il va se mettre à vivre sur les différents corps qui vont l’habiter me fascinent complètement.
EN : C’est vrai que le rapport au corps est assez particulier dans votre roman car, d’une part, les personnages vivent beaucoup dans leur tête et, d’autre part, le corps est omniprésent. Est-ce que vous avez voulu cette dichotomie entre cette omniprésence du corps et cette dimension très cérébrale des personnages ?
JK : Ça vient sans doute de mon expérience de danseuse. J’ai été danseuse classique puis danseuse sur glace. Il n’y a pas plus cérébraux et anti-sensuels que les gens qui travaillent avec leur corps tout le temps. À force de travailler sur la matière du corps, de faire du corps le centre de la réflexion artistique, on finit par l’instrumentaliser, l’objectiver, et, en quelque sorte, le détacher de son ressenti, de sa sensualité. Je pense que, pour quelqu’un comme Ida qui travaille sur le corps comme support artistique, il y a forcément une vision du corps qui est un peu contre-nature.
Pour Jean, c’est différent. Il a des difficultés avec son corps, il aimerait n’être qu’un esprit. D’ailleurs, il me semble qu’on est relativement nombreux, encore plus maintenant qu’en 1953, à être décorrélés de nos corps. On passe notre temps dans des bureaux, on réfléchit beaucoup, mais, à part pour se faire un summer body, on a très peu de rapports à notre corporéité dans le plaisir ou dans le vécu de l’instant.
J’avais envie de parler de personnages qui sont effectivement embarrassés de leurs corps et dont les corps parlent très fort.
Quand on veut faire taire le corps, il se met à crier, ça devient assourdissant, et c’est ça qui pousse à la violence.
Quand j’écrivais, je savais que j’écrivais un livre autour du problème du corps.
EN : En parlant de violence, c’est un roman sombre de par les nombreuses scènes de nuit mais aussi de par son imaginaire et son esthétique. Une scène m’a d’ailleurs bouleversée, celle de la jeune fille noyée dans la Seine. Quelle en est la symbolique ?
JK : L’omniprésence d’Ophélia, la fille virginale et noyée, c’est un poncif de la littérature classique. Je trouvais ça beau cette fille diaphane, blonde, qui flotte.
EN : La lecture de ce passage procure un choc esthétique.
JK : Oui ! Et le choc esthétique se heurte immédiatement à la violence de la réalité. On se dit :« Elle est jeune, quelle atrocité de se tuer si jeune, si belle, pour une bêtise ! ». Enfin, on a envie de se dire que c’est une bêtise un chagrin d’amour parce qu’elle aurait connu d’autres hommes. De toute façon, ce livre est une recherche constante d’esthétisme. Isabelle Gallimard dit que c’est un livre nervalien et je trouve que ce n’est pas faux. Il y a un côté romantisme désespéré, esthétisation du sombre, de la mort, du désespoir.
EN : Est-ce que vous trouvez que la beauté réside dans la mort ? Est-ce que la beauté peut être ailleurs que dans la mort ?
JK : La beauté peut être ailleurs que dans la mort, encore heureux, mais l’avantage de la mort c’est qu’elle fige la beauté, au moins pour un temps. Avant la putréfaction ! (Rires) C’est vrai que, pendant un temps, un mort c’est très beau. Ce n’est pas que de l’ordre du fantasme, l’aspect esthétique est très fort. Il y a de la beauté dans la vie bien sûr, mais c’est moins gracieux.
EN : Quand on meurt, il n’y a plus qu’un corps sans esprit.
JK : Exactement. Là l’objectification est claire. Il n’y a plus cette espèce de malaise, de tiraillement entre la présence de l’âme et la présence du corps. Là, il n’y a plus que la présence du corps et ça résout le problème ! (Rires)
EN : C’est une solution radicale.
JK : C’est bien pour la littérature, pas pour l’existence !
EN : On comprend d’où vient votre attrait pour la mort compte tenu de votre métier, mais pourquoi avoir choisi de traiter comme motif l’obsession, et même l’emprise ?
JK : Pour plusieurs raisons. La première est la volonté d’écrire sur l’obsession amoureuse qu’Ida connaît et qu’on a tous connu, au moins quand on était adolescent. Ça fait vingt ans que je suis avec mon mari donc mes souvenirs d’obsession amoureuse sont assez lointains mais je me souviens que c’est quelque chose qui fait à la fois beaucoup de bien et beaucoup de mal. Ça immobilise, ça tiraille. On est pris encore une fois entre l’immobilisme de la mort, puisqu’on n’arrive plus à vivre sa vie, et l’ardeur de la passion qui pousse plutôt du côté de la vie et de la consommation du désir. Le lecteur s’identifie à Ida avant de s’en désolidariser au fur et à mesure qu’il avance dans le livre. Il faut dire qu’elle est atypique, pour ne pas dire malsaine.
EN : Elle a un rapport aux animaux très perturbant.
JK : Oui, elle a clairement un problème. Ce que je veux dire c’est que même les personnes saines peuvent avoir une obsession malsaine. Mais, évidemment, on n’est pas obligé de passer le cap de l’oppression mentale sur autrui à cause de cette obsession.
La deuxième raison est que j’avais envie de montrer jusqu’où peut aller une personne obsédée qui a l’impression d’avoir les pleins pouvoirs sur les gens qui l’entourent. C’est vrai pour Jean mais aussi pour les cousettes qu’on sent à la fois terrorisées et fascinées par Ida.
Ayant fait des études de psychologie et ma mère étant docteure en psychologie, j’ai une grande culture psychologique. Les pervers vont établir avec les autres une domination exécrable et un lien de fausse affection, en tout cas d’admiration, qu’il leur donne du pouvoir sur les gens. En jouant sur la terreur et l’attrait, ils arrivent à les garder sous emprise. C’est ce que fait Ida sauf qu’elle n’est pas une simple perverse dans le sens où elle n’a pas la maîtrise complète de ce qu’elle fait. Des choses lui échappent. Sans parler de l’aspect psychopathique.
EN : J’ai eu le sentiment en effet qu’il n’y avait pas de mauvaise intention chez Ida car elle vit dans une espèce d’illusion.
JK : Tout à fait. Elle est victime d’elle-même. Victime de ce qu’elle crée chez les autres, mais elle ne sait pas vivre autrement. J’ai fait exprès de ne pas lui mettre un schéma classique de mère maltraitante ou de père absent parce qu’on peut développer aussi ce genre de problèmes sans avoir ces schémas familiaux. J’ai de l’empathie pour Ida parce que je la sens dépassée par ce qui lui arrive et par ce qu’elle provoque chez les autres. On ne sent pas de réelle jouissance chez elle à terroriser ses petites mains. Ça l’arrange un peu mais elle est surtout seule et elle en a conscience. C’est ce désespoir de la solitude qui la pousse à entretenir cette relation avec Jean.
EN : Et, finalement, il y a un effet miroir avec la solitude de Jean qui s’est exilé à Paris. Est-ce que la culpabilité de Jean était intrinsèque à son personnage ou est-ce venu après ?
JK : Elle est venue tout de suite. J’ai pensé Jean avec deux poids sur les épaules. Tout d’abord, le poids de son atypisme. Il est en décalage permanent avec les gens. C’est une première douleur et une première solitude. Ensuite, la solitude suprême c’est de se sentir coupable au milieu des innocents et de s’autopunir. Il ne s’exile pas pour se soulager mais plutôt pour soulager sa mère. Il part pour éviter des douleurs supplémentaires à sa mère.
EN : On peut dire que c’est aussi un livre sur l’impossibilité d’aimer. Impossibilité car Ida vit dans son illusion et Jean est incapable de développer des liens à cause de son atypie.
JK : C’est en effet un livre sur l’empêchement de créer un lien et la douleur que cela provoque. On assiste quand même à un petit miracle d’amitié entre Jean et une cousette… Certaines personnes sont des petites lumières au milieu des ténèbres. Sans oublier la mère de Jean qui est une figure de douceur absolue. On sent qu’elle a dû briller dans son existence mais qu’elle a été fatiguée par la vie. Je trouvais important qu’il y ait dans le livre au moins une personne qu’on aimerait croiser parce que tous les autres sont gratinés.
EN : La figure de l’arbre est aussi importante dans votre roman. Elle fait écho à Un roi sans divertissement, de Jean Giono, que vous aimez beaucoup. Pensez-vous avoir été influencée par ce livre ?
JK : Complètement. Ce livre est fondateur pour moi car c’est un livre sur la différence et sur la monstruosité qui peut se nicher dans des personnes qui ont l’air socialement intégrées. J’ai lu ce livre à l’adolescence et il m’a bouleversée. En le lisant, j’ai compris qu’on a tous potentiellement un monstre en nous. Explorer cette idée-là est à la fois vertigineux et rassurant parce que si on est capable d’y réfléchir, on ne va pas passer à l’action. De nombreux détails esthétiques à l’intérieur de mon livre sont clairement des clins d’œil à « Un roi sans divertissement ».
EN : Vous écrivez actuellement votre deuxième roman, sur quoi portera-t-il ?
JK : J’écris sur l’aristocratie en 2024. Mon personnage principal est une jeune femme tiraillée entre la modernité qu’on essaie de lui imposer principalement à travers son mariage. Elle est mariée à un roturier de gauche très présent sur les réseaux, très médiatique, alors qu’elle, elle est issue d’une très vieille famille aristocrate. Son mariage entre en contradiction totale avec les valeurs qu’on lui a inculquées depuis longtemps.
La pression sociétale qui s’exerce sur les individus m’intéresse particulièrement.
Et la manière dont on nous oblige à nous auto-enfermer, tous mes romans parlent de ça : d’enfermement.
- Crédit photo : Francesca Mantovani © Gallimard
- Le Tissu de crin, Jennifer Kerner, Mercure de France, 2024.

















