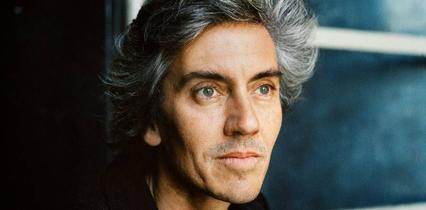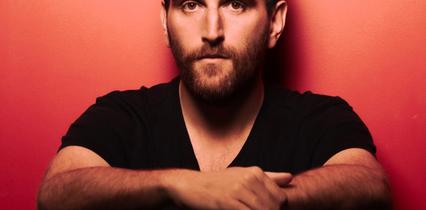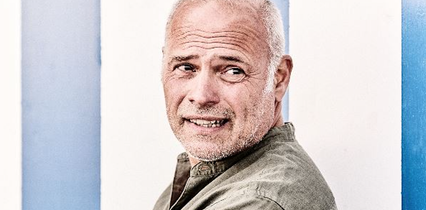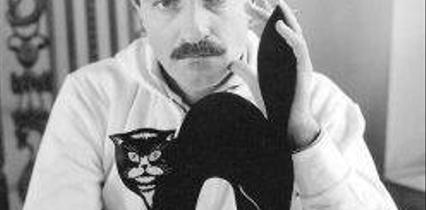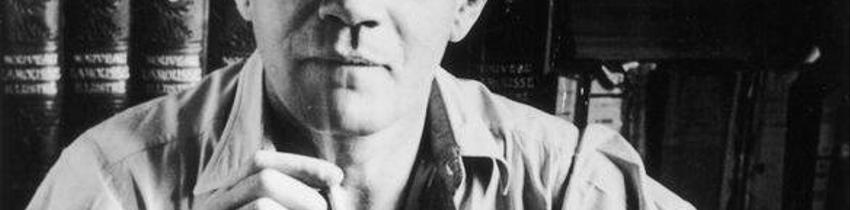« Fuck Eat Kill » de Lou Syrah succède à « Cellule» au sein de la collection Vrilles. Ultra sensoriel et convoquant différents niveaux de lectures, c’est à travers un face-à-face déroutant entre une patiente et sa psychologue que l’autrice nous interroge sur la condition de la femme et le sens que l’on donne aux mots. Un court texte poétique et engagé qui se bonifie à chaque lecture tel un bon vin.
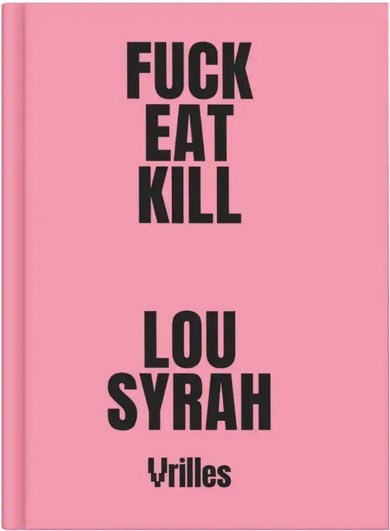
Estelle Derouen : Pour commencer, l’épigraphe est une citation de Gabrielle Wittkop. Puisque vous connaissez bien son œuvre et que vous êtes la présidente de La société des amis de Gabrielle Wittkop, comment interprétez-vous son propos dans la citation choisie : « Quand j’étais petite, des hommes me demandaient ce que j’étais. Ils attendaient que je réponde : une petite fille. Au lieu de quoi je répondais : je suis un tigre. » ?
Lou Syrah : Le tigre est l’animal fétiche de Gabrielle Wittkop qu’elle dit avoir rencontré lors de ses explorations en tant que journaliste dans le sous-continent indien. On le retrouve aussi dans toute son œuvre et notamment dans le Puritain Passionné, la nouvelle présente dans La mort de C, et que Margot Gallimard vient de rééditer dans la collection L’Imaginaire aux éditions Gallimard.
Le félin est au centre de ce récit. C’est l’histoire d’un homme qui nourrit une obsession pour la bête. On peut y lire son analyse, l’idée que la peur du tigre aurait remplacé celle des monstres dans l’imaginaire collectif après les conquêtes d’Alexandre Le Grand. Avant, on craignait les sorcières, les sirènes, et les sphinges et puis il y a eu l’animal prédateur.
Dans Le Puritain passionné il y a une autre phrase qui y fait écho : « jamais la chimère ne nous vient par la porte des libertés ». Moi je le lis comme l’idée que la souffrance et l’expérience personnelle de la persécution ou du rejet nous pousse à embrasser les monstres ou à les regarder avec un œil tendre. La phrase faisait sens avec mon livre. Elle fait sens surtout avec la vie de personnes comme Wittkop, une lesbienne née dans les années 1920 et qui a vécu dans les marges, au ban, avec cette étiquette de paria.
Je crois aussi, mais cette analyse n’engage que moi, que Gabrielle Wittkop a subi enfant des comportements qui pourraient s’apparenter à des violences sexuelles. Elle prétend avoir partagé le lit des amantes d’un père adoré qualifié de « libertin ». Même si elle s’en flatte dans ses interviews, et même si elle cite Sade à toutes les sauces, je l’entends comme la tentative de sublimer un vécu « anormal », « douloureux » ou juste traumatique. Tout ça pourrait expliquer sa volonté de s’associer à un animal prédateur pour retourner le rapport de force. Une forme de renversement du stigmate ; passer de proie à prédatrice. D’un autre côté, le tigre est comme la femme, objet de fantasmes et de peurs irrationnelles, exotisée, fétichisée. Bête ambivalente à la tête du règne animal mais chassée malgré tout toujours par un même prédateur : l’homme.
“Ce récit est inspiré d’un rêve qui lui-même a inspiré une série de poèmes sur la faim et la soif.”
ED: Non sans lien avec votre personnage ! Certaines de vos phrases provoquent un goût de fer dans la bouche et on peut dire que globalement, vos mots ont du goût. De la même manière, vous communiquez les détails du moindre bruit et ses effets sur le personnage. Votre texte transmet au lecteur ces sensibilités, était-ce votre volonté en l’écrivant ?
LS : Il y a beaucoup de moi dans ce texte. Je ne crois pas être atteinte de synesthésie comme le personnage principal, enfin je n’en sais rien, je sais que j’ai des petites curiosités sensorielles. Les gens que j’aime amoureusement par exemple ont une couleur. Le bleu ou le noir, plus rarement le vert. Mais je ne sais pas si c’est vraiment de la synesthésie, ou si culturellement j’associe ces couleurs à l’amour. Le noir est une couleur absolue, surnaturelle, si parfaite et sans nuances, qu’elle parait déchirée dans un manteau de nuit et c’est comme ça que mon corps perçoit les gens que j’aime ou que je désire.
En revanche, je sais que je suis clairement misophone, les sons renvoient à des images parfois détestables à la nausée. Comme les bruits de mastication, ou le glouglou d’une bouteille en verre, qui me donnent des envies de mourir. Je vais peu au cinéma à cause de ça, les bruitages dans les films sont difficiles à supporter. Certains m’évoquent des images, des sensations corporelles etc. Quand une femme dans les transports farfouille dans son sac à main, le bruit des objets tournés retournés et que j’utilise dans le texte me renvoie l’image corsetée de la femme qui doit être parfaite en toutes circonstances et prête à tout. Être présentable et belle, en sécurité, assurer le bien-être de sa famille. En gros, transvaser toute son assignation domestique dans un objet utilitaire ou de mode.
ED : D’ailleurs, vous proposez une véritable expérience littéraire qui vient mélanger et perturber les sens. C’est d’ailleurs écrit clairement ici: «Je me mis à sentir ce que je voyais, à boire ce que j’entendais, et à manger les couleurs.» C’est ce qui vous a animée pendant l’écriture ?
LS : Ça a peut-être été accentué par le fait que ce récit est inspiré d’un rêve qui lui-même a inspiré une série de poèmes sur la faim et la soif (Lou Syrah sort de son sac son carnet de rêves avec à la fin ses poèmes écrits à la main). Le rêve est une matière qui déplace les sens et qui nécessite un travail de l’image assez rude quand on le retranscrit puisque par définition, toutes les rationalités de l’écriture y sont perturbées. Il n’y pas de récit linéaire, on ne sait pas si les sensations sont subjectives ou vécues par d’autres, et c’est volatile comme un parfum. Il faut attraper les images en vol au réveil très rapidement pour les coucher sur papier. J’ai utilisé cette idée dans le récit.
“« Fuck Eat Kill » est une fable, voire une farce, sur le mythe de la dévoration féminine.”
ED : « J’avais baisé, tué, mangé. De mon point de vue, le problème se résumait facilement. Du point de vue de la science, le régime de qualification était en revanche trop étroit pour m’accueillir sans perturber l’ordre du monde. Il fallait pouvoir nommer, ranger, rééduquer ou réduire au silence. » si cet extrait explique le titre, il montre surtout les limites de cette volonté de mettre à tout prix les patients dans des cases pour les soigner. C’était une manière pour vous de critiquer l’approche scientifique ?
LS : « Fuck Eat Kill » est une fable, voire une farce, sur le mythe de la dévoration féminine. La société masculine a fait croire pendant des siècles que la femme portait une bête indomptable entre les cuisses, une sorte de monstre, de « vagin dentelé » et que son appétit sexuel, fort à propos ici, ne relevait que de l’animalité. Cette idée a nourri les violences contre les femmes, violées, enfermées, excisées ou mises en pièce comme de la viande. La religion comme la science ont leur part de responsabilité dans la perpétuation de ce mythe. Le fait d’écrire une histoire cannibale dans le huis clos de la psychiatrie ne visait qu’à pousser à l’extrême ce motif assez classique, tout en dénonçant encore ces espaces de pathologisation du désir féminin.
ED : Ce n’est pas explicite mais on peut ressentir une certaine défiance envers les hommes, que ce soit à travers certains personnages ou simplement l’intrigue. Pourriez-vous nous en dire plus ?
LS : Je ne dis pas qu’il faut tuer les hommes bien sûr (rire). Ça, c’est un élément de langage des misogynes pour décrédibiliser la cause des femmes. Ce que j’essaie de faire comprendre à mes amis hommes, mes amours ou mes frères, c’est la nécessité de travailler sur leurs préjugés qui salissent leur langue et leur regard. Les matrices de la haine sont les mêmes partout, elles fonctionnent sur des discours et des représentations. En tant qu’antiraciste ayant travaillé sur la haine religieuse et raciale, je leur dis souvent « pensez aux pire préjugés anti-juif (l’argent) anti-musulman (la fourberie), ou anti-noir (l’animalité) et maintenant pensez aux préjugés misogynes (la femme vénale, la traitresse, la femme qui a la rage etc). Vous ne voyez pas ce qu’on subit ? » Qu’ils continuent à véhiculer ces préjugés dans leurs variantes, juste par flemme de se prendre en main ou par confort, et se vautrent encore dans une sexualité violente ou minable, ou dans des réflexes de domestication, provoquent une forme de honte mêlée à de la pitié pour eux.
ED : La pornfood consiste à prendre en photo ce que nous mangeons de manière flatteuse, diriez-vous que votre écriture en est le prolongement littéraire ? Car vous jouez avec les sens mais aussi avec les mots et le rapport à la nourriture du personnage est hautement sexuel ?
LS : C’est vrai, mais tout dépend de quelle pornfood on parle ! La certitude c’est que la nourriture comme le sexe, sollicite les cinq sens. Leur association relève donc de l’évidence, ce sont deux activités extrêmement sensorielles. Mais la mode sur internet des hommes qui « doigtent » des agrumes ou tapent des miches de pain n’a rien à voir. Eux, on ne les voit jamais mimer des fellations sur une grosse courge. Ils singent les codes hétéronormés du porno. Cette image de la nourriture salie pour un regard objectivant ne vaut pas mieux que l’homme qui parle des femmes comme de « poules pondeuses » ou de « vaches à lait », et qui chosifient toujours plus pour justifier de les traiter comme du bétail ou comme des corps seulement destinés à la procréation. Voir la femme comme de la viande même comestible, c’est autoriser sa mise en pièces. C’est ce que théorisent très bien des autrices féministes comme Carol J. Adams, Nora Bouazzouni, Lauren Malka ou Linda Nochlin.
ED : Sans trop en dire, vous évoquez les mythes cannibales de la société occidentale en évoquant le Christ. J’ai trouvé cette perception intéressante sur les rituels catholiques qui effectivement confondent aliments et corps humain.
LS : Dans le climat politique haineux qui est le nôtre, vu l’islamophobie, l’antisémitisme et les polémiques racistes sur le halal et le casher qu’elles charrient, je trouvais intéressant de renverser les accusations de barbarie pour pointer du doigt une forme de monstruosité catholique puisque l’Église fait l’apologie d’un rituel cannibale tous les dimanches à l’office. Certes c’est symbolique, mais il s’agit tout de même de dévorer la chair du Christ ! La moquerie de la religion s’arrête là. Dans mon texte, je fais référence à l’Ancien Testament, au passage « Neviim », « Les Prophètes » du Livre de Samuel qui dit « Le Seigneur a parlé, son verbe repose sur ma langue ». La symbolique de la dévoration du texte saint, qu’on appelle « la manducation », et qui permet de prendre en soi l’absolu est une idée que je trouve jolie et que je pousse en troisième niveau de lecture. Il y a aussi une référence coranique cachée. Je laisse le lecteur la trouver.
“Raconter, quelle que soit la manière, c’est se libérer de la possession de récits qui, tous, peuvent vous cannibaliser de l’intérieur.”
ED : Si on s’intéresse à la dimension érotique de votre texte, elle est plutôt subtile bien qu’omniprésente.
LS : Ce n’est effectivement pas un texte pornographique. D’autant que la langue est volontairement déplacée pour se libérer du regard masculin. On ne baise pas quelqu’un, « on baise la forêt » par exemple. Ce n’est pas par pudeur, c’est l’idée que chaque absolu peut être remplacé par un autre. Et c’est à titre personnel ce que m’évoque le rapport amoureux.
Il y a des personnes choquées par une supposée violence du texte. Je leur réponds juste que le corps de la femme est une boucherie, et lorsqu’elle n’est pas prise pour de la viande, elle s’ouvre en deux pour saigner tous les mois.
ED : Et finalement c’est l’écriture qui est curative : « Quelle que soit la chose qui vous traverse, “translittérez”». Vous auriez pu trouver un autre remède mais vous avez choisi l’écriture comme exutoire.
LS : Raconter, quelle que soit la manière, c’est se libérer de la possession de récits qui, tous, peuvent vous cannibaliser de l’intérieur. C’est ce que j’ai fait avec mon premier roman en perçant un secret d’enfance. Et naturellement, ça m’a aidée, mais je n’ai pas pensé ce texte ainsi, j’ai pensé l’usage de la langue comme d’un dérivatif autour d’absolus multiples, l’amour, la langue, et la nourriture. Pour le reste, chaque expérience d’absolu peut avoir sa retranscription verbale donc oui, translittérons.
- Fuck Eat Kill, Lou Syrah, collection « Vrilles », à retrouver sur Zone Critique, avril 2025.