
Les nations et les hommes ont besoin de mythes et de mensonges pour se construire. Ce qui ne veut pas dire que les livres soient des mensonges même si, par définition, une fiction est toujours un mensonge. C’est un mensonge qui touche à la vérité.
Paul Auster in La solitude du labyrinthe (1997).
En dépit du bon sens, certains lecteurs attendent encore du roman une révélation, pour ne pas dire une vérité (qui doit s’entendre ici comme un principe certain qui met le doute en échec), tandis que d’autres, comme Paul Auster, portant pourtant un regard très professionnel sur la littérature d’imagination, continuent à l’associer à des contre-vérités. La fiction ne serait-elle pas plutôt un espace hermétique à la vérité et au mensonge ?
S’il existe bel et bien en anglais comme en français un lien de parenté lexicale entre mensonge et littérature, deux mots qui se recoupent dans le vocable de « fiction »[i], les écrits ne peuvent être associés à des menteries dans le genre romanesque, du moins sur un plan philosophique. Le bon sens voudrait que l’on se range à l’opinion de Peter McCormick lorsqu’il déclare que « l’art du conte, à l’inverse du mensonge, se résume à faire semblant sans chercher à tromper, étant plus proche de la comédie que du faux serment ».[ii] Et ce professeur de philosophie d’ajouter : « L’écrivain de fiction […] simule la référence parce que la nature des phrases fictionnelles est telle qu’il ne peut faire référence à quoi que ce soit. L’écrivain qui s’exprime dans un récit documentaire entend bien faire référence à quelque chose ; par contraste, l’écrivain de fiction ne fait que simuler cette fonction référentielle ».[iii] Dans son explication, en faisant la distinction entre les catégories documentaire et fiction, McCormick sous-entend que la notion de vérité (qui doit s’entendre ici comme « le caractère de ce qui s’accorde avec le sentiment de la réalité », in Le nouveau petit Robert) est plus pertinente lorsqu’on traite d’un ouvrage documentaire que d’un récit de fiction.
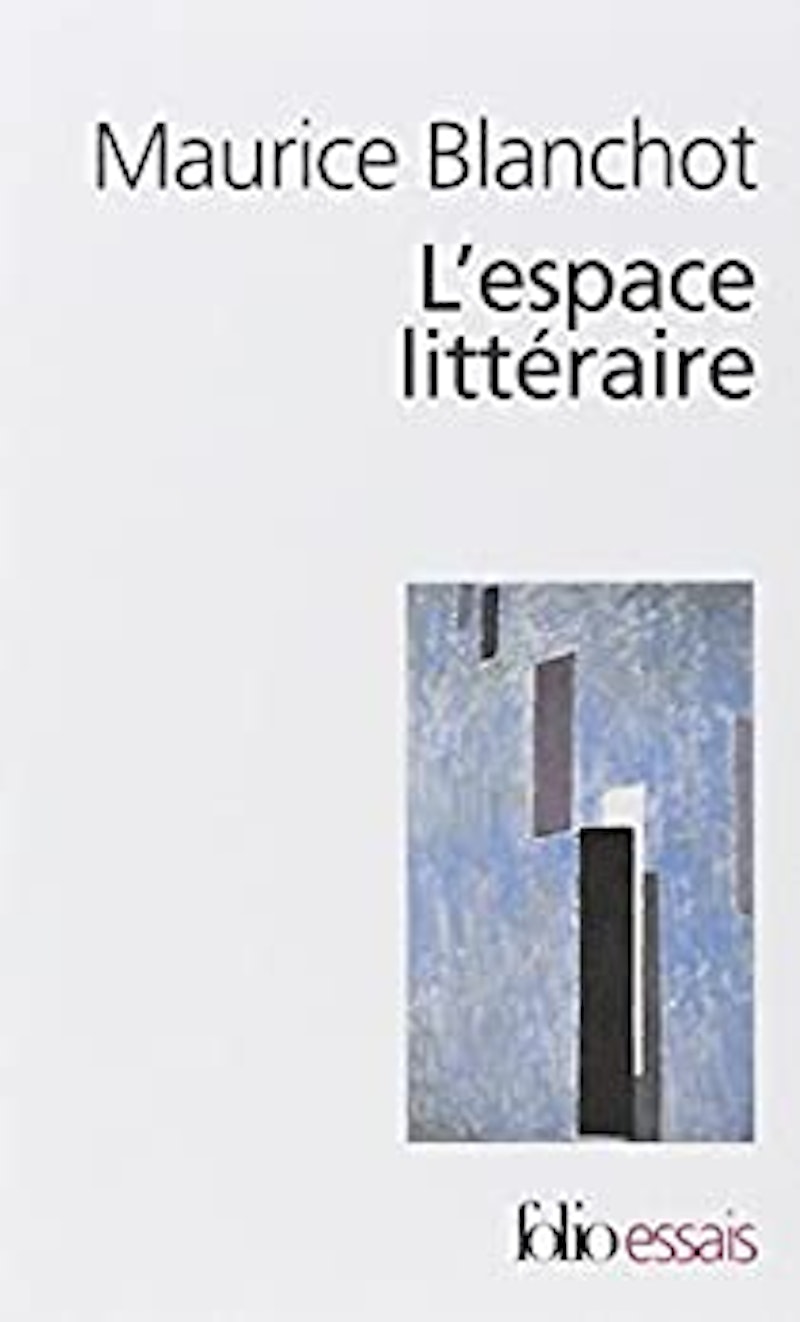
Parce qu’elle n’est pas réalité, l’œuvre littéraire peut à loisir explorer le champ des possibilités que le monde des vivants ne permet pas. L’œuvre littéraire nous propose un monde de possibles – et on rejoint ici la potentialité explorée par les oulipiens ! – mais elle ne saurait en aucun cas être un monde possible. Elle échappe au mouvement du vrai précisément parce que le romancier fait œuvre d’imagination lorsqu’il affabule ses intrigues, une activité qui le conduit à fabuler.
Principe de Vérité et principe de Confiance
Pour Blanchot, « Le roman est une œuvre de mauvaise foi », à double titre dira-t-on : « et de la part de celui qui écrit, et de la part de celui qui lit, qui se tiennent tous les deux dans l’espace ambigu de l’imaginaire ».[vi] C’est peu ou prou ce que résume Umberto Eco en évoquant les recherches de John Searle[vii] qui elles font échos aux propos de Blanchot : un discours qui perdure depuis plus d’un siècle si l’on remonte jusqu’à Coleridge et sa suspension volontaire d’incrédulité ! Au bout du compte, ce que révèle cette relation contractuelle bilatérale (que les théoriciens appellent « pacte fictionnel ») dans laquelle l’écrivain donne le change et le lecteur accepte la duperie de plein gré, c’est la distinction fondamentale entre « le monde réel » et « les mondes narratifs », le premier étant gouverné par « le principe de Vérité (Truth) » tandis que les seconds sont régis par « le principe de Confiance (Trust) ».[viii]
Dans un autre livre, Sémiotique et philosophie du langage (1988), Umberto Eco remarque que la

De l’aveu général, faire des entorses à la vérité est contraire à la déontologie d’un historien et qui étudiera le roman historique se rendra compte des rivalités et des âpres disputes qui font de la littérature et du récit historique deux exercices de style qui ont chacun leurs spécificités. Il serait donc judicieux de mener une étude d’envergure sur le roman historique et la quête de vérité, en examinant les polémiques qui ont agité historiens et romanciers. Dans un même esprit, on gagnerait à analyser un certain nombre de litiges identitaires et de supercheries littéraires afin de savoir si l’on doit tenir les auteurs responsables de leurs entorses qui entravent une prétendue « quête de vérité » ou si les lecteurs se rendent coupables d’un procès d’intention en soutenant implicitement l’existence d’une dimension « aléthique »[ix] dans l’espace de la fiction. D’autres questions en découleront : ces indélicatesses portent-elles à conséquence dans l’espace de la fiction ou n’entament-elles que l’éthique de l’écrivain ? Et la plus importante des interrogations : dans quelle mesure ces supercheries parviennent-elles à nous renseigner sur le statut de la fiction ?
A la lumière de ces réflexions, on s’aperçoit qu’il y a quelque incongruité pour le lecteur ou le romancier à vouloir se lancer dans une quête de vérité au sein d’un espace qui ne le permet pas. D’où ce fait bien commode qu’en littérature nul romancier ne puisse être coupable d’ignorance. Pour reprendre l’heureuse formulation de Christine Angot dans Une partie du cœur (2004) : « Le mot chaise n’avait plus quatre pieds, il n’en avait plus qu’un en littérature. Ceux qui lui donnaient quatre pieds c’était leur affaire, l’écrivain n’en était pas responsable. C’était bien pourquoi la responsabilité de l’écrivain n’existait pas. Et la culpabilité encore moins ».
Notice biographique : Essayiste bilingue, auteur de fiction et chercheur en littérature, Jean-François Vernay a signé plusieurs réflexions littéraires, toutes disponibles en langue anglaise. La séduction de la fiction (qui vient de paraître aux éditions Hermann) est son quatrième essai par lequel il apporte sa contribution au champ des études littéraires cognitives.
[i] Terme qui dans son acception désuète dénote un « mensonge » et qui dans le langage contemporain désigne une « création de l’imagination, en littérature », similitude que l’on retrouve en anglais avec le dénombrable « fictions » et l’indénombrable « fiction».
[ii] P.J. McCormick, « Fictions and Feelings », Fictions, Philosophies and the Problems of Poetics (Ithaca/London : Cornell UP, 1988), 138.
[iii] P.J. McCormick, Id.
[iv] M. Blanchot, L’espace littéraire (Paris : Gallimard, 1955), 318.
[v] T. Todorov, La Notion de littérature (Paris : Le Seuil, 1987), 13.
[vi] M. Blanchot, La Part du feu (Paris : Gallimard, 1949), 189 cité in D. Hurezanu, Ibid., 53.
[vii] « Le lecteur doit savoir qu’un récit est une histoire imaginaire, sans penser pour autant que l’auteur dit des mensonges. Simplement, comme l’a dit Searle, l’auteur feint de faire une affirmation vraie. Nous acceptons le pacte fictionnel et nous feignons de penser que ce qu’il nous raconte est réellement arrivé». J. Searle, « The Logical Status of Fictional Discourse » New Literary History 14 (1975), cité in U. Eco, op.cit. (1996), 81.
[viii] U. Eco, Six promenades dans les bois du roman et d’ailleurs (Paris : Grasset & Fasquelle, 1996), 95-6.
[ix] Dans l’acception que lui donne Roland Barthes dans « Qu’est-ce que la critique ? » (1963), à savoir : qui « relève de la vérité ».

















