
Deuxième parmi les recueils poétiques les plus importants de l’œuvre de la chilienne Gabriela Mistral (1889-1957), Pressoir, paru en 1954 et qui vient d’être traduit par les éditions Unes, comprend certains des poèmes de deuil les plus marquants, mais est également emprunt d’un sincère désir de vivre, d’être au cœur des choses, au cœur du monde. Gabriela Mistral, qui reçoit le prix Nobel de littérature en 1945, évoque avec douleur dans cet ensemble de poèmes les thèmes de la mort, de la solitude, de l’absence, mais aussi de la religion, de la foi, de la volonté de vivre, toujours avec retenue et délicatesse.
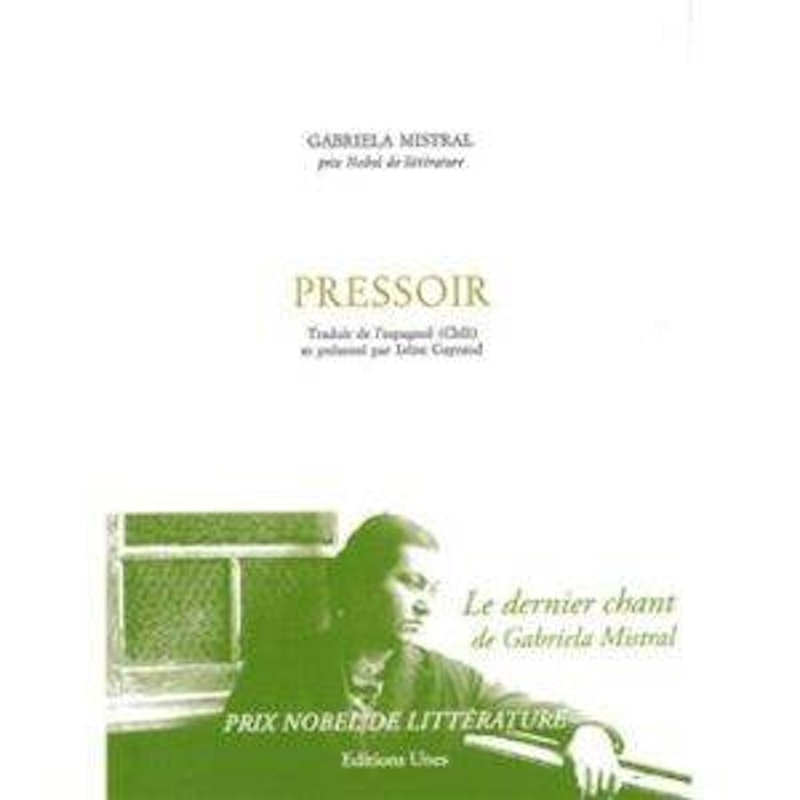
Ainsi la poétesse définissait-elle son rapport à l’écriture, affirmant par là même cette nécessité d’écrire qui parcourait son sang, sa gorge, ses mains. Nécessité de dire, de nommer, comme pour se libérer d’un lac brûlant qui l’emplissait jusqu’à risquer de l’asphyxier. Le recueil publié ici par les éditions Unes et traduit par Irène Gayraud est composé de treize sections, d’un prologue et d’un épilogue. Comme le roman d’une vie écoulée, et l’aveu d’une faiblesse pressentie. Trois ans après la publication de Pressoir, Gabriela Mistral s’éteint et laisse derrière elle non seulement une œuvre poétique singulière (Essart, Pressoir, Poema de Chile), une carrière diplomatique marquée par de très nombreux voyages, mais également l’image d’une femme ayant œuvré pour réformer la pédagogie de l’enseignement en Amérique du sud.
Du mythe au christianisme
La poésie de Mistral est fortement empreinte de sa culture latine natale, sans s’aventurer cependant dans un folklore local figé, stéréotypé. Ses textes sont traversés par les lieux importants de sa vie, de sa terre : la Pampa, la Patagonie, les Andes, mais aussi par un souffle de grâce, à la croisée du mythe et du christianisme. La douleur, le deuil et l’absence sont nommés avec sensibilité par une voix pure, claire, faisant fi d’un vocabulaire maniéré. L’essentiel est de dire, pas de déclamer. C’est cette retenue qui séduit dans l’écriture limpide de Mistral. Le recours au mythe chez la poétesse permet de donner un visage, une forme, aux pensées douloureuses qui empêchent le sommeil d’avoir lieu, la vie de se poursuivre malgré les défaillances de l’existence :
« Jusqu’à ce que la Gorgone de la nuit / s’en aille, vaincue, enfuie », dans Auror
Du deuil et de la mémoire
Le suicide de son jeune fils Miguel, décédé en 1943, âgé seulement de dix-sept, et le souvenir douloureux de cet enfant sillonnent l’ensemble du recueil. La mémoire apparaît alors comme une chaîne cadenassée à la cheville, fardeau empêchant l’oubli et la possible renaissance. Oublier, effacer ses souvenirs, ses images, jusqu’à en oublier ses paysages et son propre nom.
« J’ai oublié, déjà, qui j’étais / quand je vivais avec les autres. / J’ai brûlé toute ma mémoire / comme un foyer nécessiteux. / Je ne connais plus, si je reviens, / les toitures de mon village », dans L’heureuse.
L’horreur du deuil, c’est aussi la cruauté de demeurer, de « rester » après le départ des êtres aimés. Cet immobilisme des vivants, condamnés à attendre patiemment l’heure tendre des retrouvailles, déchire le silence paisible des poèmes de Mistral, comme une ombre qui mettrait en lumière le fond essentiel du poème.
« Le vent et l’Archange de son nom / amenèrent jusqu’à sa porte / la mort de tous ses vivants / sans amener sa propre mort. », dans La fermière.
La section intitulée Femmes folles comprend certains des plus admirables textes du recueil, comme le récit des mille vies vécues par l’autrice elle-même. Les « femmes folles » sont avant tout des êtres éprouvés par la perte de l’enfant aimé, de l’amant, de la terre natale, pensées obsédantes à en perdre le sommeil.
« Que vienne le vent, que brûle ma maison / mieux que forêt de résineux ; / que tombent rouges et obliques / le moulin et la tour mère. / Et que ma nuit, épuisée par le feu, / que ma pauvre nuit n’atteigne pas le jour ! », dans L’abandonnée.
« Comme un habit de fête pour une fête absente »
Il y a chez Gabriela Mistral une envie terrible de vivre, de connaître autrui, de voir le monde, en dépit des deuils et des nuits sans fin. Il y a cet amour jamais précisément nommé, qui est peut-être en somme l’amour pour toutes les choses de ce monde. Mais toujours ce désir violent d’existence se heurte aux limites humaines. Les Hommes, ces créatures fragiles que le moindre malheur égratigne à jamais. Les plaies ouvertes ne cicatrisent pas, elles ne font que se parer de leurs plus beaux atours et poursuivent ainsi leur chemin :
Il y a chez Gabriela Mistral une envie terrible de vivre, de connaître autrui, de voir le monde, en dépit des deuils et des nuits sans fin. Il y a cet amour jamais précisément nommé, qui est peut-être en somme l’amour pour toutes les choses de ce monde.
« Je me suis assise au milieu de la Terre, / mon amour, au milieu de la vie, / pour ouvrir mes veines et mon sein, / pour m’émonder en grenade vive, / et pour briser l’acajou rouge / de mes os qui t’aimaient. », dans L’abandonnée
Le réconfort, faute de le trouver dans les voyages, les visages, elle le cherche en elle-même, dans les arbres, dans la Terre, matrice chaleureuse. La poésie de Gabriela Mistral est un long chant pour les absents, un adieu qui refuse de s’achever, un orage intérieur changé en musique de chambre, au plus près du cœur de la poétesse.
« En chaque arbre elle redresse / celui qu’on coucha en terre / et dans le feu de son sein / le réchauffe, l’enroule, le serre », dans Une femme
- Gabriela Mistral, Essart, éditions Unes, 2021
- Gabriela Mistral, Pressoir, éditions Unes, 2023
Marion Belivacqua
Crédit photo : Gabriela Mistral (AP Photo)
















