
Après Henri Béraud, Louis Guilloux, Jean Grenier, Eugène Dabit ou encore Henri Calet, notre rubrique « Peut-on encore lire ? » revient ce mois-ci sur l’œuvre de Georges Hyvernaud (1902-1983). Proche de Raymond Guérin, auteur de deux romans, La Peau et les os (1949) et Le Wagon à vaches (1953), racontant son expérience de la captivité dans les camps de prisonniers en Poméranie durant la seconde guerre mondiale, Georges Hyvernaud est longtemps tombé dans l’oubli. Notre rédacteur, Clément Guarneri, analyse ici l’œuvre de celui qui toute sa vie s’est souvenu de ses cinq années passées dans la maison de morts.
À l’heure où j’entreprends d’écrire ces quelques lignes sur l’œuvre de Georges Hyvernaud, je ne crois pas faire preuve d’une grande originalité, ni même œuvre de justicier. Il y a bien longtemps que la vie et l’œuvre de l’écrivain ont été exhumées des oubliettes. Tout du moins, certains éditeurs ont-ils eu à cœur de rompre le relatif silence de l’après-guerre, et l’injuste accueil que lui firent certains critiques.
Pourtant, lorsqu’on scrute les noms de ceux qui louèrent le ton et la manière du jeune écrivain d’alors, on s’étonne un peu que La Peau et les os et Le Wagon à vaches n’aient pu bénéficier, à l’époque, d’un accueil plus favorable au sein du public. Raymond Guérin n’avait-il pas rédigé une préface tour à tour spirituelle, élogieuse et vérace, à La Peau et les os ? Blaise Cendrars n’avait-il pas relevé la dimension salutaire d’un tel écrit, en déclarant que le livre d’Hyvernaud l’avait aidé à « comprendre la désolation profonde dans laquelle était prostré son fils aîné depuis son retour de captivité » ?
À la réflexion, il n’y a là rien d’étonnant pour peu qu’on songe aux humeurs du temps. L’après-guerre n’avait que faire d’une littérature amère et encore moins de l’expérience d’un ancien détenu d’oflag, qui, aux yeux de la société civile, n’incarnait pas plus la classe des martyrs que celle des héros.
Ces anciens captifs n’avaient été que des prisonniers de guerre, autant dire des perdants. Leurs douleurs et leurs souffrances étaient le prix de la défaite. D’autre part, leurs tourments n’avaient rien de commun avec ceux des suppliciés de Dachau ou d’Auschwitz, tout comme leur lutte contre la faim, le froid et la fatigue, n’embrassait guère celle de la Résistance.
Seulement, voilà, ces hommes avaient tout de même été incarcérés contre leur gré, pour une période indéterminée, dans des camps où la vie n’était plus qu’une réalité contrefaite, qu’une absurdité. Or, comme il n’y avait là ni terreur grandiloquente, ni glorieux faits d’armes, à quoi bon narrer des tourments banals, des humiliations et des dégoûts ?
Georges Hyvernaud s’y risqua. Il n’était ni le premier ni le dernier. En 1945, Henri Calet avait déjà publié Le Bouquet. Quant à Raymond Guérin, il ne leur succéda qu’en 1953 avec la parution des Poulpes.
Une poétique coprophile ?

On imagine alors sans peine les réactions qu’une telle vision « désenchantée » du camp de prisonniers pouvait susciter chez un lectorat timoré, qui ne manqua pas de s’indigner à la lecture de La Peau et les os, scandalisé par un livre qui barbotait, selon lui, dans la merde et l’urine !
Qu’on ne s’y méprenne pas pour autant, Hyvernaud ne se complaisait nullement dans l’ordure, pas plus qu’il ne se faisait le chantre de l’étron. Il s’en expliqua, lui-même, presque désolé d’avoir à brasser un tel matériau :
J’aimerais autant parler d’autre chose. De choses claires. Parler des claires jeunes filles, ou d’un regard de vieille dame, ou d’un peuplier au bord de la route. Parler d’un poème, d’une écharpe, d’un tableau de Matisse. Mais tout cela n’existe plus. C’est fini. Il n’y a plus de couleurs, de feuillages ni de regards. Tout a été englouti dans une catastrophe informe. Tout est foutu. Il n’y a plus, au milieu d’un univers détruit, que cette baraque où l’on se soulage en tas. Tout est vide et mort. Et au milieu du vide et de la mort, il ne reste plus que la défécation en commun…
Assurément, l’auteur eut raison de souligner que ce n’était pas avec de tels récits qu’on pouvait animer les repas du dimanche ni fanfaronner devant les copains au bistrot du coin. C’était par trop honteux, par trop humiliant. Mais, en vérité, il n’était pas d’autre réalité à conter, car c’eût été trahir l’essentiel, s’empresser d’écrire encore une fois un petit morceau de littérature, sur lequel les générations suivantes eurent pu gloser à l’envi, en traquant ici ou là les habiles procédés rhétoriques, empêtrés jusqu’au cou dans le mensonge et la fuite.
Il ne sert à rien de rugir. Il y a longtemps qu’une telle littérature a le vent en poupe. Et il ne s’agit pas ici de s’en offusquer. Après tout, ce n’est là que le trop usité parti pris des choses. Et puis l’âpreté nous sied mal… Tout nu, on se sent vite à l’étroit…
Pour autant, faisons à notre tour un petit effort d’imagination, pour entrevoir ce pauvre Hyvernaud avec ses autres camarades d’infortune, accroupis chaque jour collectivement sur le trou béant des chiottes, en rang d’oignons, le pantalon et la culotte descendus sur les chevilles, poussant tous leur malheureuse affaire dans un concert de pets… Ainsi, on aura vite fait de comprendre l’art et la manière de dépouiller un homme. Surtout, si l’opération se répète indéfiniment.
Une douleur sans but
Cette expérience dénuée de tout héroïsme est aussi pernicieuse que sournoise. Rajoutez ce temps sans consistance, qui s’étire et vous ronge, et il n’y a plus qu’un pas pour présager la désagrégation complète du moi, dans un univers où toute solitude est abolie et proscrite, où votre identité se dissout, réduite à un numéro, qui ne doit d’être celui-ci plutôt qu’un autre, qu’en vertu d’une administration aveugle et froide.
Face à une telle mécanique, force est de constater qu’il est bien peu de philosophies qui tiennent… Hormis pour quelques oiseaux rares, les vieilles consolations des théodicées n’ont plus cours.
Quant à la douleur, elle n’est pas pour Hyvernaud un motif d’exaltation, ni même un sentier d’expiation au bout duquel s’opérerait une transfiguration. La dépossession est totale. Le ressort est cassé. Si bien que toutes les grandes fables religieuses ou profanes viennent achopper sur l’insanité et l’absurdité d’un quotidien ruiné de toute espérance :
Leur bonheur n’est plus pour moi qu’une histoire lue dans un livre. Une fois qu’on est passé du mauvais côté des choses, tout le reste devient inconsistant. On peut en parler sans amertume, sans envie. C’est hors de l’expérience. Nous n’ignorons pas, nous autres, que le jour qui commence n’ouvre aucun avenir, qu’on ne peut rien attendre, qu’il sera pareil aux autres. Cela change tout. Nous sommes dans l’univers du sans espoir. Pas de contact, d’échange possible avec l’univers de l’espoir. Dans l’univers de l’espoir, le bonheur, la beauté, s’appliquent à vous, collent à vous de tout leur poids. Mais quand on est de l’autre côté, on ne voit plus rien comme avant. C’est difficile à expliquer. Il s’est produit un recul, un décollement, un décalage, une désolante décoloration de tout. Je regarde ce pays de bois noirs, de grande plaine et de grand vent, ce ciel de cendre et de plâtre. Ça ne me touche plus. C’est de l’autre côté. Du côté de l’espoir. Ça ne me concerne pas. C’est sans doute ainsi que le monde s’altère et se vide sous le regard des vieux. Ce doit être ainsi qu’on pénètre dans l’indifférence de la mort.
Cet état dont nous fait part Hyvernaud, à travers la description de cet « autre côté », dans lequel lui et les autres prisonniers se sont retrouvés malgré eux précipités, n’est pas sans faire écho à l’expérience vécue par Bardamu dans Voyage au bout de la nuit et à « Cette espèce d’agonie différée, lucide, bien portante, pendant laquelle il est impossible de comprendre autre chose que des vérités absolues », tels que la faim, la servitude et la peur.
Vérités absolues qui n’ont certes rien de commun avec les vérités des philosophes, puisqu’elles s’enracinent dans le sol et la matière, la chair et le sang, et non plus dans quelque idéal éthéré ou songe creux, d’où l’homme est absent.
De là, l’image d’un homme dégradé et avili, en proie à une scandaleuse métamorphose. Après le corps déchu, vient le tour de l’esprit. Car, dans l’oflag, comme en prison, la privation des soins rudimentaires et la piètre satisfaction des besoins, entraîne nécessairement l’absence de repères et l’altération de la pensée. Parfois, tout ceci confine à la folie…
Le témoin contre les faussaires
Si le narrateur de La Peau et les os insiste donc sur l’humiliation dont sont victimes les prisonniers, ce n’est pas tant pour rabaisser l’homme, comme certains critiques avaient pu le souligner – notamment André Rousseaux dans Le Figaro littéraire –, que pour le délivrer des subterfuges du langage et du moralisme, qui ne peuvent que falsifier la réalité de son expérience et de son incarcération.
Le propos va d’ailleurs plus loin et s’élargit à une critique de l’intellectualisme et de la méthode historique, qui ne voient dans les événements que des abstractions, des idées, des chaînes de causes à effets, au lieu d’adopter le point de vue de l’homme, pour qui, au milieu de tant d’horreurs, la logique et la rationalité finissent par faire l’impasse sur les sentiments et les détails les plus triviaux, mais en définitive les plus constitutifs et les plus essentiels du quotidien :
Qu’est-ce que ça pouvait être, pour eux, les Croisades ? Qu’est-ce que c’était, la Révolution ? Pour eux, pas pour les historiens. Car il n’y a que cela que je trouve intéressant : le retentissement de l’Histoire en l’homme. Mais justement les historiens ne s’y intéressent pas. L’Histoire des historiens est comme un magasin d’habillement. Tout y est classé, ordonné, étiqueté. Les données politiques, militaires, économiques, juridiques ; les causes, les conséquences, les conséquences des conséquences ; les liaisons, les rapports, les ressorts. Tout cela bien étalé devant l’esprit, clair, nécessaire, parfaitement intelligible. Ce qui n’est pas clair du tout, ce qui est obscur et difficile, c’est l’homme dans l’Histoire ; ou l’Histoire dans l’homme, si on préfère ; la prise de possession de l’homme par l’Histoire. L’homme complique tout, dès que l’acteur, celui qui y était, s’en mêle, on ne s’y reconnaît plus, on ne peut plus s’en sortir. Il dérange les belles perspectives historiques avec sa façon à lui de mettre les détails en place, et jamais à la bonne place. Pour lui, c’est toujours ce qui n’a pas d’importance qui compte le plus. Des questions de soupe, de corvées, de vaguemestre et de feuillées. Il faut voir alors ce que deviennent les événements dans la tête de l’homme qui y était. Et pas dans sa tête seulement, mais dans ses jambes, dans ses reins, dans ses boyaux, dans tout son corps qui saigne, qui sue, qui sent le vin, l’ail et pire que ça. L’Histoire des historiens n’a pas d’odeur.
Un héraut de l’absurde
Partial, Hyvernaud le fut sûrement, au même titre que n’importe quel homme. Son témoignage
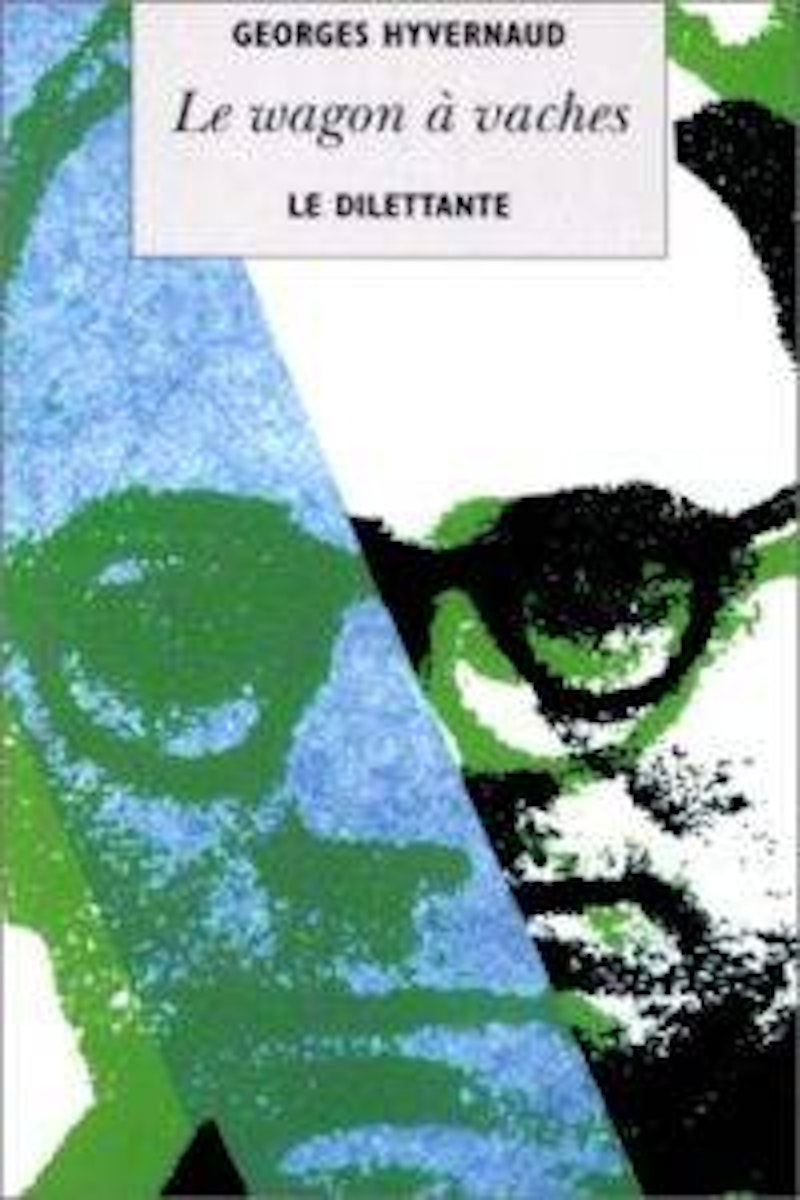
Faire l’économie d’une telle vérité élémentaire, ce n’est rien moins que réduire encore une fois ces hommes au silence, et s’arroger le droit de travestir, au nom de la morale et de la décence, la mémoire des prisonniers acculés à un régime de morgue.
Hyvernaud n’était pas dupe de la méthode. La Peau et les os, tout comme Le Wagon à vaches, se dressaient contre la candeur naïve d’une littérature engagée, gangrénée par des postulats idéologiques, et l’esthétique légère et impertinente des « hussards », afin de réenraciner l’expérience humaine dans sa dimension concrète, malgré son état labyrinthique et vertigineux, à l’ère de la multiplication sans fin des écrans, qui nous arrachent à l’immédiateté de la sensation et du sens, pour ne plus nous livrer que des rapports médiatisés et, en somme, dévoyés. L’homme fragmenté et éclaté n’a plus prise sur le monde :
C’est cela le propre de notre époque : d’avoir profondément désorganisé le réel, de nous avoir fait perdre confiance dans les choses et les êtres, dans la constance, la cohésion, la densité des choses et des êtres. Les machines s’en sont mêlées. La T. S. F., le cinéma, le téléphone, le phono : toutes les machines inventées pour nous soustraire aux contacts directs, aux corps-à-corps avec les hommes et la nature. Toutes d’accord pour opérer une incroyable altération de notre vision de la vie. Autrefois, un homme, quand il était là, c’était qu’il était là : complet, entier, rassemblé. Et de même un événement. Mais aujourd’hui on ne sait plus ce qui est absence, ce qui est présence. On avance en somnambule parmi des apparences, des reflets et des fantômes. L’aventure individuelle et l’aventure collective sont soumises à des transpositions, à des dissociations et à des éparpillements infinis.
Ce théâtre de l’absurde, dans lequel évoluent les personnages de Hyvernaud, se prolonge jusque dans le civil. Constat d’autant plus amer qu’une fois sortis du camp, les prisonniers espéraient renouer avec la vie pleine et entière. Au lieu de cela, ils embrassèrent à nouveau, quoique sous de moindres degrés, les écueils de l’ingénierie sociale.
Certes, les captifs retrouvaient la liberté de mouvement et réchappaient du massacre. Or, ce n’était pas une moindre joie. Mais qu’en était-il à présent du sens de la vie ? Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, comme avant l’éclatement du conflit, le quotidien de l’homme « libre » s’apparentait de plus en plus à une désertion, au nom des directives et des impératifs dictés par l’économie.
Tout ceci n’a rien perdu de son actualité. Au contraire, plus le temps passe et plus les intuitions de l’écrivain se confirment. Soulèvements, rejets et loisirs n’ont pu triompher du chancre et engager une réforme en profondeur du vivant. L’homme semble voué à se diluer dans l’insignifiance d’un quotidien qui se joue et se rit de lui, en l’évidant et en le dévastant, par l’entremise d’instruments et d’objets toujours plus perfectionnés, toujours plus avilissants.
Là où Hyvernaud est au fond le plus convaincant, le plus radical et le plus efficace, c’est dans l’écriture même. Car, par-delà l’attention rigoureuse portée aux souvenirs et aux motifs, il fait aussi preuve d’une grande finesse dans le choix des mots et des registres.
Sa plume éreinte les prêt-à-penser de la langue, tourne en dérision ses modes passagères et frivoles, et s’épargne enfin les pensées simulacres. Il restitue du même coup à la parole sa pleine mesure, son sens et sa signification, loin des formules et des slogans qui la souillent et la prostituent, quotidiennement.
Dans Le Wagon à vaches, la satire est d’autant plus féroce qu’il n’a de cesse que de traquer les faux-semblants du langage et de les retourner contre eux-mêmes. C’est alors au rire libérateur de prendre la place et d’œuvrer, à l’image d’un véritable antidote.
Bibliographie indicative
Hyvernaud, Georges, La Peau et les os [1949], Le Dilettante, Paris, 1993.
Hyvernaud, Georges, Le Wagon à vaches [1953], Le Dilettante, Paris, 1997.
Hyvernaud, Georges, Les Carnets d’Oflag [1987], Le Dilettante, Paris, 1999.

















