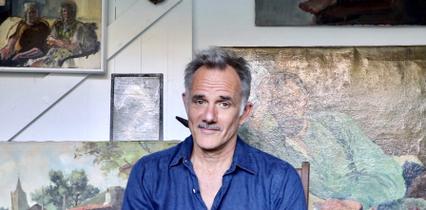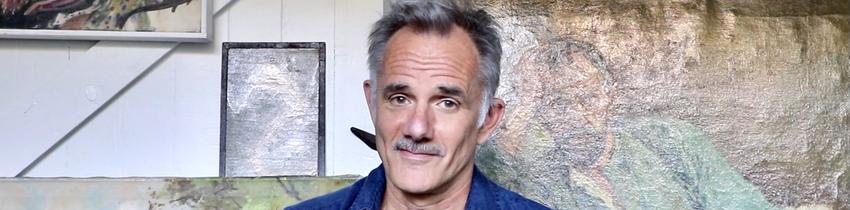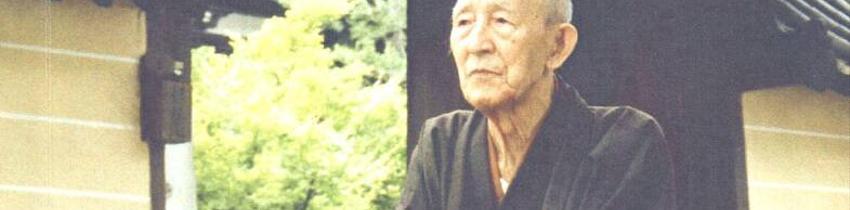Alors que j’avais commencé Jacky, je suis tombée sur un post qui le chroniquait. La critique en question charriait les préjugés habituels sur l’autofiction : Jacky serait comme tous les autres avant lui un moyen de régler par l’écriture les problèmes de son auteur avec papa maman. Suivait l’opposition classique avec les œuvres fictionnelles, demandant plus de travail, d’abnégation et de créativité que ces « récits intimes », post qui se clôturait sur le traditionnel laïus contre le nombrilisme des écrivains.

Il n’est pas rare de lire ce genre d’avis, c’est même une expérience plutôt fréquente quand on navigue dans la critique amateur (ou professionnelle). Il faut toutefois reconnaître – et le livre de Passeron en est un exemple – que nombre d’autofictions se contentent de réactualiser les clichés du genre : l’auteur qui se raconte doit montrer son inadéquation à son milieu d’origine, il souhaite creuser son passé pour mieux se comprendre ou par nécessité familiale et ainsi explorer les greniers, pourquoi pas se ressourcer au pays de ses ancêtres (Emmanuel Ruben) (dans Jacky, on ne nous épargne pas lors de ces séances de spéléologie les « photos […] qui dorment au fond d’une boîte à chaussures »), surtout, il faut, à un moment donné dans sa carrière littéraire, que l’écrivain dédie un livre au Père. À son papa. Son papounet. Ou plus précisément à la figure du père accablé.
Sous-catégorie de la niche Père dans l’autofiction, « le père accablé » l’est souvent à cause du travail (Edouard Louis), bien qu’il puisse aussi l’être en raison du racisme ou de la colonisation (Rachid Benzine). Son sourire est distant, le regard toujours crispé. Digne, parfois dur, le père peine à incarner une figure suffisamment rassurante pour le futur écrivain, et le livre consiste souvent pour le fils ou la fille à lancer « un cri d’amour » (expression qu’on retrouve sur la quatrième de Jacky) pour retrouver ce qui a été perdu.
L’originalité, ici, est que Passeron essaie de mêler à la généalogie familiale celle des consoles de jeux vidéo. Les premières pages semblent programmatiques : les consoles vont servir de balises temporelles au roman. L’idée est séduisante : le livre aurait pu confronter l’affinement des graphismes, la découverte de game-play de plus en plus élaborés, plus globalement le perfectionnement de ces petites machines au délitement des liens familiaux. Il nous semble assez clairement que c’était l’intention de l’auteur, mais cette intuition n’a pas assez de matière dans le livre pour être confirmée. Pourtant, la scène d’ouverture était prometteuse. « Mon père s’était libéré quelques instants de la boucherie de ses parents pour ouvrir les cadeaux avec sa femme et ses deux fils. Après avoir traversé le village en courant, il a refermé la porte derrière lui, suivi de quelques flocons qui sont venus s’éteindre sur le tapis ». On prend à rebours l’iconographie des fêtes de fin d’année, la famille réunie, la neige : ici, au pas de la porte, et donc, du foyer familial, les flocons s’éteignent, le père traîne sur lui « une odeur de viande », la magie ne prend pas. Le moment n’est pas autorisé à advenir. Cette économie dramatique est bienvenue, économie que Passeron va allègrement piétiner par la suite (on assiste ainsi à pas moins de trois décès – le texte aurait gagné à ne pas tous les compiler, quitte, pourquoi pas, à les traiter dans d’autres romans). Le déballage de la console a tout du cérémonial religieux : la machine fascine autant qu’elle inquiète, (la mère met en garde ses enfants contre les « crises d’épilepsie »). Son fonctionnement paraît à la famille obscur, mystérieux, impénétrable. On regrette que la scène inaugurale imprime des motifs que l’auteur ressassera à l’envi : patriarche absent (même si présent physiquement), mère pythie, enfants émerveillés par le jeu.
Le procédé est un peu grossier, comme si les parties consacrées aux jeux vidéo provenaient de Wikipédia, l’eff...