
A comme Babel. Traduction, poétique est un essai portant sur la traduction de poèmes en français, publié par Guillaume Métayer aux éditions la rumeur libre en 2020. Cet essai est organisé à la manière d’un abécédaire désordonné et gourmand. Désordonné, car Babel inaugure avant tout un formidable bazar qui oblige le traducteur à remettre son ouvrage cent fois sur le métier ! Ce livre présente des désaccords de traduction, on en revient aux textes originels, on commente, on rectifie, on essaie. Gourmand car, loin des exercices scolaires et méthodiques de traduction, ce livre est un véritable bonheur pour les amateurs : ici, l’on passe de chapitre en chapitre comme une abeille butine de fleur en fleur. Tout fonctionne par associations de sons, d’idées, de couleurs, de mots et de langues.
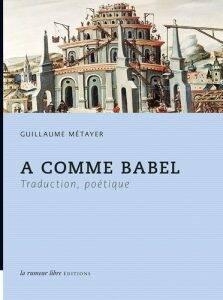
Traduction, neutralisation, pasteurisation
Commentant la disparition d’un adjectif dans la traduction d’un vers proposée par Guillevic : « Et la chanson était étrange, pourpre, grave. » (par rapport à l’original : « Enfumées, fantasques, éplorées, pourpres »), Métayer souligne le penchant hygiéniste, voire eugéniste du traducteur, qui « a escamoté [des quatre adjectifs] le plus bouseux de la bande ». Depuis, remarque Guillaume Métayer, « il manque, en français, à ces chansons embrasées leur fumet, leur parfum rustique, leur origine paysanne qu’Ady se plaît tant à accentuer dans ses poèmes sur Paris. La suite confirme que cette naturalisation tend à la pasteurisation : »
« L’automne m’a rejoint. Il a dit quelque chose
Et le boulevard Saint-Michel a frissonné.
Tout le long du chemin des feuilles guillerettes
S’amusaient à danser. »
Littéralement, c’est-à-dire, en collant le plus possible au texte hongrois, on obtient :
« L’automne m’a rejoint et soufflé quelque chose,
Le boulevard Saint-Michel en a tremblé,
Zum, zum, tout au long du boulevard voletaient
Des feuilles facétieuses. »
C’est la question de la traduction de l’onomatopée « zum zum » qui occupe Métayer durant la seconde partie de ce chapitre. Avec tout le sérieux expérimental et la malice passionnée qui caractérisent son essai, le traducteur entreprend minutieusement de relever les traductions de cette même strophe en diverses langues européennes. Métayer constate alors « qu’en anglais […] on ne dit pas « zoum zoum » […] Timidité des peuples du Nord ? […] Ou bien est-ce que personne, en aucune langue, n’aurait osé transplanter l’onomatopée ? Et les Italiens, hein ? Eh bien, eux aussi recouvrent ce « zoum zoum » qu’ils ne sauraient voir […]. » « La liberté scandinave nous sauvera-t-elle ? interroge alors Métayer. En norvégien non plus, hélas, on ne dit pas « zoum zoum » […] Qui nous émancipera de cette pruderie généralisée ? Les Tchèques, peut-être ? Oui. Les voisins centre-européens ne sucrent pas les « zoum zoum », eux. Ils en ajoutent même ! s’enthousiasme Guillaume Métayer en commentant la traduction tchèque de l’onomatopée hongroise : « Chez eux apparemment, quand les feuilles volètent dans le vent, cela fait carrément « Bzum bzum bzum ». « Les comparses slovaques leur emboîtent le pas, normal. Je tiens un caractère distinctif de la poésie d’Europe de l’Est, jamais effarouchée, elle, par un tout petit zoum-zoum de rien du tout. »
Par ce relevé, le traducteur entend établir la ligne de démarcation entre la « liberté sonore » des peuples de l’Europe de l’est, et la « pudibonderie sonore » des peuples d’Europe occidentale – projet abandonné par la découverte de l’onomatopée portugaise, mettant fin à cette séparation schématique. Il reconnaît alors une « évidence décevante », selon laquelle c’est donc moins « le génie des langues, la culture qu’elles portent, ses interdits, ses préjugés invétérés, les frontières mentales et autres architectures fantastiques, que le choix individuel de chaque traducteur qui compte ».
Traductions auditives, traductions gustatives
Nous sommes ici dans un essai, au sens fort : le traducteur ne nous place pas devant la traduction comme un fait accompli, mais nous donne d’assister à son élaboration.
Le chapitre « Catastrophe en cuisine » nous fait entrer non pas dans les coulisses de la traduction, mais bien dans les cuisines ! Ici l’on goûte, l’on essaie, l’on retire et surtout, l’on savoure. Guillaume Métayer traite ici de la question des sonorités dans la traduction. Il commence par exposer la version du poème traduite en juxtalinéaire. Ce poème est, en hongrois, « saturé de rimes », rimes dont le traducteur-poète entend rendre compte (« j’ai développé ces dernières années toute une théorie sur la nécessaire traduction en rimes des poèmes en rimes »). Avec l’agilité, la simplicité et la malice qui lui sont propres, Guillaume Métayer accomplit son premier tour de force : il transforme le juxtalinéaire « La corde de l’automne bourdonne, / Gémit, maugrée » en « La corde de l’automne, / Gémit, maugrée, bourdonne » et commente : « L’original commence aussi par des rimes plates. Et j’ai pour principe de ne pas bouder les ressemblances providentielles, ces rimes qui se donnent d’elles-mêmes comme des harmonies secrètes entre les langues. » Il ajoute : « J’ai toujours pensé qu’il y avait un dieu secret de la traduction. Si dur soit-il, il sème parfois des fruits faciles entre les deux rives, comme pour nous encourager. Ses grâces sont des présents sacrés. »
Nous sommes ici dans un essai, au sens fort : le traducteur ne nous place pas devant la traduction comme un fait accompli, mais nous donne d’assister à son élaboration. Tout le savoir-faire, tout l’art du traducteur sont ici mobilisés : les rimes et les rythmes ne doivent trahir ni la sonorité ni le sens du poème d’origine. Le travail est délicat. La fin du chapitre nous présente une première version aboutie de traduction, avant de nous proposer la traduction de Paul Verlaine, dont le célèbre « Les sanglots longs / Des violons / De l’automne » n’est en fait rien d’autre qu’une traduction (plus éloignée) de ce même poème hongrois d’Arpad Toth !
« Midas Marmiton »
Ce chapitre consacré aux poèmes de Nietzsche et du hongrois Petöfi met le doigt sur un important problème de traduction. Alors qu’il cherchait à montrer à son public la ressemblance entre les poèmes de Nietzsche et de Petöfi, Métayer exposait ses traductions et leur demandait de trouver qui avait écrit l’un ou l’autre poème. Les erreurs fréquentes du public, si elles confirmaient la parenté entre l’œuvre poétique de Nietzsche et de son homologue hongrois, interrogèrent Métayer sur la possible interférence de son travail de traducteur. Autrement dit, en traduisant ces deux poètes, Métayer n’avait-il pas laissé sa marque propre, plaçant la ressemblance non plus tant entre les deux poètes eux-mêmes mais bien plutôt à l’échelle de la traduction ?
« Alors, Nietzsche ou Petöfi ? Ou pire encore, Métayer ? » interroge le traducteur. « Je m’interroge sur ma méthode de traduire actuelle. N’aurait-elle pas tout transformé en un même magma poétique aux rimes semblables et aux rythmes semblablement irréguliers… ? Ai-je été assez attentif à la qualité différentielle ? » Avec lucidité, ce dernier pointe la possible distorsion que fait subir le traducteur aux œuvres qu’il traduit. Il écrit encore : « On a coutume d’observer avec attention la qualité différentielle de la traduction et de l’original mais un autre axe essentiel, indissociable du premier, consiste dans la qualité différentielle entre toutes les traductions d’œuvres et d’auteurs différents réalisés par un même traducteur… ».
De la traduction…
Au milieu d’ustensiles de cuisine et de Rubik’s cube, Guillaume Métayer nous plonge dans la caisse à outils du traducteur en phénoménologue et magicien.
Les derniers chapitres de cet essai prennent une tournure plus personnelle, voire biographique. C’est au détour d’anecdotes et de confidences que Guillaume Métayer rend compte des difficultés auxquelles il s’est trouvé confronté en tant que traducteur, de ses préférences, de ses choix. Aussi lit-on de jubilante « déclarations d’amour » aux rimes, de formidables plaidoyers en faveur d’une traduction formelle des poèmes. Traduire, pour Guillaume Métayer, c’est rendre compte de la forme du texte, sans être réduit au rang de simple copiste, voire de copieur : « Un vrai traducteur se doit de révéler ce qui est caché au lieu de copier ce qui est visible ». Au milieu d’ustensiles de cuisine et de Rubik’s cube, Guillaume Métayer nous plonge dans la caisse à outils du traducteur en phénoménologue et magicien.
« La traduction est navigation infatigable […] dont il faut apprendre à aimer le geste », écrit encore Guillaume Métayer. Inlassablement, et ce jusqu’au dernier chapitre dans lequel, pourtant, il parlait d’arrêter la traduction pour de bon, le traducteur se remet à l’ouvrage. Un métier loin des solitudes de l’écrivain, dans lequel on se trouve happé par les mots comme par cette communauté de traducteurs et d’échanges qui se forme autour des textes et donnent à la profession son infinie profondeur. « Traduire, c’est l’écriture à deux » résume Métayer avec cette belle formule. Loin d’être un « écrivain de second ordre », le traducteur est soumis à de redoutables exigences : parler plusieurs langues, dialoguer avec ses pairs… « Mon expérience, à moi, c’est justement qu’il peut être bien plus difficile de traduire que d’écrire ». Soutenant la légitimité du traducteur face au prestige souvent accaparé par l’écrivain, Métayer affirme avec une emphase parodique que ce « roturier de traducteur » peut être plus inspiré que « monseigneur l’auteur ». Au point que le « Cimetière marin » est « meilleur en espagnol », selon les dires de Borges cité par Guillaume Métayer : « […] le vers original d’Ibarra : « la pérdida en rumor de la ribera » est inaccessible, et […] son imitation par Valéry : « le changement des rives en rumeur » n’en rend qu’imparfaitement l’effet ».
…et de son sérieux !
Alors, faut-il ou non lire ce livre sérieusement ? Assurément, nous avons ici affaire à un livre « sérieux », au sens où cet essai propose une véritable réflexion, argumentée, illustrée et expérimentée sur l’activité de traducteur. Et Marc de Launay de commenter ainsi : « Les facéties dont l’auteur émaille ses interventions ne font qu’ajouter l’humour aux qualités de traducteur, et le lecteur ne prendra jamais pour désinvolture ce qui, à l’évidence, n’est ici que la manière dont le grand savoir s’expose avec élégance ».
- A comme Babel. Traduction, poétique, Guillaume Métayer, août 2020, éditions la rumeur libre.

















