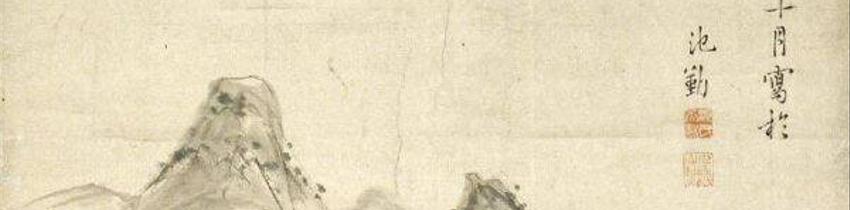Dans Une désarmée des morts, Jean-Michel Devésa examine la violence des relations humaines à travers le prisme d’un couple en crise, Maurice et Véronique, sur fond de conflits sociaux et de structures patriarcales. Par une écriture à la fois lyrique et volontairement fragmentée, l’auteur interroge les mécanismes de la mémoire, les rapports de pouvoir et les traumatismes hérités. L’entretien qui suit permet de revenir sur les origines personnelles du récit ainsi que sur les choix esthétiques et éthiques qui fondent sa pratique littéraire. Ce roman s’inscrit ainsi dans une réflexion où l’intime se fait politique et où l’acte d’écrire devient un mode de résistance au silence.
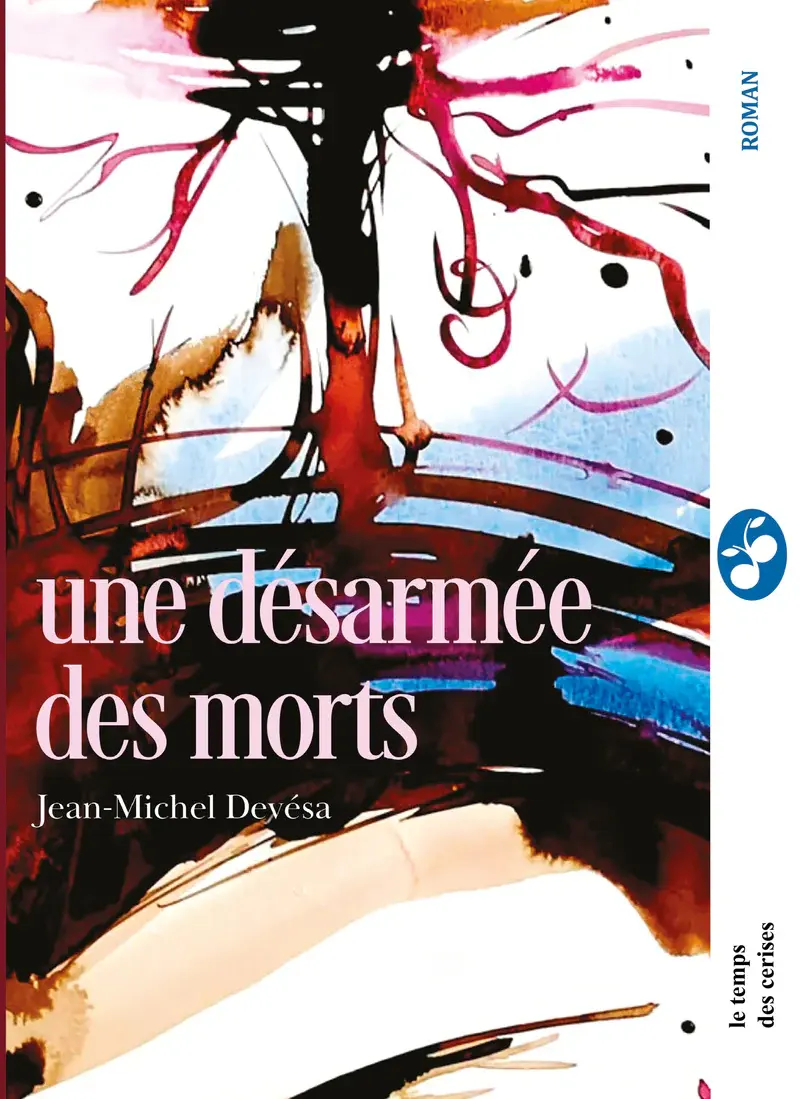
Velimir Mladenovic : La culpabilité, la honte et les non-dits irriguent tout le récit. Est-ce que cette désarmée des morts, évoquée dans le titre, désigne une tentative de réconciliation avec le passé ?
Jean-Michel Devésa : Pour vous répondre, je distinguerai la diégèse et ce que les personnages y vivent et y ressentent, des intentions qui ont été les miennes quand j’ai élaboré ce roman. Je suis parti d’une énigme dont je dois m’accommoder et sur laquelle je reviendrai. Pour l’heure, retenons que j’ai éprouvé l’impérieux désir d’imaginer une fiction, celle de Véronique et de Maurice, les protagonistes de mon ouvrage, m’autorisant à explorer à travers eux l’horreur qui est survenue pour une personne qui m’était chère mais avec laquelle toute ma vie et jusqu’à son décès j’ai entretenu une relation ambivalente. De cette feuille de route, la narration s’est nourrie mais elle s’est aussi émancipée, sa dynamique profilant les personnages non pas comme des entités « données », disposant d’une identité et d’une assiette psychologique préalablement définies, mais inscrites dans un devenir impliquant maints réagencements de leurs profils, de leurs comportements, au fil du procès d’écriture. C’est ainsi que, chez moi, le roman s’acquitte d’une fonction de connaissance et d’analyse du monde et des rapports dans lesquels sont pris les individus. Je n’essaie pas de me réconcilier avec le passé, je tente de l’investiguer, tout comme le présent, par le truchement d’une expérience de pensée indissociable de l’acte d’écrire.
Le crime que commet Maurice, l’agression qu’il commet contre Véronique puis sa très longue humiliation ne relèvent pas du fait divers mais du fait de société : mon roman ne s’empare pas du « dérapage » d’un garçon sanguin, pétri de préjugés envers les femmes ; sa folie et sa jalousie participent de la guerre des sexes et de l’articulation de celle-ci à la lutte des classes. Maurice est un « bridé sentimental », un frustré, croyant être supérieur à toutes et à tous parce qu’il est un mâle et qu’il a de l’argent. À son machisme s’ajoute le mépris de classe, sa phallocratie ne va pas sans la morgue des nantis. Il entend donc posséder Véronique, attendant d’elle qu’il jouisse de sa jeunesse et de sa chair, de sa sensualité ; et que cette épouse choisie aussi pour sa précarité sociale (il a tiré Véronique du ruisseau et de la prostitution ; en acceptant d’épouser ce viticulteur bourru et passablement grossier, Véronique accède à la respectabilité : entre eux, il y a un contrat, ils sont chacun en affaire avec l’autre), et donc, selon lui, généreusement épousée, lui procure une descendance et, de préférence, un fils de manière à ce que le domaine de Barrouille demeure dans la lignée des Garranch-Laterrade.
Véronique et Maurice ont conscience de fonder leur relation sur un marché. Tous les deux estiment avoir berné l’autre ou être en capacité de le faire. Maurice se rengorge en imaginant que Véronique est en dette vis-à-vis de lui puisqu’il l’a sortie de la panade ; il s’octroie le beau rôle, en se délectant d’avoir eu du flair et de n’être pas en reste, malgré son infirmité, pour faire vibrer et trembler un corps : son épouse est belle, charmante et, dans l’intimité, elle sait s’y prendre. Véronique est quant à elle persuadée d’avoir l’avantage sur Maurice en raison d’une concupiscence qu’il ne contient pas. Malheureusement, elle se trompe : elle a mal apprécié la noirceur de son mari, celle d’un macho et d’un propriétaire terrien récusant toute limite à son pouvoir et à sa domination. Cette opprimée est défaite, elle est une désarmée des mots. L’affrontement de ces deux-là est si âpre qu’il les conduit en permanence à déguiser leurs mobiles, à tricher, à dissimuler leurs émotions. Ce n’est que devant la mort que Maurice vacille, taraudé moins par le remords que par sa démesure. La peur qui s’empare de lui lors des obsèques de Véronique n’est que l’expression renversée de sa férocité.
V. M. : Votre œuvre semblant bâtie sur une tension entre fiction et mémoire personnelle, quelle part de vous, ou de vos souvenirs, retrouve-t-on dans ce roman ?
J.-M. D. : Les circonstances de l’existence font que je dois m’arranger d’un doute terrible qui m’a assailli lorsqu’un soir, au téléphone, on m’a prévenu qu’une personne très chère, mais avec laquelle j’étais brouillé, et avec qui ma relation a toujours été problématique, peut-être même dès ma naissance, vis-à-vis de laquelle j’ai nourri pendant des décennies des sentiments ambivalents, était hospitalisée, dans le coma. Elle avait fait une chute dans sa salle de bain, sa tête avait heurté le rebord de la baignoire avec une extrême violence et immédiatement, je me suis demandé si la nature accidentelle de cette glissade était ou non avérée. L’équipe médicale a sauvé la victime, toutefois celle-ci a perdu l’usage de la parole et a été condamnée à subsister une dizaine d’années en étant totalement dépendante des autres puisque tétraplégique… Il lui a fallu une décennie pour s’éteindre.
Quand j’ai entamé Une dé...