
Dans la nuit du 23 au 24 février 2021, à peine âgé de quarante-deux ans, Joseph Ponthus décède des suites d’un cancer, laissant derrière lui un unique roman, largement remarqué à sa publication en 2019 : A la ligne. Feuillets d’usine , œuvre furieuse dont on n’a pas encore mesuré toute la puissance. L’auteur, ouvrier intérimaire bercé des chansons de Charles Trenet, retrace dans un récit halluciné la monotonie du travail à la chaîne, la répétition des gestes, les rencontres éphémères, les pauses, les plaisanteries avec les collègues, les rêveries entre deux clopes, les bruits, les odeurs, la langueur des dimanches soirs et l’éternel retour du lundi matin.
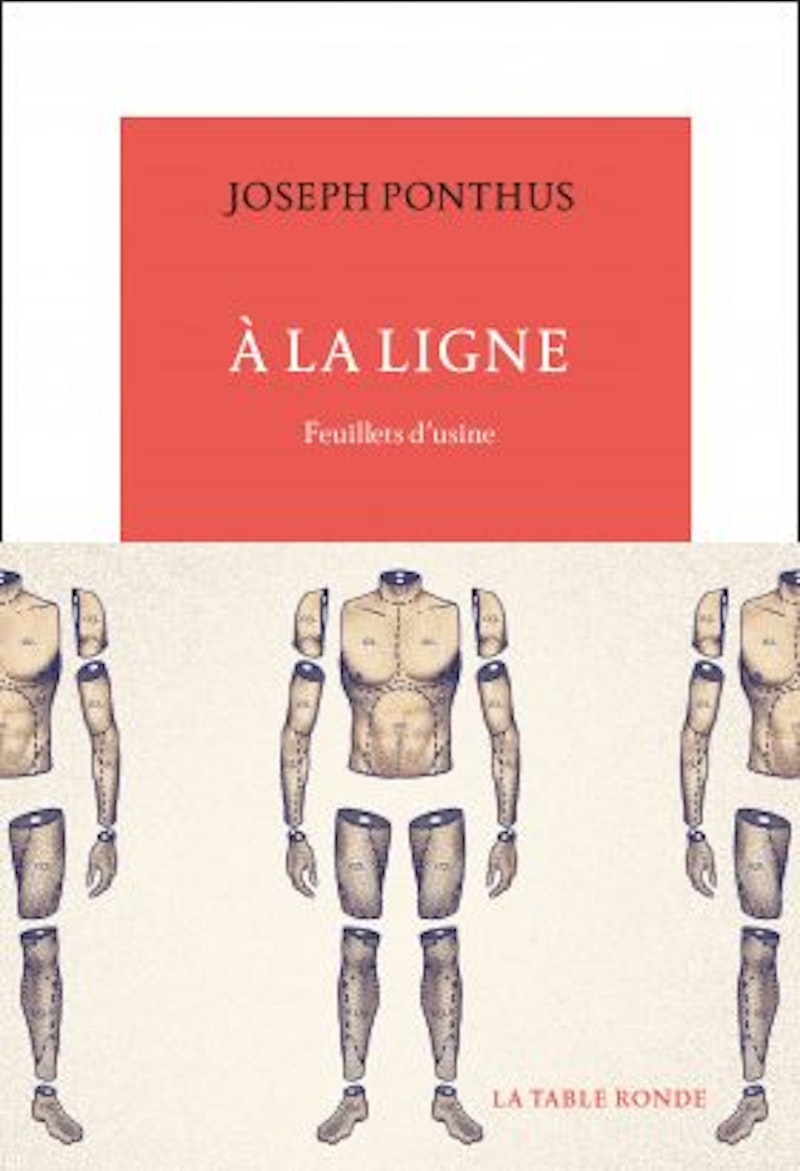
Demain
En tant qu’intérimaire
L’embauche n’est jamais sûre
Les contrats courent sur deux jours une semaine tout au plus
Ce n’est pas du Zola mais on pourrait y croire
On aimerait l’écrire le XIX° et l’époque des ouvriers héroïques
On est au XXI° siècle
J’espère l’embauche
J’attends la débauche
J’attends l’embauche
J’espère
La précarité de l’emploi rend la tâche absurde. L’auteur devient un Sisyphe que l’on envoie au besoin dans un usine de crevettes ou de poissons panés, puis à l’abattoir, où les carcasses s’empilent, dont il traîne les relents où qu’il aille, jusque dans ses rêves, « ces mauvais rêves de carcasses/De bêtes mortes/Qui me tombent sur la gueule/Qui m’agressent/Atrocement/Qui prennent le visage de mes proches ou de mes peurs les plus profondes. ». On pense alors aux toiles de Jérôme Bosch, aux angoisses de Bacon, aux visions de Dante. Le roman social de notre temps devient une catabase, une descente aux enfers, dont on n’échappe jamais tout à fait. Céline, déjà, évoquait l’usine en ces termes, dans son Voyage au bout de la nuit :
On existait plus que par une sorte d’hésitation entre l’hébétude et le délire. Rien n’importait que la continuité fracassante des mille et mille instruments qui commandaient les hommes.
Quand à six heures tout s’arrête on emporte le bruit dans sa tête, j’en avais encore moi pour la nuit entière de bruit et d’odeur à l’huile aussi comme si on m’avait mis un nez nouveau, un cerveau pour toujours.
Le roman social de notre temps devient une catabase, une descente aux enfers, dont on n’échappe jamais tout à fait.
Une mythologie de l’usine
Dans cet entrelac de rouages, de ferraille, les hommes sont dépiautés, lacérés ; quand on n’y perd pas la raison, on en perd un doigt saisi dans une machine. Ce n’est plus « l’époque des ouvriers héroïques » en effet, et pourtant, l’auteur poursuit une sorte d’idéal, une certaine vision de la bravoure des êtres, de leur résignation, de leur persévérance devant les épreuves. Un idéal qui a perdu de sa splendeur sans doute, mais qui grandit les hommes à la mesure de leur petitesse. A la ligne devient une odyssée mécanique, de bulots, de boulons, de petit boulot en petit boulot comme Ulysse d’île en île.
Et même si nous ne sommes que mercredi et que l’enfer sera sans doute ce nouveau samedi travaillé
L’usine sera ma Méditerranée sur laquelle je trace les routes périlleuses de mon Odyssée
Les crevettes mes sirènes
Les bulots mes cyclopes
La panne du tapis une simple tempête de plus
Il faut que la production continue
Rêvant d’Ithaque
Nonobstant la merde
Joseph Ponthus, en s’approchant de l’éphémère, de l’instant, de la ponctualité du geste au-dessus du tapis roulant, inscrit paradoxalement le petit monde qu’il décrit dans une mythologie qui le dépasse, dans un temps long, expression que le narrateur entend d’ailleurs de la bouche d’un de ses collègues avant de conclure : « Le temps long/Ce bon vieux Braudel qui m’explose à la gueule au cœur de l’abattoir/Putain Fernand/Si tu savais/Qu’un ouvrier sans études te convoque sans le savoir/J’en ris et je rêve/De toi mon bon Fernand et de ta/Méditerranée à l’époque de Philippe II »
Une écriture en quête de poésie
Pourtant la permanence de la misère des hommes épouse la fulgurance d’une écriture précise, tranchante, saccadée, hachée qui imite la cadence du travail à la chaîne, qui se révèle être métaphore lui-même de l’existence :
Et puis
Quand tu rentres
A la débauche
Tu rentres
Tu zones
Tu comates
Tu penses déjà à l’heure qu’il faudra mettre sur le réveil
Peu importe l’heure
Il sera toujours trop tôt
L’auteur, dans un entretien donné à Libération, expliquera ce style, ce rythme : « Sur une ligne de production, tout s’enchaîne très vite. Il n’y a pas le temps de mettre de jolies subordonnées. Les gestes sont machinaux et les pensées vont à la ligne. ».
C’est une quête de la poésie qui se dissimule dans cette répétition terrible du travail à la chaîne, et qui justifie les nombreuses rêveries de l’auteur à l’égard de sa propre mythologie, Braudel et ses références, les chansons de Charles Trenet, de Barbara ou de Léo Ferré…
Mais cette écriture de la mécanique rappelle tout autant les vers libres de « Zone » d’Apollinaire, dont une citation en exergue ouvre justement le roman : « C’est fantastique tout ce qu’on peut supporter. » Et c’est peut-être là que l’on perçoit la plus grande richesse du texte : on y apprend à supporter l’adversité, à tenir bon malgré le poids sur les épaules d’une existence paradoxalement évidée, toujours en quête de ce qui peut la sublimer. Car c’est une quête de la poésie qui se dissimule dans cette répétition terrible du travail à la chaîne, et qui justifie les nombreuses rêveries de l’auteur à l’égard de sa propre mythologie, Braudel et ses références, les chansons de Charles Trenet, de Barbara ou de Léo Ferré : « Quelle poésie trouver dans la machine la cadence et l’abrutissement répétitif/Dans ces machines qui ne fonctionnent jamais ou qui vont trop vite » demande l’auteur. Toute la question est là : quelle poésie trouver ? Et l’auteur poursuit, coûte que coûte, son idéal, entreprise qui semble perdue d’avance, mais devant laquelle il ne renonce pas, se recueille dans l’écriture pour y puiser sa grâce, fût-elle parfois grotesque, comme le monde après tout :
Des sonnets de rêve
J’avais même dû réussir à faire rimer
Abattoir et foutoir
Crevette et esperluette
Usine et Mélusine
Ces instants d’écriture, pris aux heures d’astreinte, sont « autant de baisers volés » ; et si la disparition prématurée de cet immense écrivain a interrompu son œuvre d’un cancer qu’il évoque avec pudeur dans les dernières pages, les derniers mots, aux trousses de la poésie, donc de l’éternité, se jouent de la mort :
Il y a qu’il n’y aura jamais
De
Point final
A la ligne












