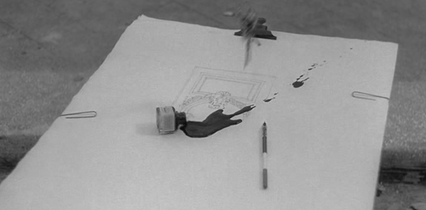- Courts métrages #5 : Nightvision de Clara Claus (2021, France) et Un monde flottant de Jean-Claude Rousseau (2021, France)

Un célèbre photographe qui s’exile du monde en travaillant seul dans son studio ses images capturées au réel, un rapport avant tout plastique entretenu avec son environnement, à la société et aux êtres qui la composent, une silhouette enfin qui se révèle autant qu’elle se dissimule à l’objectif de la caméra, présence métonymique et menaçante d’un crime qui n’attend qu’à être vu pour enfin se matérialiser… Le faisceau d’indices ne peut que mener à cette évidente analogie : le Nightvision de Clara Claus se déploie avec l’ombre du Blow Up d’Antonioni rôdant dans le hors-champ. Assistante personnelle de Thomas Hoepker, ayant notamment pour mission de nettoyer numériquement les tirages de ses prises de vues argentiques, Clara incarne un angle mort double, voire triple, du long-métrage du maître italien.
Le premier, c’est d’abord qu’elle est une femme, qui travaille, existe et vit sa vie non plus devant ni même derrière mais au-delà du regard de l’objectif : toutes les images fabriquées pour le film sont nées exclusivement dans son œil de cinéaste, dans sa représentation, en tant que sujet, du monde, dans son désir de le mettre en scène et de se représenter elle-même, à son tour, face à lui, de prendre le contrôle de son image. Il existe bien sûr une exception qui résiste à cette volonté, et qui en est peut-être même le point de départ. Installé dans les paisibles mais isolés hameaux des Hamptons de Nouvelle-Angleterre, le studio du photographe est visité la nuit venue par un inquiétant et sombre inconnu – intrusion capturée par une caméra de surveillance – au visage impossible à identifier, dissimulé derrière le quadrillage pixellisé d’une image à basse résolution. Le grain argentique a beau s’être transformé en bruit numérique, le réel persiste encore à se dérober à sa reproduction mécanique : il se fait écran.
Et si elle protégeait in fine Vanessa Redgrave dans Blow Up, cette résistance de la réalité face à sa représentation piège ici Clara, l’enferme dans sa crainte d’un agresseur potentiel, puisque précisément elle l’a vu mais, comme le Thomas londonien des swinging ’60s, sans le voir. C’est sans doute le plus terrifiant dans cette révolution tant copernicienne que foucaldienne qu’invite incidemment à contempler ce fascinant Nightvision : si au siècle dernier, l’écran permettait aux auteurs de cacher leurs crimes à la vue de tous, il est dorénavant surtout un puissant outil de contrôle de population, garant de leur sécurité et en même temps fabriquant les images matérialisant la peur dont leurs cauchemars sont faits.
PS : Un monde flottant de Jean-Claude Rousseau complète le programme d’aujourd’hui, dernier projet en date d’un illustre cinéaste à la filmographie dont je suis, je l’avoue, tout à fait ignorant. Disons modestement que je suis resté aussi extérieur à cette succession de vignettes filmées du Japon d’aujourd’hui qu’un confiné francilien pourra l’être, sans restriction de durée, dès ce week-end, de 6h à 19h.
Rediffusion du programme : aujourd’hui à 13h à cette adresse
- A River Runs, Turns, Erases, Replaces de Shengze Zhu (2021, États-Unis)

Il est des films que sature la vision, et d’autres où il n’y a rien à voir. Mais rien à voir, ne veut pas nécessairement dire : rien à entendre, rien à sentir. Dans le cas de A River Runs, Turns, Erases, Replaces, équivoque est la limite entre ces deux riens. Imaginez une série de plans fixes sur des aspects de Wuhan qui auraient tout aussi bien pu être des cartes postales. Imaginez qu’aucun son, autre qu’ambiant, ne les accompagne. Imaginez qu’il y a, cependant, de temps à autre, l’écriture manuscrite d’un carnet en surimpression qui raconte la distance, la culpabilité, le deuil. Car on est à Wuhan où tout a commencé et toutes les familles s’y sont déchirées. J’ai pleuré, mais je suis émotif à l’extrême, et la séparation des êtres m’afflige. Alors quand je lis cette voix souffrante faire appel dans l’espace vide du temps à une mère enclose en son confinement, oui : je peux pleurer. Mais j’ignore s’il s’agit d’un effet du film, ou de mon propre contexte. Car le film est si étiré, si passif, si peu dynamisé en ses visions statiques que cela m’échappe sans profondeur, entre deux larmes de naïf ; entre deux sentiments d’effondrement et de clôture. Ce film est peut-être trop plat, peut-être n’ai-je pas le goût des fixités. Peut-être sera-ce ainsi que l’on se souviendra des hommes reclus de nos tristes années lentes : minuscules, effacés, écrasés à jamais sur la platitude sans dehors de quelques cartes postales.
Rediffusion du film : aujourd’hui à 16h30 à cette adresse
- VENICE BEACH, CA de Marion Naccache (2021, France)

Hollywood – et son spectateur avec, il est vrai – adore fantasmer l’apocalypse et décliner dans ses productions la catastrophe en sa myriade de virtualités, toutes plus spectaculaires les unes que les autres : ère glaciaire, guerre atomique, invasion extraterrestre ou faille de San Andreas engloutissant toute forme de civilisation (étasunienne du moins), tous les moyens sont bons pour faire de l’extinction humaine une apothéose. Or, c’est bien à La-La Land que Marion Naccache a posé sa caméra pour y filmer une apocalypse, bien réelle cette fois et donc quasiment imperceptible. Dans la succession de plans fixes qui constitue l’unique régime d’images de VENICE BEACH, CA, la côte bétonnée de Los Angeles semble atteinte de léthargie, plongée dans un demi-sommeil qui la préserverait des vicissitudes du temps, royaume béni sur lequel le soleil se lève sans discontinuer, arrêtant montres et horloges sur une éternelle heure bleue. Un trouble chromatique qui dissimule aux yeux de tous le passage de la nuit au jour, dans lequel s’évanouissent sans-abris et junkies. Après le ghetto urbain, le ghetto temporel. Si la nuit elle appartient aux déshérités, Venice Beach cherche à se parer le jour d’un vernis éclatant : tout juste verra-t-on, en guise de rappel acide, un camion de pompier venir chercher sur la plage, sans hâte ni précipitation, le corps sans vie d’un infortuné anonyme.
À Venice Beach, une guerre invisible fait rage. Elle oppose ses habitants historiques, chantres de la contre-culture, et les employés de Snapchat, bien décidés à refonder l’ancienne cité à la hauteur de leurs rêves technophiles où le passé comme la pauvreté n’auront pas droit de séjour. Une astuce pour les distinguer à l’image (le chic ultime pour un milliardaire étant de ressembler à un hobo, ne pas se fier à l’habit, qui ne fait pas le pauvre) ? Le mouvement : les premiers sont statiques, demeurent à même le sable et le béton, militent ou vendent des œuvres d’art de leur création, quand les autres font leur footing quotidien, puis se rendent au travail, le pas décidé. C’est avec la parole des premiers que la réalisatrice tisse une histoire du lieu, une histoire de mémoire et de croyance, dont chaque témoignage vient enrichir la mythologie foisonnante, lieu de tous les miracles et de tous les fléaux. Ce fabuleux syncrétisme convoque aussi bien Donald Trump, le second amendement et le spectre d’une nouvelle guerre civile, que l’énergie solaire, la téléportation interstellaire et la projection astrale. Des histoires à dormir debout ? Peut-être. Peut-être aussi que les anges déchus de Venice Beach, ce royaume perdu, ont appris à se méfier et de la nuit et du sommeil.
Rediffusion du film : aujourd’hui à 20h à cette adresse