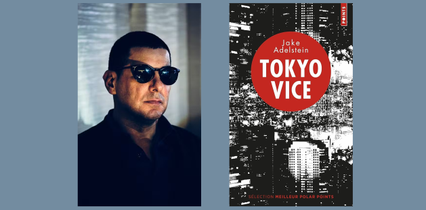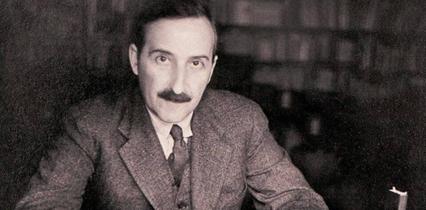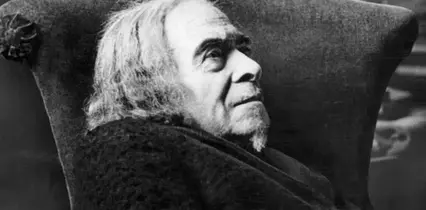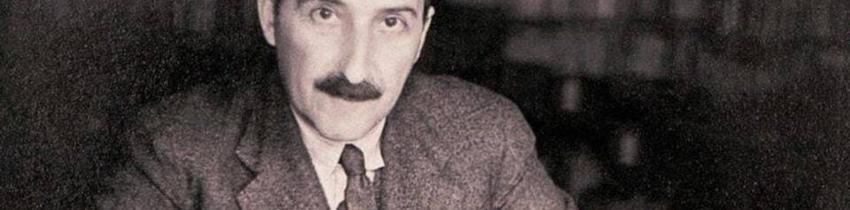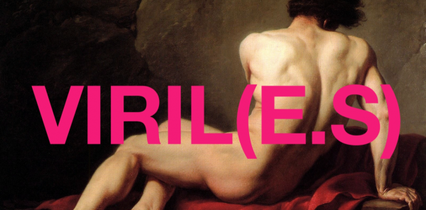Luciana Peker construit dans L’amour, inné ou construit ? une critique méthodique des représentations dominantes de l’amour, en les replaçant au cœur d’un système de pouvoir, de hiérarchie, de normes. Elle ne cherche pas à condamner un sentiment, à le placer sur le banc des accusés, mais à interroger les formes sociales qu’il prend, les structures qui l’encadrent, les scripts qui le figent, formes et structures créés par l’humain. L’amour est ici analysé comme un rapport structurant, mêlant, évidemment, intime et politique.

Admettons-le, le récit amoureux reste encore fortement contraint par un imaginaire conjugal fondé sur la domination masculine. La relation de couple continue d’être perçue comme un objectif central, garant de stabilité et de réussite personnelle. Luciana Peker déplace le regard : « L’amour romantique conduit ses adeptes à vivre sur cette idée qu’il se couple, car il relègue tout le reste au second plan. Il privilégie le duo plutôt que la communauté. » L’analyse ne vise pas la fusion émotionnelle, mais la centralité d’un modèle affectif qui écarte les autres liens possibles.
Les formes amoureuses dominantes valorisent l’exclusivité, la monogamie, la performance conjugale, en les opposant à tout ce qui échappe à ce cadre. L’amour est en cela condition de reconnaissance, un lieu d’investissement total, une économie émotionnelle souvent déséquilibrée : comment peut-on le penser aujourd’hui ?
Construire un lien sans appropriation
La question centrale concerne le rapport à l’autre, la possibilité d’un lien sans domination. « Le polyamour, en multipliant les partenaires, avertit-elle, dénonce la propriété. » L’autre ne vient pas combler un vide, rassurer une identité ou fournir une protection. L’autre existe à distance, dans la reconnaissance mutuelle. Ce déplacement rend possible une nouvelle grammaire affective, fondée sur le consentement, l’altérité, l’autonomie. L’amour n’a plus pour rôle de sécuriser mais de faire exister autrement. Peker écrit : « On demande parce qu’on sait qu’on peut offrir. » Le lien n’est plus un contrat, encore moins un devoir. Il devient un espace d’échange, de parole, de transformation de l’échange et de la parole, justement. »
La proposition de cet ouvrage engage un travail de transformation : concevoir des relations sans dette et surtout sans propriété.
L’amitié comme cœur d’une politique affective
Le texte recentre l’attention sur l’amitié, qui n’est bien sûr pas un substitut à l’amour mais une forme relationnelle à part entière. « Les amies ne font pas obstacle à l’arrivée de l’amour, mais elles sont véritablement des amies. » L’amitié permet un lien sans hiérarchie, sans sexualisation imposée, sans dépendance matérielle.
Elle introduit une fidélité fondée sur la durée, sur l’écoute, sur la réciprocité. Loin d’être reléguée aux marges de la vie affective, elle redevient structurante. « Les comédies girlfriends offrent des moments de rire ou de larmes, mais ne prétendent pas guérir l’attente de ce qui ne vient pas. » À travers cette phrase, le texte fait émerger une culture relationnelle qui ne dépend pas de la reconnaissance amoureuse, bien que la société tente de nous faire croire l’inverse.
Défaire les scénarios imposés
Peker étudie la force des scripts sociaux : le mariage, les demandes spectaculaires, les tatouages comme preuve de loyauté. L’adhésio...