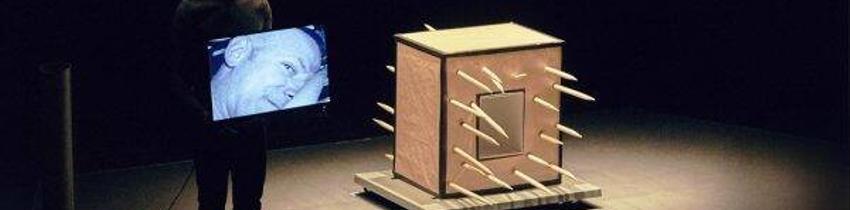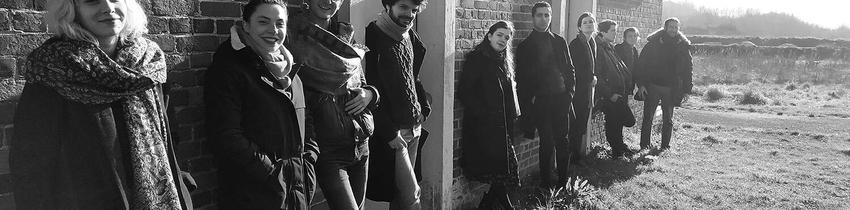L’alt-lit s’est imposée comme un courant littéraire insaisissable, un mouvement sans manifeste, accouché par des plateformes telles Tumblr et Skyblog. Mais L’alt-lit n’est pas « juste » une littérature d’Internet, elle est surtout l’expression d’une jeunesse née dans un ordinateur. Toute notre génération, depuis les années 1990 jusqu’à maintenant, est orpheline. Internet a tué nos parents. Nous n’avons pas de lignage clair, peu d’ancrage territorial, nos figures tutélaires sont Britney Spears et Lana Del Rey. Nous aimons les Memes, TikTok et Pornhub. Nous sommes pudiques, voyeurs, exhibitionnistes. Nous rêvons de devenir des It-girls-boys. Nous sommes élevés par des forums divers, des fils de discussions Reddit, des posts anonymes sur 4chan. Toute notre intimité s’étale dans des formats bruts, où la dépression se performe, autant qu’elle se raconte et se photographie jour après jour, où la sexualité est un champ d’angoisses, de complexes, et de fantasmes, aussi SM que softcore.
L’alt-lit est la directe sécrétion littéraire de notre monde.
On l’a dite morte au milieu des années 2010. Peut-être parce qu’elle s’était trop exposée. Peut-être aussi parce qu’elle s’était déjà diffusée clandestinement ailleurs, fragmentée dans une littérature contemporaine qui récupère ses motifs, ses territoires. Tao Lin, Marie Calloway et bien d’autres ont posé les premières pierres d’un édifice qui, plutôt que de s’effondrer, a continué de se reconfigurer (et continue sans cesse) imperceptiblement, comme Internet.
Mais l’alt-lit a aussi heurté les mutations de son époque. MeToo l’a traversée, l’a balayée, l’a nettoyée (plus ou moins). Elle a aussi été récupérée par des discours et mouvements d’extrême droite, rendant son positionnement politique difficile à saisir, aussi schizo et paranoïaque que notre époque.
S’interroger sur l’alt-lit, c’est donc avant tout questionner la possibilité d’une littérature profondément contemporaine. Une littérature de notre temps, qui ressemble aux jeunes auteurs et autrices, qui ressemble à ses lecteurs. Une littérature décloisonnée. Provocatrice. Une littérature de l’espace, du numérique. Une littérature sans genre, une littérature offensive, troublante, vénéneuse.
Ce dossier n’a pas vocation à figer une définition, mais à explorer. Chaque texte ici est une tentative, une piste, une mise en jeu de ce que pourrait être une littérature véritablement contemporaine. Car la littérature d’aujourd’hui n’est pas celle qui informe ou qui modèle l’époque, mais celle qui se laisse modeler par elle, qui accepte l’éclatement de son médium, de ses formes, de ses moyens discursifs. Une littérature poreuse, traversée par la culture numérique, par les images, par la vitesse et la saturation du monde.
Zoé Besmond de Senneville ouvre le dossier avec une réflexion sur le corps exposé, la nudité et la mise en regard, à travers un texte composé de notes prises sur son téléphone portable. Sabine Audelin plonge dans les archives de Tumblr, lieu matriciel de l’alt-lit, espace de déconstruction et de surgissement. Iris Schwarzkopf interroge un texte flottant sur le web, analysant comment l’alt-lit continue de résonner dans l’écriture contemporaine. Valentine Deprez documente jour après jour les échos que provoquent son crâne nu autour d’elle. Renée Zachariou rend hommage à Marie Calloway, revisite son héritage et sa place dans l’histoire d’une littérature qui refuse de s’institutionnaliser. Un récit-enquête vertigineux, d’Estelle Normand, se lance sur les traces de l’auteure disparue après la publication de Quel but ai-je servi dans ta vie ?.
Un entretien avec Clément Braun-Villeneuve, éditeur chez Pauvert et fondateur de Premier Degré, nous éclaire sur la manière dont l’alt-lit continue d’exister, de se traduire, de se transformer. Avec son Journal du crâne rasé, Valentine Deprez réinterroge l’usage très contemporain du journal, avec ce récit radical composé de notes et de selfies. Son crâne rasé, déclencheur d’une métamorphose autant physique que sociale, devient le moyen d’interroger la brutalité du regard, et l’impossible neutralité du rapport à soi dans un monde d’images.
Enfin, John Jefferson Selve, avec un texte hybride et sensoriel, explore les figures du numérique, prolongeant la démarche entamée dans son premier roman Meta Carpenter, où s’entrecroisaient cam girl et drones.
Qu’est-ce qu’une littérature de son temps ?
Ce dossier ne prétend pas apporter une réponse. Il ouvre des pistes, il interroge, il se risque. Et surtout, il accepte de se laisser traverser par l’époque, pour voir jusqu’où elle peut l’emmener.
Illustration : Harmony Korine, Baby Invasion