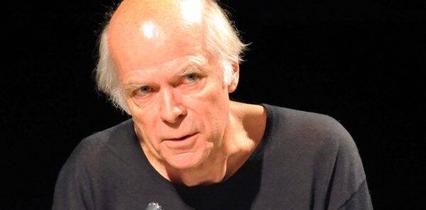Avec les Naufragés du Wager, David Grann, auteur de la Note américaine adapté au cinéma par Martin Scorsese, montre avec son brio habituel et son sens inné du récit et de l’aventure comment des gentlemen britanniques se sont trouvés réduits à la barbarie la plus bestiale, jusqu’à se rendre coupables de cannibalisme. Magistral, au suspense haletant et résultat d’un travail de recherche documentaire aussi fourni que divers, les Naufragés du Wager se lit comme un roman d’aventures à la Stevenson ou à la Edgar Poe. Que s’est-il vraiment passé sur cette île ? C’est à cette question que Zone Critique tentera de répondre en s’entretenant avec David Grann.
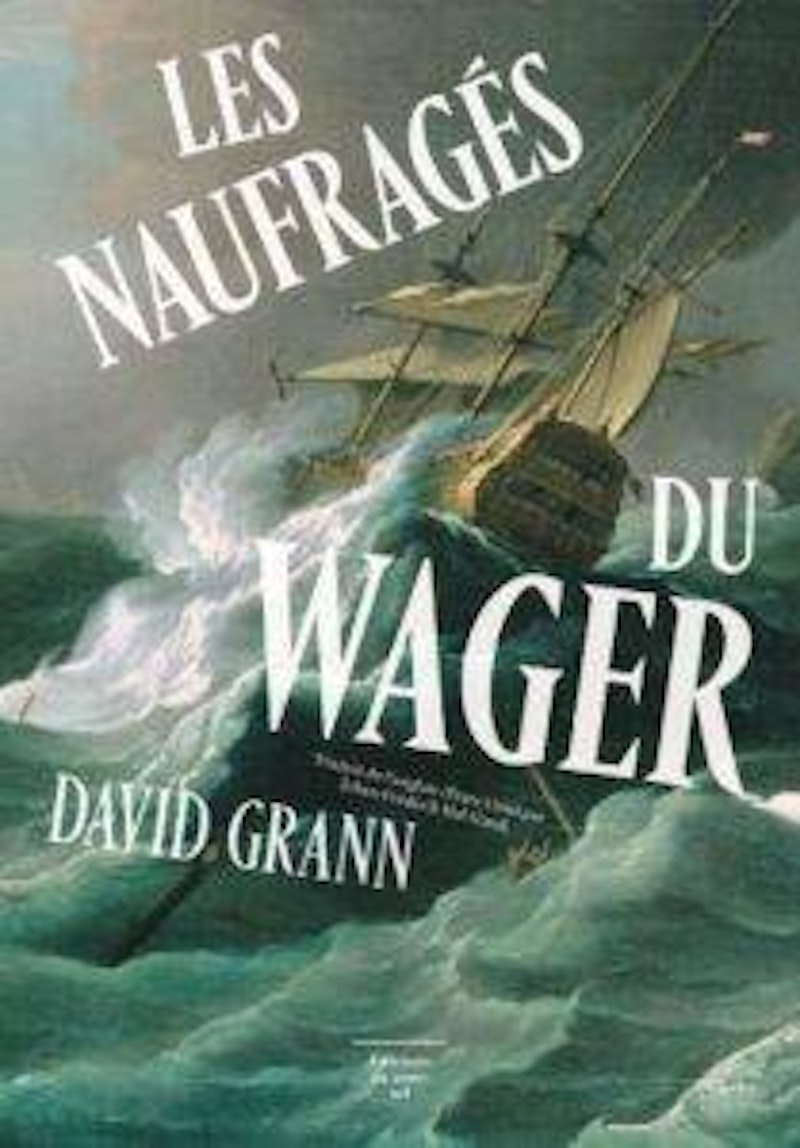
Le naufrage du Wager (1) est un épisode de l’Histoire plutôt méconnu de nos jours. Comment en avez-vous eu connaissance et pourquoi vous y être intéressé ? Il faut préciser que Les Naufragés du Wager est différent de vos ouvrages précédents dans le sens où c’est la première fois que vous abordez un récit qui se déroule au XVIIIe siècle.
C’est en effectuant des recherches en ligne sur les mutineries que mon attention a été attirée sur un journal du XVIIIe siècle rédigé par un certain John Byron, enseigne de vaisseau du Wager, qui devait plus tard devenir le grand-père du poète Lord Byron. Je l’ai compulsé sur Internet, d’abord assez intrigué car il était rédigé en vieil anglais (avec par exemple des S en forme de F), dans une prose quelque peu guindée et archaïque. J’ai poursuivi ma lecture où s’enchaînaient de longues descriptions de mutineries, de famine, de scorbut, de naufrages et de cannibalisme. Une fois ma lecture achevée, j’ai réalisé que ce petit livre étrange contenait des éléments qui me faisaient entrevoir la possibilité d’une des plus extraordinaires sagas d’aventures, de chaos et de survie que j’aie jamais connues. Mais ce n’était qu’un premier aperçu.
J’ai par la suite approfondi et étendu mes recherches, fasciné non seulement par l’histoire de la survie des naufragés sur l’île inhospitalière du Wager [l’endroit du sud de la Patagonie où le navire Wager a fait naufrage et qui a donné son nom à l’île] mais aussi par les péripéties qui ont suivi leur départ de l’île jusqu’à leur retour mouvementé en Angleterre où, convoqués devant une cour martiale, ils risquèrent la mort par pendaison pour des crimes qu’ils auraient commis sur l’île.
C’est en consultant ces archives que je me suis rendu compte qu’il s’agissait d’une lutte pour la vérité davantage que d’un récit de survie. Chacun des naufragés a livré sa propre version des faits dans l’espoir de se disculper et de sauver sa vie ; de faux journaux de bord, où tout était inventé et qui prenaient parti pour tel ou tel camp (celui des mutins ou celui des fidèles du capitaine du Wager), ont même été fabriqués pour profiter du scandale du moment et gagner de l’argent facilement.
Après ma journée de travail, je rentrais chez moi et, en lisant le journal ou en regardant les actualités à la télévision, j’assistais à des débats acharnés sur les « fake news » et la désinformation. Trois cents ans plus tard, rien n’avait finalement changé.
Cette affaire permet de se poser de nombreuses questions : qui a le droit de raconter l’Histoire ? Quelle version doit l’emporter et pourquoi ? Dans quelle mesure cela peut-il ébranler le cours des événements ? Par quels moyens l’empire britannique choisit-il d’interpréter ou réinterpréter l’Histoire dans un sens qui lui est évidemment favorable ? Cela renvoie à nos propres débats actuels : comment doit-on enseigner l’Histoire et au travers de quels livres ?
C’est à ce moment-là que je me suis dit que, même si je n’avais pas au préalable l’intention d’écrire sur le XVIIIe siècle et bien que je ne susse rien de la vie quotidienne sur un navire britannique de l’époque, cette histoire était intemporelle car elle n’était rien moins qu’une étude de la condition humaine, de la nature humaine.
La petite société de naufragés sur l’île que je décris est une société qui se brise, se décompose, se désintègre et s’effondre. C’est une parabole de notre époque très tourmentée.
Voilà les raisons pour lesquelles j’ai décidé d’écrire ce livre.
Ce qui fait la spécificité de cet épisode, c’est sa résonance avec des thèmes d’actualité comme en effet, d’un côté, les fake news, la désinformation, la guerre éditoriale et, de l’autre côté, l’héritage de la colonisation, qui fait l’objet de débats. Vous abordez cette question, notamment à travers le personnage de John Duck, un naufragé qui a été réduit en esclavage.
John Duck est un personnage très important dans cette histoire. C’était un marin noir affranchi qui a réussi à survivre à tout : au scorbut, au naufrage, au raz-de-marée, à la famine… puis au très long voyage de retour. Mais contrairement aux autres survivants qui sont parvenus à regagner l’Angleterre, il n’a pas pu raconter son histoire
Oui, tout à fait. John Duck est un personnage très important dans cette histoire. C’était un marin noir affranchi qui a réussi à survivre à tout : au scorbut, au naufrage, au raz-de-marée, à la famine… puis au très long voyage de retour. Mais contrairement aux autres survivants qui sont parvenus à regagner l’Angleterre, il n’a pas pu raconter son histoire. Pourquoi ? Car il a été capturé aux alentours de Buenos Aires et réduit en esclavage. Nous perdons ensuite complètement sa trace. Il s’agit là d’une de ces nombreuses vies qui ont disparu des livres d’histoire. Il a été la victime de ces terribles silences que nous nous imposons et des erreurs tragiques que nous avons commises. Son histoire reflète fondamentalement ces fragments de notre passé que nous mettons délibérément à l’écart.
Mais même si je n’ai pas pu raconter le destin de John Duck en détail, faute de sources, j’estime que le silence qui pèse sur lui est très éloquent. Il fait, d’une certaine manière, un lien avec mon livre précédent, la Note américaine [Killers of the Flower Moon], sur le rapport à l’Histoire, bien que les sujets traités soient différents.
Les Naufragés du Wager n’est pas un livre d’histoire mais un récit. Ce n’est pas pour autant un roman non fictionnel à la Truman Capote, et l’important appareil de notes le prouve. Transformer un journal de bord en récit captivant qui se lit comme un roman avec des héros, des méchants, des péripéties et du suspense a-t-il représenté le point le plus délicat ?
Oui, c’est la tâche la plus difficile car les textes sont anciens et souvent parcellaires et vous devez trouver le matériau nécessaire pour élaborer une histoire. Il faut s’immerger complètement dans un monde qui vous est étranger, apprendre à connaître les gens qui y vivent et qui sont très différents de vos contemporains et rendre tout cet univers familier. Mais il y a un élément qui ne change pas et qui vous permet de faire le lien entre votre époque et celle-là : c’est la nature humaine, qui reste la même. Vous pouvez changer les costumes, les accents, la géographie…, vous reconnaissez malgré tout des traits de caractère communs, et dans une certaine mesure c’est cela qui permet de surmonter l’obstacle du manque de sources. C’est aussi ce qui rend l’histoire si passionnante. Chacun des personnages a sa propre ambition, sa propre recherche de gloire, ses propres réflexes de classe. Et c’est encore le cas aujourd’hui.
On finit par se demander ce qu’on aurait fait sur cette île, quelle personne on aurait été. Dans ce genre de situations extrêmes, la nature humaine se met à nu, on voit qui ces gens sont réellement. Et c’est aussi cela qui m’attire dans une histoire comme celle-ci.
C’est pourquoi vous avez une certaine empathie pour vos personnages, notamment John Byron, qui est, pourrait-on dire, le « héros » du livre. Vous semblez l’excuser de participer à la première mutinerie, chose qu’il regrette tout de suite d’ailleurs, ce qui le poussera à quitter les mutins pour revenir auprès du capitaine Cheap.
La vérité est fragmentée en plusieurs points de vue. Il était donc nécessaire de savoir par quel bout la prendre et, de fait, il devenait primordial de trouver une structure qui s’intègre à l’histoire, et qui en approfondisse les thèmes.
C’est pourquoi j’ai décidé d’écrire l’histoire selon les trois points de vue concurrents du capitaine Cheap, du mutin John Bulkeley et du loyaliste John Byron. J’ai fait de mon mieux pour narrer les faits de la manière dont ils auraient souhaité les voir retranscrits. L’important n’est pas de les disculper ou même de les justifier, mais simplement de les comprendre. Aucun d’entre eux n’est tout à fait bon ni tout à fait mauvais, ils sont comme chacun d’entre nous, avec leurs forces et leurs faiblesses.
Quand vous écrivez sur ces personnages, vous pouvez éprouver de la sympathie pour eux et même admirer leur courage et l’instant d’après, vous changez d’avis. Tout est question de perspective. Je prends l’exemple du capitaine Cheap : vous le voyez, alors qu’il perd petit à petit toute autorité sur ses hommes, s’effondrer intérieurement, vous ressentez de l’empathie, une certaine pitié, jusqu’à ce qu’il commette ce crime injuste sur l’île et soudainement, vous changez de point de vue et vous passez du côté de Byron qui, bien que loyaliste, se pose alors la question de savoir s’il doit continuer à soutenir le capitaine alors qu’il vient de tirer dans la tête d’un de ses camarades. Ce qui est intéressant pour moi, c’est que Byron évolue et change de point de vue sur ses camarades d’infortune et sur les événements, au fil de l’histoire.
C’est à travers chacun d’eux que l’on approche de la vérité, chacun ayant ses propres justifications, ses propres raisonnements et c’est en combinant ces différentes torsions de la même réalité, comme s’il s’agissait de reflets dans un miroir déformant, que vous parvenez à la vérité.
Vous réalisez un travail d’enquêteur. Comment établissez-vous la frontière entre l’enquête du journaliste et le travail de recherche d’un historien ?
Je pense qu’il ne faut pas se cloisonner. C’est amusant, les gens me demandent souvent : mais qu’êtes-vous au juste ? Un journaliste ? Un historien ? Je ne saurais pas dire. J’ai commencé ma carrière en faisant du journalisme. J’étais donc attiré par l’actualité, du moins je pensais l’être. Mais on accorde de manière générale beaucoup trop d’importance à la nouveauté, aux actualités de dernière minute, à l’immédiateté.
Le naufrage du Wager s’étant déroulé il y a presque trois siècles, pourquoi serait-il moins passionnant qu’une actualité récente ? J’ai donc remonté le temps et ai commencé à relater des histoires qui, selon moi, sont révélatrices de cette étrange énigme qu’est la nature humaine et du monde dans lequel nous vivons. Cela m’a vraiment libéré de la dictature de l’immédiateté.
On a qualifié mon travail de littérature de non-fiction. Mais ce que je veux, c’est raconter des histoires. J’ai été un mauvais journaliste car j’ai toujours souhaité les exposer dans leur déroulé chronologique, du début à la fin. Or, mes éditeurs, même s’ils trouvaient mes articles très bons, préféraient commencer par la fin de sorte que le lecteur sache dès le départ de quoi il s’agit. J’avais beau me récrier en demandant quel serait alors l’intérêt pour le lecteur de poursuivre sa lecture, il n’y avait rien à faire.
J’ai donc préféré suivre ma propre voie et raconter comme je l’entends, en me laissant guider au fur et à mesure par les événements tout en restant fidèle aux faits. C’est en cela que consiste le défi majeur que j’aime à relever. On pourrait presque parler de littérature des faits.
Si l’on rappelle le contexte, il s’agit d’une expédition maritime britannique de six navires accompagnés de deux navires marchands, menée par le commodore [équivalent de contre-amiral] George Anson, dans le cadre de la Guerre de l’oreille de Jenkins entre le Royaume-Uni et l’Espagne, déclenchée pour des raisons fallacieuses, comme vous le montrez, alors que le véritable objectif était la domination des mers, militairement et surtout économiquement. Pouvez-vous rappeler les grandes lignes de cette expédition qui s’est révélée un fiasco presque total ?
Cette guerre s’est déroulée de 1739 à 1748 sur fond de rivalités entre empires britannique et espagnol, puissances commerciales et coloniales. Le premier voulait briser l’emprise du second sur une grande partie de l’Amérique latine pour ouvrir une route commerciale jusqu’en Asie et ambitionnait, pour ce faire, de monopoliser les ressources naturelles du continent et exercer sa mainmise sur le commerce américain.
On nomme ce conflit la Guerre de l’oreille de Jenkins en raison d’un incident au cours duquel le capitaine d’un navire espagnol, après avoir arraisonné un navire marchand britannique qui croisait dans ses eaux, et commandé par un homme nommé Robert Jenkins, lui aurait prétendument coupé l’oreille en guise de châtiment.
Les Anglais, et en premier lieu les partisans de l’expansionnisme britannique, se sont emparés de cet incident et ont milité pour l’entrée en guerre à coups de propagande dans les journaux, les livres et les œuvres de fiction. Cependant, le nom a été très mal choisi car il s’est avéré que l’incident avait eu lieu bien des années avant la déclaration de guerre officielle et n’avait aucun rapport avec les vrais motifs du conflit. Ce n’était qu’un prétexte.
Le naufrage du Wager est mal tombé pour l’Amirauté britannique dont le principal souci était de préserver son image et sa réputation, d’autant plus que l’expédition était très mal préparée. Ainsi, la mutinerie a été complètement passée sous silence et le procès qui a eu lieu et qui est décrit dans votre livre ne l’a même pas abordée. C’est paradoxal.
C’est très révélateur car l’un des principaux arguments que l’empire britannique mettait en avant pour justifier son impitoyable expansion et son désir de conquête consistait à prétendre que sa civilisation était en quelque sorte supérieure à celle des autres.
Or, après l’échouement et l’arrivée sur l’île, les officiers et tout l’équipage britanniques, qui étaient la soi-disant avant-garde de l’Empire, ont sombré dans un cauchemar et un état bestial dignes de Sa Majesté des Mouches, avec des factions en guerre les unes contre les autres, des mutineries, des meurtres et même du cannibalisme. Une fois les survivants rentrés en Angleterre, les autorités britanniques ont écouté, horrifiées, leurs récits. Ce retour à l’état de nature le plus primitif et l’attitude des marins, qui s’étaient comportés moins comme des gentlemen que comme des brutes, menaçaient l’image même de l’Empire et mettaient à mal la prétendue supériorité de la civilisation britannique.
Les autorités ont donc préféré passer officiellement sous silence la mutinerie, qui est devenue célèbre sous le sobriquet de « mutinerie qui n’a jamais eu lieu ». Un premier exemple de l’effet Streisand.
Il faut dire que les mutineries sont une forme de rébellion très menaçante pour l’État, car elles perturbent tout un appareil militaire conçu pour imposer l’ordre. Si cet appareil vient à se dérégler, cela attaque les fondations même de l’Etat et représente un danger mortel. C’est pourquoi les mutineries sont en règle générale brutalement réprimées et leurs auteurs pendus. Mais il arrive aussi, et on le voit dans ce cas, qu’elles soient si menaçantes pour l’État que ce dernier préfère simplement les effacer de la mémoire collective.
On l’a remarqué très récemment en Russie avec la rébellion de Prigojine. Il y a la même folie impériale dans la volonté de la Russie d’envahir l’Ukraine, puis on a assisté à un soulèvement des séides du régime russe. Mais ce dernier a très rapidement choisi de ne pas parler de mutinerie car cela aurait menacé ses bases. C’est un autre cas de « mutinerie qui n’a jamais eu lieu ».
Vous avez effectué un travail de documentation impressionnant, d’autant plus que vous n’aviez a priori pas de connaissance spécifique sur le sujet. Quels sont les principaux défis auxquels vous avez dû faire face ? L’appropriation d’un vocabulaire spécifique, la compréhension de la façon dont on manœuvrait des navires de guerre… ?
Il m’a fallu environ un an pour me sentir à l’aise dans ce nouveau monde et pour apprendre la langue de cette civilisation navigante. Chaque partie du vaisseau a son nom propre, le rôle de chaque matelot est bien défini, de sorte que je ne pouvais pas retranscrire la catastrophe finale sans avoir au préalable décrit ce monde et sans avoir compris ce qu’il était vraiment. C’est pourquoi j’ai souhaité expliquer à quoi il ressemblait et il m’a fallu beaucoup de temps pour que je me sente à l’aise avec la terminologie.
J’ai eu la chance de pouvoir consulter un grand nombre de documents qui subsistent toujours aujourd’hui, malgré les naufrages, les tempêtes et autres. J’ai ainsi pu lire les registres de l’équipage, qui sont pratiquement des registres d’enrôlement [les marins étaient bien souvent recrutés contre leur volonté]. En effet, quand une personne devenait membre d’équipage, son nom était inscrit sur ce registre, avec la date et le grade. Bien souvent, à côté de ces indications se trouvent des symboles étranges : DD. Je n’avais aucune idée de ce que cela pouvait bien signifier. Dans un premier temps, je n’y ai pas prêté attention, puis à force d’en voir, je m’y suis intéressé. Des historiens m’ont alors expliqué que cela équivalait à l’abréviation de « discharged dead » [déchargé ou débarqué mort]. Il s’agissait de l’épitaphe des marins morts en mission. J’ai compté ces DD, ce qui m’a permis de cataloguer et évaluer le bilan tragique de l’expédition. Ces simples petits documents anodins en apparence étaient finalement cruciaux ! En cela, je suis très reconnaissant aux historiens que j’ai consultés et qui ont comblé patiemment mon ignorance en la matière.
Votre récit met en lumière les conditions de vie très difficiles des marins de cette époque, en proie à la malnutrition, au scorbut, aux tempêtes qui anéantiront l’escadre, aux batailles navales, d’autant plus que les marins étaient recrutés en grande partie contre leur gré. Peut-on dire que partir en expédition se traduisait par une mort quasi assurée ?
Un voyage de cette nature et de cette durée, à cette époque, impliquait forcément un taux de mortalité élevé. C’est pourquoi la marine avait toujours du mal à recruter du personnel : les gens fuyaient les recruteurs ou bien désertaient, car ils savaient tous qu’ils risquaient une mort quasi certaine. Cette expédition en particulier, qui a enchaîné les calamités, a été incroyablement funeste : sur près de 2 000 marins en tout, pour l’ensemble des navires, on dénombre 1 300 morts.
Finalement, le plus étonnant, ce n’est pas de mourir, mais de survivre.
Il y a un autre personnage dans votre récit, peut-être le principal antagoniste : le cap Horn. Tel que vous le décrivez, c’est un endroit mystérieux et dangereux. Il a également été une source d’inspiration pour la littérature, abondante à son sujet. Comment expliquer cet attrait qu’il exerce sur l’imaginaire collectif, jusqu’à en devenir un mythe ?
Les êtres humains semblent programmés pour tenter de maîtriser les éléments afin de survivre et de conquérir le monde, parfois brutalement. Le cap Horn a toujours représenté cet endroit où les hommes font face à des éléments qui paraissent invincibles. Je pense que c’est la raison pour laquelle, dans l’imaginaire collectif, ce petit passage à l’autre bout de la Terre, du moins à l’autre bout de l’Amérique du Sud, où se retrouvent les océans Pacifique et Atlantique, est si évocateur. Il faut aussi avoir à l’esprit qu’à l’époque, il n’y avait pas d’autres moyens de se rendre en Océanie et en Asie, du moins par voie maritime. Cet endroit si intimidant, où les vagues peuvent renverser un bateau de trente mètres de long, où les courants sont les plus forts de la planète et où les vents sont capables de souffler à plus de 300 km/h, n’a pu que stimuler l’imagination. Et bien sûr, les journaux de bord, une des premières formes de littérature maritime, ont amplifié le phénomène par leurs récits de luttes contre les éléments en furie.
Herman Melville a comparé le passage du cap Horn à la descente aux enfers dans la Divine Comédie de Dante. Cela veut tout dire.

Votre récit pourrait être un mélange d’Edgar Poe avec les Aventures d’Arthur Gordon Pym, de Daniel Defoe avec Robinson Crusoë, de Stevenson et de Patrick O’Brian avec la série Aubrey-Maturin. Sont-ce des influences que vous pourriez revendiquer ?
Oui, certainement. Dans ma documentation, j’ai bien sûr inclus Melville, O’Brian, Robinson Crusoë. J’ai toujours éprouvé une certaine attirance pour les récits de voyages en mer. Je n’ai pas lu les œuvres complètes de Patrick O’Brian mais une grande partie, tout comme les nouvelles et romans de Joseph Conrad quand j’étais petit, comme Lord Jim. Mon imagination a donc très tôt été nourrie de ces récits.
Lorsque je travaille sur des récits comme les Naufragés du Wager, je me rends compte, et c’est cela qui est intéressant, à quel point les histoires peuvent s’influencer les unes les autres et dans quelle mesure une histoire vraie peut devenir un mythe. Mais aussi comment la fiction peut avoir un impact sur la réalité.
Le Wager en est une parfaite illustration : l’événement en lui-même a inspiré Melville et O’Brian et des éléments marquants comme le cap Horn ou le cannibalisme, qui ont été mythifiés, ont traumatisé des générations entières de marins, ainsi que le grand public en général. Et inversement, les marins du Wager ont, au moment de traverser le cap Horn, pensé à l’île de Robinson Crusoë (qui se trouve dans l’archipel Juan Fernandez), comme on peut le lire dans les récits des survivants. Cet endroit qu’ils imaginent est issu d’une œuvre de fiction, elle-même inspirée d’une histoire vraie qu’on a pu lire dans le journal de bord d’un vrai marin qui avait été abandonné. Réalité et fiction s’interpénètrent et façonnent la perception que nous avons des choses.
L’action après le naufrage se déroule en grande partie à l’extrémité sud de la Patagonie. De grands auteurs comme Bruce Chatwin avec En Patagonie et le français Jean Raspail ont écrit sur la Patagonie. Vous, qui vous êtes rendu sur l’île Wager, pensez-vous que cette partie du monde a su préserver son côté sauvage, mystérieux et inhospitalier ? Que cela représente-t-il pour vous ?
Ma réponse sera assez limitée car je ne suis allé que sur l’île Wager, qui était mon seul objectif. Or, la Patagonie est une région très vaste. Je suppose que cette île est certainement représentative de la nature sauvage patagone, mais elle est isolée, inhabitée et très inhospitalière. Elle est restée à notre époque un lieu désolé : les arbres sont tous courbés à 45°, il n’y a pas de réserves de nourriture et on peut même y trouver des vestiges du campement. On peut dire, malheureusement, qu’elle est encore plus désertique qu’à l’époque du naufrage. En effet, il y a trois cents ans, des Indiens Kawésqars et Chonos se rendaient sur cette île pour pêcher. Ils ont même assisté les naufragés dans leur malheur. Mais depuis, ils ont été décimés et plus personne ne vient pêcher dans les environs.
Pour revenir à Jean Raspail, il a consacré un ouvrage aux Indiens Alakalufs (ou Kawésqars), les protagonistes de Qui se souvient des hommes et qui apparaissent dans votre ouvrage. John Byron fait lui aussi une apparition. Raspail montre avec nostalgie que le contact avec l’homme blanc, l’européen, a sonné le glas des Indiens et signale la fin de l’innocence et de toute illusion. Peut-on dire que le contact entre les Kawésqars et Byron et ses compagnons, s’il a été bénéfique pour ces derniers, a été l’un des premiers clous plantés dans le cercueil des Indiens ?
C’est une très bonne question. Oui, à certains égards, on pourrait l’affirmer. Ainsi, après le départ des naufragés, certains colons espagnols se sont rendus dans la région pour essayer de récupérer ce qui pouvait l’être de l’épave du Wager. Cette expédition et les suivantes ont été la cause directe de la dissémination de maladies et de la disparition consécutive de nombreux peuples indigènes. Il est vrai que le naufrage du Wager et le premier contact avec les Indiens ont mené in fine ces derniers à leur perte, même si personne ne pouvait le deviner à ce moment-là.
Ce qui mérite d’attirer notre attention dans cette rencontre sur l’île entre les Kawésqars et les naufragés, c’est que ces derniers sont les fiers produits d’une vaste structure impériale façonnée par la conviction, inculquée dès le plus jeune âge, que leur civilisation est supérieure aux autres, comme je l’ai déjà dit. Cela ne les a pas empêchés de sombrer dans la barbarie. Soudain, les Kawésqars émergent de la brume et leur offrent une bouée de sauvetage car ils savent, eux, comment survivre dans cette région hostile. Ils s’y sont adaptés au fil du temps et savent se chauffer ou trouver de la nourriture, qu’ils fournissent aux naufragés. Mais les sempiternels conflits entre ces derniers les font finalement fuir, ce qui accélère le processus de désintégration de la petite société des survivants et les précipite dans un état de dépravation encore plus bas et plus obscène.
C’est là que réside tout le paradoxe de la situation. Le naufrage a mis symboliquement en évidence que l’empire britannique n’était pas forcément supérieur aux autres.
Comment expliquer l’intérêt que vous portent les cinéastes, en particulier Martin Scorsese qui a adapté Killers of the Flower Moon et qui va faire de même avec cet ouvrage ?
On me pose souvent cette question et je ne connais toujours pas la réponse car je ne fais pas partie du milieu du cinéma et je ne raisonne jamais en termes d’adaptations au cinéma. Je ne me dis pas : Tiens, le livre que je projette d’écrire pourrait-il faire un bon film ?
J’ai passé de nombreuses années à déterrer toutes ces histoires et à les restituer sous formes de mots (et non de caméra) pour créer des images. Cela ne m’aurait d’ailleurs jamais traversé l’esprit d’adapter les Naufragés du Wager. Il faut être une personne hors du commun pour penser réaliser un film à partir du journal de bord de Byron.
Je dirais plutôt que mon principal mérite est de reconnaître dans telle ou telle histoire ce qu’elle peut dire de notre époque, de voir quelle peut être sa résonance de nos jours et comment elle étend ses ramifications au plus profond de la nature humaine. Elle éclaire la condition humaine même. Je prends pour exemple la Note américaine ; cette histoire montre ce qui arrive quand la civilisation s’effondre, quand l’avidité et le racisme forment une alliance funeste, avec pour toile de fond la conquête de l’Ouest et le système d’iniquité et de complicité, passive ou active, qu’elle a généré.
Cela dit, même si je ne pense pas au cinéma, il va de soi que j’ai moi aussi, du fait de ma consommation personnelle, été façonné ou formaté par le septième art. Dans ce cas, peut-être ai-je une écriture « cinématographique » ou, du moins, qui se prête au cinéma. Mais cela ne me pose pas du tout de problème.
On imagine aussi Werner Herzog adapter the White Darkness, qui est en soi un titre herzogien (qu’on pense à White Diamond ou Lessons of Darkness – Leçons de ténèbres en français). Il a d’ailleurs réalisé un documentaire sur un sujet similaire à celui que vous traitez dans The White Darkness, et qui s’intitule Encounters at the end of the world.
Herzog est incroyable dans le sens où il sait mettre en scène des personnes dans des conditions extrêmes tout en réduisant cette expérience à ses éléments les plus fondamentaux, à savoir la vie, la mort, la morale et les décisions qu’il faut prendre pour survivre.
Nous avons cette recherche de l’élément fondamental de survie en commun et nous sommes tous deux attirés par la façon dont les illusions, les ambitions démesurées, les délires de l’Homme peuvent le mener à sa perte.
Ce serait un choix fantastique pour adapter The White Darkness. Le film est d’ailleurs en cours de développement chez Apple avec possiblement Tom Hiddleston dans le rôle principal. Mais à ma connaissance, ils n’ont pas encore de réalisateur. Donc qui sait…
Notes
(1) En 1741, en pleine guerre anglo-espagnole pour la maîtrise des mers, le vaisseau de ligne HMS Wager, commandé par le capitaine Cheap et comptant quelque deux cent cinquante membres d’équipage, fait naufrage au large de la Patagonie, après avoir tenté de franchir le dangereux cap Horn. Une centaine de survivants établissement un campement qu’ils croient provisoire sur une île inhospitalière et désertique, qui prendra plus tard le nom de Wager. Plus d’un an après le naufrage, un petit groupe d’une trentaine de rescapés accostèrent en Angleterre après s’être échappés de l’île en radeau et avoir fait une halte au Brésil. En avril 1745, trois autres survivants refirent leur apparition en Angleterre et accusèrent le premier groupe d’avoir fomenté une mutinerie et, de fait, d’être des traîtres au roi et à la patrie.

VERSION AMERICAINE
David Grann :
“The Wager shipwreck is a timeless story”
David Grann, author of Killers of the Flower Moon, adapted for the screen by Martin Scorsese, shows with his usual brio and innate sense of storytelling and adventure how British gentlemen were reduced to the most bestial barbarity, even to the point of cannibalism. The Wager is a masterly work of breathless suspense, the result of extensive and varied documentary research, and reads like an adventure novel à la Stevenson or Edgar Poe. What really happened on the island? That is the question Zone Critique seeks to answer in an interview with David Grann.
The wreck of the Wager (1) is a little-known historical episode. How did you learn about it, and why did you become interested in it? This book is different from your previous works, since it is the first time you have dealt with a subject set in the 18th century.
While doing some research on mutinies online, I came upon an 18th-century diary written by a certain John Byron, ensign of the Wager, who was later to become the grandfather of the poet Lord Byron. When I fisrt strated reading it, I was intrigued because it was written in Old English (with F-shaped S’s, for example), in this slightly stilted, archaic prose. I read on, with long descriptions of mutinies, famine, scurvy, shipwrecks and cannibalism. By the time I finished it, I realized that this little odd booklet really held the clues to one of the more extraordinary sagas of survival and mayhem that I’d ever come across. But that was just the first seed.
I went on to deepen and extend my research, fascinated not only by the story of the castaways’ survival on the inhospitable island of Wager [the place in southern Patagonia where the ship Wager was wrecked and which gave the island its name], but also by the adventures that followed their departure from the island until their eventful return to England, where, summoned before a court martial, they risked death by hanging for crimes they had allegedly committed on the island.
It was while consulting these archives that I realized that this was more a struggle for truth than a tale of survival. Each of the shipwrecked crew gave their own version of events, in the hope of exonerating themselves and saving their lives; fake logbooks, in which everything was invented and sided with one camp or another (that of the mutineers or that of the Wager captain’s followers), were even fabricated to take advantage of the scandal and make easy money.
After my day’s work, I would come back home and, while reading the newspaper or watching the news on TV, I would be hearing these fierce debates over socalled fake news and disinformation. Three hundred years later, nothing had changed.
This affair raises many questions: who has the right to tell history? Which version should prevail, and why? To what extent can it change the course of events? How would trhe empire choose to spin the story? This brings us back to our own current debates: how should History be taught, and through which books?
It was at this point that I realized that, even if I hadn’t intended to write about the 18th century beforehand, and even if I knew nothing about daily life on a British ship at the time, this story was timeless because it was nothing less than a study of the human condition, of human nature.
The little society of castaways on the island that I describe is a society that breaks down, decomposes, disintegrates and collapses. It’s a parable of our very turbulent times.
That is why I decided to do it.
What makes this episode so special is its resonance with topical issues such as fake news, misinformation and editorial warfare, on the one hand, and the much-debated legacy of colonization, on the other. You address this issue, notably through the character of John Duck, a castaway who was enslaved.
Absolutely. John Duck is a really important figure in the story. He was a freed black seaman who managed to survive everything (scurvy, shipwreck, tidal waves, starvation…)
Then he managed to survive one of these incredibly long castaway voyages.
But unlike the other survivors who make it back to England, he couldn’t tell the story. Why not? Because he was kidnapped near Buenos Aires and sold in slavery. We then lost track of him completely. He is one of those stories that have been ripped out of the history books, a victim of our self-imposed silences and tragic mistakes. His story fundamentally reflects those fragments of our past that we deliberately leave out.
And so, even though I could not tell John Duck’s story in detail, because there’s no record to tell it, I thought his silence speaks volumes. And in some ways, that is also a connection to this to my previous book, Killers of the Flower Moon, on the relationship with history, although the subjects treated are different.
The Wager is not a history book, but a narrative. It is not, however, a non-fiction novel à la Truman Capote, as the extensive notes prove. Was turning a logbook into a gripping narrative that reads like a novel, with heroes, villains, twists and turns and suspense, the trickiest part?
Yes, that is the hardest part because the texts are old and often fragmentary, and you have to find the material you need to develop a story. You have to immerse yourself completely in a world that is foreign to you, get to know the people who live there, who are very different from your contemporaries, and make the whole universe familiar.
But there’s one element that doesn’t change and that allows you to make the link between your time and this one: it is human nature, which remains the same. You can change costumes, accents, geography… but you still recognize common character traits, and to a certain extent this is what overcomes the obstacle of the lack of sources. It is also what makes the story so interesting. Each of the characters has their own ambition, their own quest for glory, their own class reflexes. And this is still the case today.
And then, at a certain point, you begin to ask yourself what you would have done on that island, what kind of person you would have been. In extreme situations like these, human nature is laid bare, and we see who these people really are.
That is why you feel a certain empathy for your characters, John Byron in particular, who is, one might say, the “hero” of the book. You seem to forgive him for taking part in the first mutiny, something he immediately regrets, which leads him to leave the mutineers and return to Captain Cheap.
The truth is fragmented into several points of view. It was therefore necessary to know which way to take it, and in fact, it became essential to find a structure that would fit into the story, and deepen its themes.
That is why I decided to write the story from the three competing perspectives of Captain Cheap, mutineer John Bulkeley and loyalist John Byron. I’ve done my best to tell the story as they would have wished it to be told, through their eyes. The important thing is not to exculpate or even justify them, but simply to understand them. None of them is purely good or purely evil; they’re just like any of us, with their strengths and weaknesses.
When you write about these characters, you can feel sympathy for them and even admire their bravery, and the next moment, you change your mind. It’s all a question of perspective. Take Captain Cheap, for example: you see him, as he gradually loses all authority over his men, disintegrating internally, you feel empathy, a certain pity, until he commits that unjust crime on the island, and then suddenly you shift perspective to Byron’s side, who, although a loyalist, then wonders whether he should continue to support the captain when he’s just shot one of his comrades in the head. What’s interesting for me is that Byron evolves and changes his point of view on his comrades in misfortune and on events, as the story progresses.
It’s through each of them that you get closer to the truth, each with his own justifications, his own reasoning, and it’s by combining these different twists of the same reality, as if they were reflections in a distorting mirror, that you arrive at the truth.
Your work is that of an investigator. How do you draw the line between a journalist’s investigation and a historian’s research?
I do not think in terms of structures, of compartments. It is funny, people often ask me: what exactly are you? A journalist? A historian? I cannot say. I started my career as a journalist. So I was drawn to current affairs, or at least I thought I was. But generally speaking, there is far too much emphasis on novelty, on breaking news, on immediacy.
As the sinking of the Wager took place almost three centuries ago, why should it be any less exciting than recent news? So I went back in time and started telling stories that I felt revealed the strange enigma that is human nature and the world we live in. It really freed me from the dictatorship of immediacy.
My work has been called literary non-fiction. But what I want to do is tell stories. I’ve been a bad journalist because I have always wanted to tell them the way they unfolded, from beginning to end. But my editors, even if they thought my articles were very good, preferred to start at the end so that the reader would know from the start what the story was about. No matter how much I bristled, asking what the reader’s interest would be in reading on, there was nothing I could do.
So I preferred to follow my own path and tell the story as I saw fit, letting myself be guided by events as they unfolded, while remaining faithful to the facts. This is the major challenge, the riddle I like to take up. You could almost call it the literature of facts.
If we recall the context, it’s a British maritime expedition of six ships and two merchant vessels, led by Commodore Anson, as part of the War of Jenkins’ Ear, launched for spurious reasons, as you show, when the real goal was domination of the seas, militarily and above all economically. Can you outline the main points of this conflict between England and Spain, which turned out to be an almost total fiasco?
This war took place between 1739 and 1748, against a backdrop of rivalry between the British and Spanish empires, during the very destructive age of colonialism and imperialism. Great Britain wanted to break Spain’s hold over much of Latin America in order to open up a trade route to Asia, and to do so, aimed to monopolize the continent’s natural resources and exert its stranglehold on American trade.
This conflict became known as the War of Jenkins’ Ear, after an incident in which the captain of a Spanish ship, after boarding a British merchant ship in its waters commanded by a man named Robert Jenkins, allegedly cut off his ear as punishment.
This incident was seized upon by the English, primarily by those in favor of British expansionism, who began to trumpet in a propaganda in newspapers, books and works of fiction. However, the name was a misnomer, as it turned out that the incident had taken place many years before the official declaration of war and had nothing to do with the real reasons for the conflict. It was merely a pretext for an imperial war.
The sinking of the Wager came at a bad time for the British Admiralty, whose main concern was to preserve its image and reputation, especially as the expedition was so poorly prepared. As a result, the mutiny was completely hushed up, and the trial that took place and is described in your book did not even touch on it. What a paradox!
This is very revealing, as one of the main arguments the British Empire put forward to justify its ruthless expansion and desire for conquest was the claim that its civilization was somehow superior to that of others.
However, after the grounding and arrival on the island, the British officers and crew, who were the so-called vanguard of the Empire, descended into a nightmare and bestial state worthy of Lord of the Flies, with factions at war with each other, mutinies, murders and even cannibalism. Once the survivors returned to England, the British authorities listened in horror to their tales. This return to the most primitive state of nature and the attitude of the sailors, who had behaved less like gentlemen than like brutes, threatened the very image of the Empire and undermined the supposed superiority of British civilization.
The authorities therefore decided to cover up the mutiny, which became known as the “mutiny that never was”. A first example of the Streisand effect.
Mutinies are a highly threatening form of rebellion for the State, as they disrupt an entire military apparatus designed to impose order. If this apparatus suddenly disorders, it attacks the very foundations of the state and represents a mortal danger. This is why mutinies are usually quashed, brutally suppressed and their perpetrators hanged. But sometimes, as in this case, they are so threatening to the State that the latter simply prefers to erase them from collective memory.
We saw this very recently in Russia with the Prigozhin rebellion. The same imperial madness can be seen in Russia’s desire to invade Ukraine, followed by an uprising of the Russian regime’s henchmen. But the regime was quick to dismiss the mutiny as a threat to its bases. This is another case of a “mutiny that never was”.
You have done an impressive amount of documentation work, especially since you did not have any specific knowledge of the subject. What were the main challenges you faced? Learning a specific vocabulary, understanding the way warships were maneuvered…?
Indeed, it took me about a year to feel fluid in this new world and to learn the language of this sailing civilization. Every part of the ship has its own name, and the role of each sailor is well defined, so I couldn’t transcribe the final catastrophe without first describing this world and understanding what it really was. That is why I wanted to explain what it looked like, and it took me a long time to get comfortable with the terminology.
I was lucky enough to be able to consult a large number of documents that still exist today, despite shipwrecks, storms and the like. I was able to read the muster books, which are practically enlistment records [sailors were often recruited against their will]. Indeed, when a person became a crew member, his or her name was entered in this register, along with the date and rank. Very often, next to these indications were strange symbols: DD. I had no idea what they meant. At first, I did not pay much attention to them, but after seeing so many, I became interested.. Historians then explained to me that it stood for “discharged dead”. And I realized: Oh my God, these are the epitaphs of sailors who died on missions! I counted these DDs, which enabled me to catalog and assess the tragic toll of the expedition. In the end, these seemingly insignificant little documents were crucial! For this, I am very grateful to the historians I consulted, who tutored me up and patiently filled in my ignorance of the subject.
Your account highlights the harsh living conditions faced by sailors at the time, with malnutrition, scurvy, storms that destroyed the squadron and naval battles, especially as sailors were largely recruited against their will. Could it be said that going on expeditions meant almost certain death?
A voyage of this nature and duration, in those days, inevitably meant a high mortality rate. That is why the navy always had trouble recruiting personnel: people either shunned recruiters or deserted, because they all knew that they risked almost certain death. This expedition in particular, which was one calamity after another, was incredibly fatal: out of a total of almost 2,000 sailors on all the ships, 1,300 died.
In the end, the most astonishing thing was not to die, but to survive.
There is another character in your story, perhaps the main antagonist: Cape Horn. As you describe it, it’s a mysterious and dangerous place. It has also been a source of inspiration for the abundant literature written about it. How do you explain its appeal to the collective imagination, to the point of becoming a myth?
Human beings seem often to be hardwired to attempt to master the natural elements in order to survive and conquer the world, sometimes brutally. Cape Horn has always been a place where human beings face up to seemingly invincible elements. I think that is why, in the collective imagination, this little passage at the other end of the Earth, at least the other end of South America, where the Pacific and Atlantic oceans meet, is so evocative. It is also worth bearing in mind that, at the time, there was no other way of getting to Oceania and Asia, at least by sea. This intimidating place, where waves can topple a ninety feet-long boat, where currents are the strongest on the planet and winds are capable of blowing at over 200 mph, could only stimulate the imagination. And of course, logbooks, one of the earliest forms of maritime literature, amplified the phenomenon with their tales of struggles against the raging elements.
Herman Melville compared the passage around Cape Horn to the descent into hell in Dante’s Divine Comedy. That says it all.
Your story could be a blend of Edgar Poe’s The Adventures of Arthur Gordon Pym, Daniel Defoe’s Robinson Crusoe, Stevenson and Patrick O’Brian’s The Aubrey-Maturin series. Are these influences you could claim as your own?
Yes, they certainly are. In my documentation, I have of course included Melville, O’Brian and Robinson Crusoe. I’ve always felt a certain attraction to tales of sea travel. I haven’t read the complete works of Patrick O’Brian, but I’ve read a lot of them, as well as Joseph Conrad’s short stories and novels when I was a kid, like Lord Jim. So stories of the sea always kind of stirred my imagination.
When I work on stories like the Wager, I realize – and this is what’s interesting – how stories can influence each other and how a true story can become a myth. But also how fiction can have an impact on reality.
The Wager is a perfect illustration of this: the event itself inspired Melville and O’Brian, and key elements such as Cape Horn and cannibalism, which were mythologized, traumatized entire generations of sailors, as well as the general public. And conversely, the sailors of the Wager thought of Robinson Crusoe’s island (in the Juan Fernandez archipelago) when they rounded Cape Horn, as can be read in the survivors’ accounts. The place they imagined was based on a work of fiction, itself inspired by a true story told in the logbook of a real sailor who had been abandoned. Reality and fiction interpenetrate and shape our perception of things.
Much of the action after the shipwreck takes place at the southern tip of Patagonia. Great authors such as Bruce Chatwin with In Patagonia and the Frenchman Jean Raspail have written about Patagonia. As someone who has visited Wager Island, do you think this part of the world has managed to preserve its wild, mysterious and inhospitable side? What does it mean to you?
My answer will be rather limited, as I only visited Wager Island, which was my sole objective. Patagonia is a very vast area. I suppose this island is certainly indicative of some of the Patagonian wilderness, but it is isolated, uninhabited and very inhospitable. In our time, it has remained a desolate place: the trees are all bent at 45°, there are no food supplies and you can even find remnants of the encampment. Sadly and tragically, it is even more barren than it was at the time of the shipwreck. Three hundred years ago, Kawesqars and Chonos Indians used to visit the island to fish. They even assisted the shipwrecked crew in their misfortune. But since then, they’ve been decimated, and no one comes here to fish anymore.
Coming back to Jean Raspail, he dedicated a book to the Alacaluf (or Kawesqar) Indians, the protagonists of Who will remember the people who appear in your book. John Byron also makes an appearance. Raspail nostalgically shows that contact with the white man, the European, sounded the death knell for the Indians, signaling the end of innocence and all illusion. Can we say that contact between the Kawesqars and Byron and his companions, while beneficial for the latter, was one of the first nails in the Indians’ coffin?
That’s a very good question. Yes, in some respects, one could say so. After the castaways had left, some Spanish colonists went to the area to try to excavate what might have been on that ship. This and subsequent expeditions were the direct cause of the spread of disease and the subsequent disappearance of many indigenous peoples. It’s true that the sinking of the Wager and the first contact with the Indians ultimately led to their demise, even if no one could have guessed it at the time.
What’s particularly noteworthy about this encounter on the island between the Kawésqars and the castaways is that the latter are the proud products of a vast imperial structure shaped by the conviction, inculcated from an early age, that their civilization is somehow superior to all others, as I’ve already said. But that didn’t stop them from sinking into barbarism. Suddenly, the Kawesqars emerge out of the mist and offer them a lifeline, because they know how to survive in this hostile region. They have adapted over time and know how to keep warm or find food, which they supply to the shipwrecked. But the never-ending conflicts between the latter finally drive them away, accelerating the process of disintegration of the survivors’ small society and precipitating them into an even lower and more obscene state of depravity.
Therein lies the paradox of the situation. The shipwreck symbolically highlighted the fact that the British Empire was not necessarily superior to other civilizations.
How do you explain the interest shown in your work by filmmakers, especially Martin Scorsese, who adapted Killers of the Flower Moon and will be doing the same with this book?
I am often asked this question and I still don’t know the answer, because I’m not part of the film world and I never think in terms of film adaptations. I don’t say to myself: Could the book I’m planning to write make a good film?
I have spent many years excavating these stories and rendering them in the form of words (not cameras) to create images. In fact, it would never have crossed my mind to adapt The Wager. It takes an extraordinary person to think of making a film from Byron’s logbook.
I would rather say that my main merit lies in recognizing in this or that story what it can say about our times, how it might resonate today, and how it extends its ramifications to the very depths of human nature. It sheds light on the human condition itself. Taking Killers of the Flower Moon as an example, this story shows what happens when civilization collapses, when greed and racism come together, against the backdrop of the conquest of the West and the system of iniquity and complicity, passive or active, that it generated. That said, even if I do not think about cinema, it goes without saying that I too, through my personal consumption, have been shaped or formatted by the seventh art. In that case, perhaps my writing is “cinematographic”, or at least lends itself to the cinema. But that’s not a problem for me at all.
We can also imagine Werner Herzog adapting The White Darkness, which is in itself a Herzogian title (let us think about The White Diamond or Lessons of Darkness). In fact, he made a documentary on a subject similar to the one you deal with in The White Darkness, entitled Encounters at the end of the world.
Herzog is incredible in the sense that he knows how to place people in extreme conditions, while reducing the experience to its most fundamental elements: life, death, morality and the decisions you have to make to survive. We have this search for the fundamental element of survival in common, and we are both drawn to the way in which man’s illusions, inordinate ambitions and delusions can lead him to his downfall and self destruction. It would be a fantastic choice to adapt The White Darkness. The film is in the process of being developed by Apple, possibly with Tom Hiddleston in the lead role. But as far as I know, they don’t have a director yet. So who knows…
(1) In 1741, in the midst of the Anglo-Spanish war for control of the seas, the HMS Wager, captained by Captain Cheap and crewed by some two hundred and fifty men, sank off the coast of Patagonia after attempting to round the dangerous Cape Horn. A hundred or so survivors set up what they believed to be a temporary camp on an inhospitable desert island, later to be known as Wager. More than a year after the shipwreck, a small group of some thirty survivors landed in England, having escaped from the island by raft and stopped off in Brazil. In April 1745, three more survivors reappeared in England, accusing the first group of fomenting mutiny and, indeed, of being traitors to king and country.
- David Grann, Les naufragés du Wager, Editions du sous-sol, 2023
Entretien mené et traduit par Guillaume Narguet
Crédit photo : David Grann, l’auteur du roman Les naufragés du Wager (© Michael Lionstar)