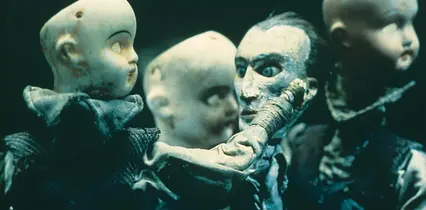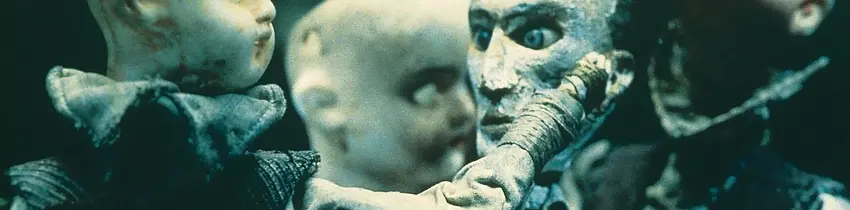Quatorze ans après son premier long-métrage, Ordinary People, qui racontait les massacres de Srebrenica à travers les yeux d’un soldat, Vladimir Perišić revient pour narrer une Serbie qui le hante. Film intime, Lost Country mêle intrigue politique et dilemme familial dans une pellicule vintage.

Entre deux rives
Vladimir Perišić prend grand soin à montrer, dans les marges des plans, des éléments du réel que son personnage principal ne veut, ou ne peut, pas voir.
Les ponts brûlent. Stefan doit choisir. Si son entourage amical s’accommodait jusqu’ici de sa proximité avec le parti de Milošević, ce n’est plus le cas. Tant que sa ligne politique ne sera pas clarifiée — autant dire, tant qu’il n’aura pas désavoué sa mère —, Stefan subira un isolement progressif. En classe, au water-polo, mais également lors des sorties en famille, le regard des autres change, passant de l’amitié au mépris, de l’indifférence à la haine. Sourdement, VladimirPerišić fait sentir l’étau de plomb qui enserre Marklena (prénom issu de la contraction de Marx et Lénine) et son fils. Leur logement prend bientôt des airs de citadelle assiégée. Murmures, insultes et confrontations ne semblent que les faire se retrancher dans leur appartement, subtilement plus chic que les autres. Mais la politique ne s’arrête plus à la porte de la maison ; elle s’immisce dans l’intimité familiale, jusqu’alors sanctuaire, et l’air s’emplit de dissonances. Si Lost Country ne se démarque pas par sa maîtrise des personnages secondaires, esquisses assez oubliables et programmatiques, il excelle au contraire dans le portrait de cette relation mère fils. Leurs scènes éclipsent le reste du film. Mère indépendante, femme aux idées assumées, Marklena est une énigme, oscillant entre tendresse et froideur extrêmes. En face, ni le spectateur ni Stefan, entre adoration et méfiance, ne parviennent vraiment à la déchiffrer ou à s’en détacher. Que sait-elle ? Manipule-t-elle ou est-elle manipulée ? Ment-elle ? Est-ce par lâcheté, conviction ou par ignorance ? Il devient impossible de détacher ces questionnements du visage de Marklena, tant elles se reflètent dans le regard de Stefan.
Ouvrir l’œil
Si la caméra suit l’adolescent dans son impasse, elle le devance pourtant dans ses réalisations en percevant le monde plus nettement que lui. Vladimir Perišić prend grand soin à montrer, dans les marges des plans, des éléments du réel que son personnage principal ne veut, ou ne peut, pas voir. Affiches réclamant la démission de Milošević ou poster de Land and Freedom de Ken Loach accroché chez son ami sont autant d’indices invisibles pour Stefan que d’éléments cruciaux pour nous. C’est par ce travail discret que l’isolement de Stefan se fait évident, à l’image de son silence appuyé lors du vacarme festif d’une manifestation. Un court instant, la caméra quitte l’adolescent pour la liesse et la colère de la foule ; elle rejoint l’histoire, choisit presque son camp — mais, ne pouvant pleinement se détacher du garçon, elle pivote à droite et le retrouve. Nous revenons au status quo. Poings et visage fermés, Stefan est hermétique à l’atmosphère, incapable d’être porté par l’enthousiasme général. Le plan se coupe ici, l’errance filmique s’arrête ; nous voilà revenus entre les deux rives.
Lost Country s’étend sur cette aporie politique et personnelle ; si la répétition est inévitable, elle ne lasse pas pour autant. On se laisse charmer par la photographie, et, au détour d’un beau plan, on réfléchit au pays qu’évoque le titre : ambigu, il est à la fois Yougoslavie et Serbie. Une Yougoslavie qui apparaît ici et là en teintes nostalgiques, sorte de fantôme encore chaud, et une Serbie indécise qui ne sait où se diriger ni comment y parvenir ensemble. Dépeignant un pays et un jeune homme perdu et perdant ses illusions, le film a un goût de fin de cycle, qui se clôt sur les notes d’une Internationale désaccordée.
Lost Country, un film de Vladimir Perišić, avec Jovan Ginic, Jasna Djuricic, en salles le 11 octobre.