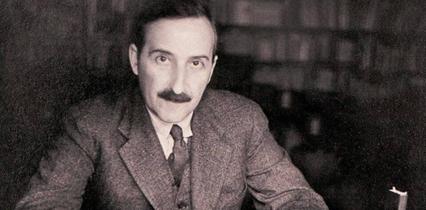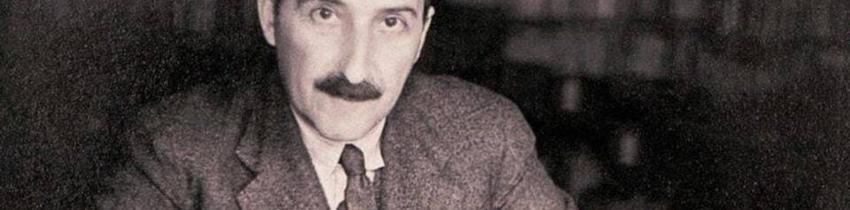Vivre avec les hommes est, à mon sens, un ouvrage essentiel. Manon Garcia y analyse le procès Pélicot à travers un prisme journalistique, sociologique, philosophique et psychologique, offrant une réflexion saisissante sur notre monde, ses déviances, ses limites et, surtout, ses vérités. Ce texte dissèque la mise en scène de la justice, interroge la place du spectateur face à l’horreur et questionne notre responsabilité collective : comment vivre après ça ? Pour cette raison, ce livre doit impérativement trouver une place de choix dans nos bibliothèques et au seuil de nos regards.
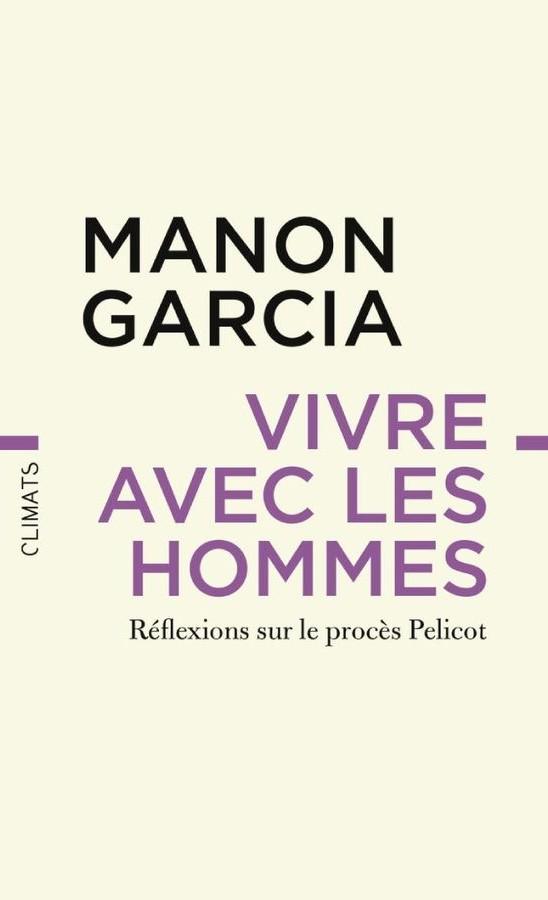
Les procès sont effectivement des miroirs de leur époque. Celui des viols de Mazan, qui structure l’ouvrage, expose intelligemment les tensions entre justice et violence sexuelle, entre droit et culture patriarcale, entre parole des victimes et stratégies d’évitement. Garcia nous confronte ainsi à une interrogation fondamentale : comment juger, dans un monde où la violence des hommes sur les femmes est ordinaire, voire structurante ?
Pour répondre à ces nombreux questionnements, le texte adopte une structure hybride, mêlant compte-rendu du procès des viols de Mazan, réflexions théoriques et observations personnelles. Le récit suit le déroulement des audiences, retranscrivant les plaidoiries, les témoignages et les stratégies judiciaires tout en interrogeant les mécanismes sociaux et juridiques qui façonnent la perception du viol. L’écriture alterne donc entre l’analyse des faits, l’étude du langage judiciaire et les effets de cette immersion sur l’autrice elle-même. À chaque étape du texte, Manon Garcia s’appuie sur des références en philosophie, sociologie et droit pour replacer ce procès dans une histoire des violences sexuelles et de leur traitement institutionnel.
Comment juger, dans un monde où la violence des hommes sur les femmes est ordinaire, voire structurante ?
Le tribunal comme scène de la domination masculine
Le procès est structuré par un rapport de forces qui traverse la société tout entière et qui appelle la conscience de toute la communauté, rivée alors sur les accusés. « Le droit pénal s’exerce au nom de la société, pas au nom des victimes. » nous rappelle une vérité fondamentale : le viol est jugé comme une perturbation de l’ordre public plus que comme une atteinte à l’intégrité des victimes. L’intérêt de la société passerait donc avant la reconnaissance du tort individuel et des vies bouleversées. L’organisation même du procès traduit ce déséquilibre. L’autrice analyse comment la correctionnalisation des viols permet de minimiser la gravité des faits : « On comprend bien que cette correctionnalisation ait pu être interprétée par nombre de magistrats comme une façon de pallier les faiblesses du système pénal, mais cela a un impact négatif fort sur la reconnaissance du tort fait à la victime, et cela permet à l’idée que violer n’est pas si grave, de perdurer. »
Cette stratégie, contribue à une culture judiciaire dans laquelle le viol est considéré comme un délit parmi d’autres, expédié au nom de l’efficacité. La justice choisit donc l’économie du temps plutôt que la reconnaissance du crime. Cette hiérarchisation des violences s’inscrit dans ce que la philosophe Carole Pateman nomme le contrat sexuel : un pacte implicite où l’accès des hommes au corps des femmes est naturalisé, ce qui explique la réticence, contemporaine et historique, à punir pleinement le viol.
L’accès des hommes au corps des femmes est naturalisé, ce qui explique la réticence, contemporaine et historique, à punir pleinement le viol.
La bataille du langage : neutraliser l’horreur
Le procès est un lieu de lutte sémantique car les accusés et leurs avocats tentent de redéfinir la violence pour en atténuer la portée. « Un violeur, ça ne caresse pas ! » Cette exclamation met en évidence l’euphémisation du crime. Dans la salle d’audience, on parle de “contacts”, de “gestes déplacés”, de “relations non désirées” : la justice produit une langue qui efface l’agression sous des termes neutres. L’autrice cite ici Catherine Le Magueresse, juriste spécialiste des violences sexuelles, qui montre que le droit français repose sur une « présomption de consentement », forçant les victimes à prouver qu’elles n’étaient pas consentantes plutôt que d’exiger des accusés qu’ils démontrent qu’elles l’étaient. Le contraste est frappant avec le vocabulaire de la violence. Les vidéos saisies dans le procès et retranscrites pour ce dernier ne laissent aucun doute sur la conscience qu’avaient les accusés de leurs actes : « Première vidéo ‘Fond de son cul’ 11 secondes, Romain V. lui maintient le sein droit. »
La crudité des titres et des commentaires des agresseurs contraste avec la langue juridique qui force les victimes à la restitution, étant alors contraintes de rendre compte de leur non-consentement.
La masculinité, un système organisé autour du viol
Le viol s’inscrit dans une dynamique sociale imbriquée par la violence sexuelle qui fait office de réelle épreuve de virilité. Dominique Pelicot organise la mise en scène des viols de son épouse, transforme le crime en spectacle, pousse d’autres hommes à y participer : « ‘Bah alors, les mecs, on bande pas ?’ Il se fait chef d’orchestre de ces hommes qui ‘violent’ son épouse, qui s’exécutent. » L’acte sexuel est ici un rituel masculin, un test entre pairs, un outil de pouvoir. À ce sujet, la sociologue Nicola Gavey décrit cela comme l’échafaudage culturel du viol : un système de normes et de discours qui rendent le viol pensable, légitime, parfois même valorisé. De même, Peggy Sanday, dans ses travaux sur les viols collectifs, a montré que ces ...