
Dramaturge et poète, Paloma Hermine Hidalgo écrit des pièces et des recueils baroques et transgressifs, qui explorent le rapport à l’enfance, à la figure maternelle et à la sexualité. Elle a notamment publié Rien, le ciel peut-être aux éditions Sans Escale (2023) et Cristina aux éditions le Réalgar (2020, réédition en 2023). Ses poèmes narratifs creusent et font chanter la langue. Une écriture sulfureuse et envoûtante, qui résonne comme un cri.
Zone Critique : Dans une langue enflammée et chancelante, vous dessinez de curieux paysages mentaux qui prennent la forme de courts poèmes en prose aussi ciselés que violents. Pourquoi écrivez-vous ? Par nécessité ?
Paloma Hermine Hidalgo : Oui, par nécessité. En ce qui me concerne, la vraie question dans l’écriture est celle de la nécessité. Je pense à une citation impitoyable de Georges Bataille, que m’a récemment glissée à l’oreille un ami : « Comment nous attarder à des livres auxquels, sensiblement, l’auteur n’a pas été contraint ? » Pourrai-je toute une vie tenir cette exigence ?

La question de la nécessité est posée dans Cristina et Rien, le ciel peut-être, qui sont des traversées de la violence et de l’enfer. Pour habiter ce monde, j’ai dû m’en bricoler un autre. Manière d’habiter cette souffrance hors-sens, à laquelle cet autre hors-sens qu’est l’écriture fait pièce – dans la perversion et la discordance. Au regard de cette souffrance, je crois que le lecteur a une responsabilité : celle de m’accueillir, en tant qu’auteur, pour me permettre de vivre.
Z.-C. : Donc il y a un but cathartique dans l’écriture, voire thérapeutique ?
P.H.H : Il y a pour moi un phénomène cathartique dans l’écriture. Mais celle-ci peut aussi rendre totalement fou, aggraver les choses. On rentre ici dans le domaine du psycho-pathologique. Pour ma part, l’écriture me plonge dans des états de sensibilité extrême – et en même temps, comment écrire sans cela ? J’essaie de porter une armure au quotidien, mais quand j’écris, je reste vulnérable, fragile, pour que la faille, la fêlure adviennent.
Z.-C. : Écrivez-vous depuis toujours ? Qu’en est-il de votre rapport à l’écriture : écrivez-vous d’abord pour vous, de façon intime et personnelle ?
P.H.H : Si je n’écris pas depuis toujours, j’ai toujours été travaillée par l’obsession de la langue, de l’acribie. Petite, j’apprenais des pages de dictionnaire par cœur. L’écriture personnelle (poésie, fiction), non pas l’écriture critique, que je pratique depuis que j’ai dix-sept, dix-huit ans de manière professionnelle, est arrivée bien plus tard, à la faveur d’un douloureux internement en psychiatrie, objet, transposé à l’adolescence, de mon premier roman Matériau Maman (à paraître en janvier 2024 aux Éditions de Corlevour).
Z.-C. : Vous parlez des mots rares, et il est vrai qu’un des traits saillants de votre écriture est justement cette présence de mots rares, de mots choisis « Androcée » / « Tarlatane » / « Taveler » / « Camphrier ». Il y a notamment des domaines qui reviennent, au premier rang desquels celui des plantes. Pourquoi ce choix des mots rares ? Pour la sonorité ou la précision ?
P.H.H. : S’impose l’évidence des rythmes, des couleurs, des arômes – le miroitement d’images prodigieux comme paroxysmes d’expériences sensitives. Lorsque j’écris, je suis parcourue de sommations, dont je ne sais si elles tiennent du « trouble psychotique jugulé » (!) ou de la synesthésie multiple. J’écris le terme « parlote », et, oh !, la couleur framboise s’impose, puis, là il me faut un parfum de muscade, puis une note de tango, puis, une rupture grivoise, ou, tiens, un air des « Vêpres de la Vierge ». De « mini éclats psychotiques » sous crâne ; térébrante jubilation de forer, comme je peux, dans la grâce et le labeur, la langue et la duplicité du sentir.
L’écriture des individus psychotiques, du reste, est marquée par la précision ! Elle l’est également par la préciosité, ce dont, je crois, ne relève pas ma langue. Et Dieu sait pourtant à quel point les Précieuses me captivent, qui vivifièrent notre français… Le grand poète, écrivain et critique Alain Borer, dans sa préface de mon premier livre Cristina, écrit magnifiquement : « Paloma Hermine Hidalgo « fixe des vertiges » (comme dit Rimbaud dans l’Alchimie du verbe). La Préciosité esquive, la précision fore. La Préciosité est un salon, l’acribie (l’art de la précision) est un royaume. »
Surtout, je ne crois pas manier une « belle langue », une langue classique ; la mienne se situe plutôt du côté du baroque, un baroque étrange, à rebours des modes actuelles (et passées) : une langue semée de néologismes et d’inversions sémantiques.
Je retravaille mes textes, j’élimine des choses. J’atteins ce que je nomme le « moelleux sec » : soit imposer une forme de sécheresse, par exemple grâce aux phrases nominales. Mais il n’y a pas de démarche préalable consciente chez moi qui me permettrait de répondre à la question : quel effet cherches-tu à obtenir ? C’est simplement comme ça que ça explose dans ma tête, quand je vois ces couleurs, ces sons, ce rythme syncopé ! Je crée par images violentes ; j’aurais pu être peintre ou metteure en scène !
Z.-C. : L’accumulation de phrases nominales tend à créer à la fois un paysage sensoriel mais reproduit également peut-être la sidération, notamment dans les récits de scène de viol : « Citrons, cédrats, oranges, mandarines. Je brosse, pèle, tranche l’écorce en lamelles. La chair mitonne à feu doux, entrelardée de jaune. Il s’approche. Langue gourmande. Yeux de fakir. Carnaval d’odeurs : essence, fraîchin, lait suri. Il déboutonne le gilet, fait glisser le pull, ôte du même coup le tee-shirt. Dix ans. L’âge exquis. Mes paupières rosissent, mes entrailles s’ouvrent. Maman, Maman. » Cette manière d’écrire a-t-elle pour vocation de transcrire la violence irréelle de la situation ? En somme, s’agit-il de poétiser l’horreur ou est-ce pour vous la seule manière d’exprimer ce crime ?
P.H.H : Là encore, je n’ai guère de volonté, de « stratégie » préalable lorsque j’écris. Peut-être cette « scansion syncopée » est-elle liée à mon propre rapport au corps, au souffle coupé, celui de l’actrice pris dans l’hiatus du poème, ou comme dans la « construction de l’orgasme » par la respiration ; voire au souffle du soufisme.
Je traverse l’horreur comme un jeu. Le frottement des extrêmes fait, malgré moi, chanter la langue.
Toujours est-il : je me débarrasse de quelque chose dans l’Art de la joie (titre somptueux de Goliarda Sapienza) : d’une certaine manière, cette noirceur équivoque, je l’évacue, tout en y plongeant les deux mains. C’est tout à la fois jubilatoire et insoutenable. Les scènes de violence, de viol sont parfois chantées avec la tendresse d’une lallation… Je traverse l’horreur comme un jeu. Le frottement des extrêmes fait, malgré moi, chanter la langue.
Ce qui est contradictoire me passionne. Or, certains lecteurs confondent l’auteur et le personnage ; on m’a, par exemple, reproché des mots que je place dans la bouche du pédophile ou dans la tête de l’enfant s’interrogeant, dans sa candeur, sur son plaisir mêlé d’horreur. Mes personnages, plus largement, peuvent éprouver une chose intensément et, tout à la fois, avec la même d’intensité, ressentir son contraire.
Z.-C. : Est-ce que la volonté initiale dans l’écriture est de choquer ? Ou est-ce qu’a posteriori, vos textes se trouvent être choquants ?
P.H.H. : Il n’y a pas de volonté de choquer. J’écris, c’est une nécessité. On a souvent renvoyé mon écriture à celles de Georges Bataille ou de Jean Genet, et moi je n’avais alors jamais lu les romans de Genet ! Une scène clef du Miracle de la rose chez Genet, dans laquelle Harcamone se fait cracher dessus et imagine que ces crachats sont des roses, rejoint cette question de la transgression et entremêle la question de la beauté et de la violence. On trouve chez Genet une inversion des valeurs, une inversion de l’éthique. Le remarquable poète et écrivain Dominique Sampiero dans sa lumineuse préface de Rien, le ciel peut-être dit que je « met[s] en mouvement une éthique inversée »…
Z.-C. : Dans ce que vous écrivez, l’univers moral est tout de même conservé ! Il n’y a nulle part d’apologie de la transgression. Il y a une forme de naïveté, de candeur de la part de l’enfant, or toutes les scènes sont perçues du point de vue de l’enfant. L’enfant lui se trouve dans un univers fait de sucreries, de lait, de miel, univers dans lequel survient un viol. L’enfant met cela sur le même plan, ne dissocie pas le mal du bien, tout en sentant confusément des choses.
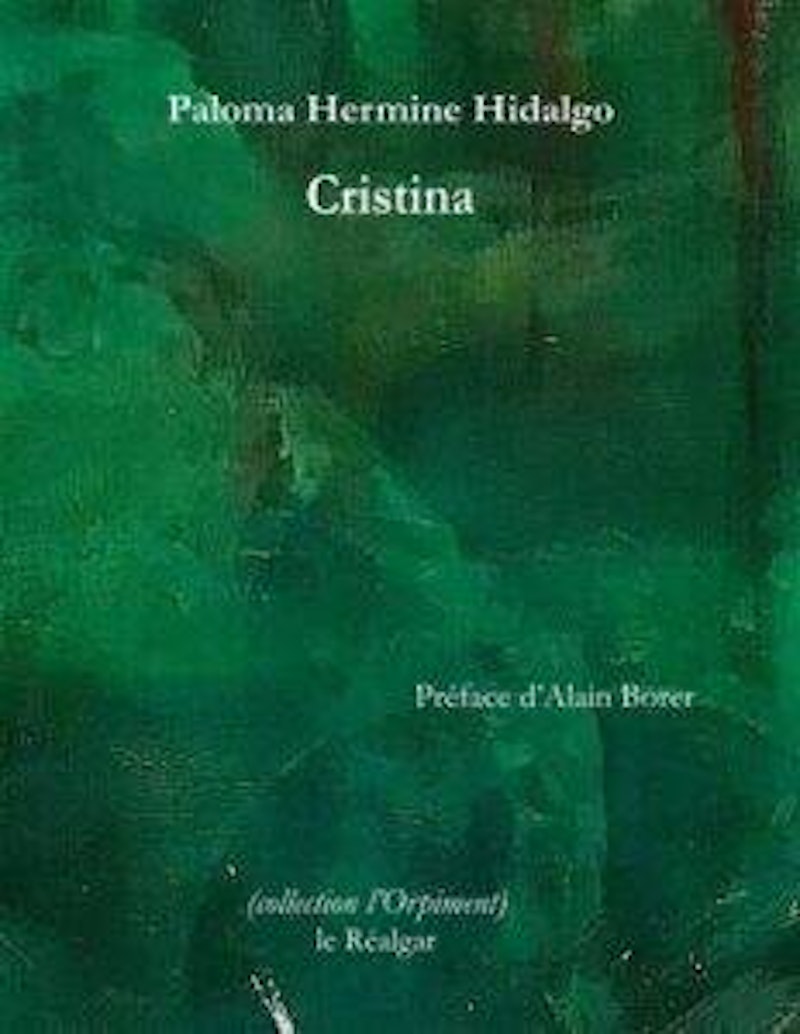
Z.-C. : On touche donc à la question du mélange des genres. Vous égrenez le nom de plantes et de sucreries avant d’introduire des images d’une violence extrême. Cette dialectique de l’enfance et de la violence, de la douceur et de la brutalité s’incarnent dans une langue à la fois ornée et vulgaire. On lit dans Rien, le ciel peut-être : « Puterelle, tu ne sais avec quel feu sur le tremble, le babil de ta glaise ouvre à nos grâces la mort. » Pourquoi ce mélange des tonalités ?
P.H.H. : C’est très joli comme petite insulte « puterelle » : le terme désigne une jeune pute. En Champagne, il renvoie aussi à une plante, la mercuriale annuelle.
Le pourquoi… je ne peux y répondre ; l’écriture, c’est ce qui m’échappe. Là encore, nulle stratégie de ma part. Mais disons que « texte», renvoie au textile, au tissage, tisserand, qui évoque le fait de mêler les langues. Ce mélange des langues me chavire. J’invoque la violence créatrice dans son idiotie, qui, très largement, renvoie à tout ce qui est singulier et vient rompre le tranquille ronronnement de l’idéal esthétique.
Z.-C. : Est-ce que vous verriez une opposition entre littérature et morale ? La littérature doit-elle ou non s’occuper de morale ?
P.H.H. : Il me semble que la littérature a pour charge d’exprimer le domaine du phantasme et le phantasme, c’est de l’indicible, de l’innommable ; la littérature est injustifiable, elle tient parfois à quelque chose de criminel. Il me semble aussi que toute tentative d’expression ne peut exister qu’en s’affirmant dans sa terrible équivoque, voire son ambiguïté, en se jouant des réductions normalisatrices. Dans le despotisme de ce qui peut être parfois injustifiable. Dans une liberté absolument irréductible, indissociable de l’exercice de la pensée. J’écris sans message, sans dogme, et porte une grande violence en moi, encadrée par l’esthétique.
La littérature est injustifiable, elle tient parfois à quelque chose de criminel.
Je crois également que les visages de Cristina, tous brassés, transfigurés par une manière d’architecture inconsciente, ont l’allure d’un rêve. Et qu’il y eut dans mon enfance (toute enfance ?) la découverte d’une vérité jamais oubliée, seulement occultée : celle de la sujétion de la vie à la mort, la promesse faite par l’enfant de vivre pour savoir mourir, soit, dans ce texte, le mouvement de l’écriture. Peut-être ai-je, avec mes humbles moyens, et sans bien sûr le conscientiser alors, cherché à surmonter l’être moral pour rencontrer l’être pécheur ; à approcher quelque connaissance désengagée du monde, qui ne soit ni angélique, ni démoniaque. La figuration du « mal » rejoindrait alors celle du bien, en serait l’imposture, non pas l’ignorance. Le mal, oui, ou l’intelligence sans tendresse, la parole sans charité, aussi bien, sans qu’il s’agisse pour moi d’occulter sa dimension intensément sensuelle, érotique.
Z.-C. : Votre titre Rien, le ciel peut-être est particulièrement marquant. En vous lisant, on a l’impression que vos textes sont écrits à la lumière des vitraux. Une place prépondérante est accordée à la couleur et on trouve souvent dans vos poèmes la présence discrète d’une forme de transcendance : « Et tu pries. Mais rien, sous la caresse : ciel muet, pas même un chuchotis, comme on coule à l’oreille un mot tendre ; rien, le ciel peut-être ailleurs sonate – aphone, là, sphère de nues grises, deuil anthracite. » Quelle place accordez-vous à Dieu dans votre œuvre ?
P.H.H. : La question de la transcendance est prégnante dans mes textes. Je n’ai moi-même pas reçu d’éducation religieuse, mais ai, dès l’enfance, lu beaucoup de littérature médiévale et classique, volée au CDI, puis de philosophie et d’écrits mystiques desquels je tire des rudiments épars de théologie. Ces domaines me passionnent au plus haut point.
Dans Rien, le cielpeut-être, la ténèbre est liée à « une joie bandée vers le haut », au milieu des flèches sébastiennes (ou des rayons de Sainte-Thérèse) de « magnifier, donner, se refuser, sacrifier, offrir ». Cela me renvoie au cher Angelus Silesius, comme à des pages de Klossowski… La voix qui intime ses ordres, ses visions, et jusqu’à ses expériences, est la même qui laisse surgir la profusion du sensible.
Z.-C. : En somme, est-ce que l’on vit dans un monde sans Dieu dans lequel il y aurait des signes discrets qui pointeraient vers une forme de transcendance ?
P.H.H. : « Je suis née trop tard dans un siècle sans Dieu », dit la protagoniste de mon roman à paraître Matériau Maman. Il y a aussi cette phrase : « Dieu s’appelle Maman ». Dieu peut être aussi un dieu complètement panthéiste, ça peut être Maman qui s’incarne en Jupiter, en Zeus, pour violer sa fille qu’elle transformera, comme dans les Métamorphoses d’Ovide, en génisse ou en plante.
Dieu peut être aussi un dieu complètement panthéiste, ça peut être Maman qui s’incarne en Jupiter, en Zeus, pour violer sa fille
Mon rapport à Dieu est très confus. Il y a une voix dans ce texte Rien, le ciel peut-être qui intime ces ordres, il y a quelque chose de l’oraison, de la sommation, comme magnifié et déséquilibré par l’autorité qui est là, au-delà ou en-deçà de tout vouloir et manipulation. « C’est chérir que je veux, et non être giflée » : intimer, à la fois donner sa source à ce qui ne connaît pas d’extérieur, et commander entre déclaration et déchirement.
Quant aux vitraux, ils me ramènent aux contes de fées qui nourrissent mon écriture. Je peux vous lire un extrait du recueil inédit Souillon, mentionnant un vitrail : « Bouche immense, parmi les miroirs ciselés dans le camphrier de Bornéo, sous un linteau de chêne, des poupées s’irisent aux chimères du vitrail. Griffons, ours-coqs, basiliques à crânes d’or. Oh ! Ton sourire las ! Ton sourire de lèvres blanches. « Viens, viens, Souillon, pétrir un peu ». Je lorgne l’argile et le tour, rêve de ciseler dans l’or la geste de Peau d’Âne, et n’assouplis sous mon pouce idiot qu’un serpent ocellé de cœurs. L’aimes-tu ? L’aimes-tu, Baba ? Et tandis que je malaxe, ton visage s’irise aux éclats du vitrail. Ta peau d’ananas, tes tatouages de bagnard, ta ferronnière qui dut être celle d’une reine. M’aveugle, par le vitrail brisé, la profusion lumineuse d’un élan de colombes. Faire mienne cette grâce, telle qu’elle vit et fulgure dans le cœur des souillons. »
Z.-C. : Vous parlez de personnages, de votre rapport au théâtre, qui n’apparaît cependant pas de façon évidente !
P.H.H. : Il y a dans mes textes une adresse, une voix, qui n’est pas exclusivement liée au théâtre. Certains voient dans mes adresses de la musique, des opéras, une scansion musicale, ou une forme de poésie incantatoire.
Z.-C. : En parlant de vision, vos textes donnent à voir des paysages luxuriants où le pampre à la rose s’allie, très loin des décors urbains. Il y a parfois des images paradisiaques, mais la question de l’enfer ne semble jamais très loin. Ces descriptions s’incarnent-elles dans un lieu ou sont-elles le fruit de votre imaginaire ?
P.H.H. : Ni l’un ni l’autre : ces descriptions n’existent ni dans la réalité ni dans l’imaginaire, ni même dans ma tête. Elles n’existent que dans l’écriture. C’est l’écriture elle-même qui les fait advenir.
Z.-C. : C’est votre rapport à la nature qui m’interroge, votre rapport à la nature en tant qu’espace, à la fois préservé des hommes, mais en même temps où les hommes agressent, agissent.
P.H.H. : Nulle Gaïa mythifiée ! J’aime au contraire l’idée que ce monde puisse être contaminé. Pour moi, c’est une nature contaminée, souillée dès le départ. Ce n’est pas un Eden, une Arcadie.
Z.-C. : Dans ce recueil, il y a des descriptions successives et omniprésentes de paysages, tantôt maritimes tantôt champêtres. Est-ce lié à votre enfance passée dans le Berry ?
P.H.H. : Absolument. J’ai un peu bourlingué en Floride, en Touraine et sur la côte basque. Il y a forcément une part d’imprégnation géographique.
Z.-C. : Votre œuvre tend à lier violence et sexualité. Ce lien se construit dans Cristina à travers les récits de scène de viol mais se prolonge également dans Rien, le ciel peut-être : « À mes reins sans défense, fais cingler l’épine. Affûte, doucette ! Il me faut plus que la caresse : je veux de toi jouir à pleine ronce, plus avant, m’attendrir, au gré de tes sévices, prendre à larmes d’épines le plaisir humide. » Selon vous, la sexualité est irrémédiablement liée à la souffrance ? Peut-on imaginer une sexualité plus apaisée ?
P.H.H. : Je ne vois pas tellement de souffrance dans le passage que vous évoquez ! C’est un petit jeu lesbien, joyeusement et fôlatrement SM, avec la badine, la schlague. Moi, j’envisage ce passage sous le prisme de la joie et du jeu.
La sexualité n’est pour moi pas du tout irrémédiablement liée à la souffrance.
Dans mon écriture, prévaut peut-être une sexualité par-delà le sexe.
J’ai, par exemple, un roman en cours, picaresque et merveilleux, mêlant réalisme et onirisme, dans l’Europe cosmopolite du XXIe siècle, où marins-fantômes, ogres et fées se satisfont gaiement. J’écris aussi dans le même temps un texte hybride, Pupa, je crois, d’une sexualité débridée, ludique, mettant en scène des marionnettes lesbiennes dans un castelet / backroom d’acajou / Polypocket®. Toutes s’imposent comme de jolies petites Golems, affrontées à leur suprême créatrice : Maman. Au menu : saphisme et plaisirs agalmatophiles !
Plus largement, dans mon écriture, prévaut peut-être une sexualité par-delà le sexe. Avec Rien, le ciel peut-être, le panthéisme et le rapport étrange à la mystique permettent d’explorer une supra-sexualité avec les plantes, les tissus, les notes de musique… La concordance en un espace d’écriture d’impensés sexuels maintient tout au long les tensions du désir à la hauteur d’un « ciel sans objet ».
Z.-C. : Dans l’absolu, la sexualité est-elle un lieu blessé, délicat, qui peut être conflictuel aussi ? Ce qui est paradoxal, ou du moins étonnant, c’est que dans Cristina, il y a des scènes de viol qui sont caractérisées en tant que viol, mais dans Rien, le ciel peut-être, il n’y a pas de scènes de viol, mais il y a des scènes incestueuses, justement parfois SM. Dans ce cas-là, il y a une différence non pas de nature, mais de degré, mais pour autant, la modalité d’expression de ces scènes-là se ressemble. C’est pour ces raisons que l’on peut s’interroger sur ce lien entre peut-être non pas sexualité et violence mais sexualité et blessure, sexualité et conflictualité ?
P.H.H. : Il y a beaucoup de choses qui relèvent du jeu, du ludisme, par-delà la souffrance, en tous cas dans Rien, le ciel peut-être. Il y a plus une dimension tragique dans Cristina. Comme je le mentionnais plus tôt, il peut y avoir une jouissance paradoxale, une jouissance tragique. En tous cas il y a toujours du jeu, dans tous les sens du terme. Le sexe est un domaine obsessionnel dans mon écriture, c’est quelque chose qui revient de façon inlassable : c’est une obsession d’écrivain. J’en ai d’autres, comme le rapport à la mère.
Z.-C. : Justement, le rapport à la mère occupe une place primordiale dans vos textes. Figure à double visage dans Cristina, tantôt bienveillante, tantôt inquiétante, elle devient plus dominatrice et sexuelle dans Rien, le ciel peut-être. Dans les deux récits, sa disparition est suggérée. Qu’incarne cette mère ? Cette figure tutélaire a-t-elle une place symbolique, autobiographique ?
P.H.H. : Oui. Impérieuse en tout point. Cristina, Rien, le ciel peut-être, La Reine cousue, Pupa, etc. témoignent de cette obsession. Jusqu’au livre Matériau Maman, roman d’inspiration autobiographique et conte initiatique d’une violence plus latente que mes autres textes, et qui évoque l’histoire d’une enfant, Nieve, manifestant des troubles psychiques à la disparition de sa mère. Maman ? Je l’ai perdue à onze ans, violemment, et depuis, me hante ce mot de Doña Prouhèze, se déchaussant, plaçant son soulier de satin entre les mains de la Vierge : « Gardez-le contre votre cœur, ô grande Maman effrayante ! » (Le Soulier de Satin, Paul Claudel).
Le sexe est un domaine obsessionnel dans mon écriture, c’est quelque chose qui revient de façon inlassable
Je songe aussi à La Reine cousue, texte que j’ai récemment écrit, dont un extrait fut cette année publié dans la revue Frictions (n° 36, hiver 2022-23) : mon ambition, tout à l’écho de mon histoire personnelle, est d’y déconstruire l’idée de passion mère-fille en la raccordant aux vérités du corps, à la honte et aux secrets des désirs incompatibles. Enfant traumatisée par sa mère qui lui interdit toute jouissance, le personnage, devenue jeune femme, revit sans cesse ce traumatisme, qu’elle déplace sur la figure d’Elisabeth I, reine d’Angleterre, dont le portrait figure dans la chambre maternelle. Tel est le point de départ qu’il s’agissait de dépasser : je voulais explorer le désir de cette jeune femme et l’impossibilité, du fait de sa mère castratrice, de l’expression de ce dernier, avec, en parallèle, l’impossibilité d’un père – comme si le père n’existait pas. Dès lors, ce qui s’imposait, c’était l’image monstrueuse et freudienne d’une mère horrible, archétype grotesque et fabuleux – équilibré toutefois par l’ambivalence du personnage dont la tendresse et l’amour ponctuent aussi le texte à la façon d’un leitmotiv (Hainamoration, disait Jacques Lacan). Il s’agit là d’une mère qui se dérobe, qu’on ne peut aimer totalement. Il me fallait toutefois prendre mes distances avec ces clichés et archétypes de la psychanalyse : c’est ainsi que l’humour, bouffon, clownesque, noir, graveleux ou enfantin, s’est imposé.
Z.-C. : Pour terminer, auriez-vous un texte à recommander à nos lecteurs ?
P.H.H. : Partant de l’idée d’ignorance, de candeur, face à l’énigme du langage et de l’écriture, j’aimerais la relier aux sublimes écrits de Heinrich von Kleist (1777-1811), en particulier son récit Sur le théâtre de marionnettes (1810), dans dont voici deux extraits : « En outre, ces poupées ont l’avantage d’échapper à la gravité. Elles ne connaissent rien de l’inertie de la matière, de toutes les propriétés celle qui est la plus contraire à la danse : la force qui les soulève dans les airs est plus grande que celle qui les attache au sol. » Et : « C’est une fois que la connaissance a, pour ainsi dire, parcouru un infini qu’on retrouve la grâce ; de sorte qu’elle apparaît au même moment de la manière la plus pure dans la constitution d’une silhouette humaine dont la conscience et inexistante ou bien infinie, c’est-à-dire dans le pantin articulé ou le Dieu. »
Bibliographie sélective
- Rien, le ciel peut-être, lauréat de la Bourse Gina Chenouard de la Société des Gens de Lettres 2021, Éditions Sans Escale, 2023, préface de Dominique Sampiero. Finaliste du prix Apollinaire Découverte 2023.
- Cristina, Éditions Le Réalgar, 2020, paru sous l’hétéronyme de Caloniz Herminia. Sélectionné pour le Prix SGDL Révélation de Poésie 2020 et finaliste du Prix Mac Orlan 2021. Réédition en 2023, préface d’Alain Borer, sous le nom de Paloma Hermine Hidalgo.
- Matériau Maman, premier roman lauréat du Centre National du Livre en 2021, à paraître aux Éditions de Corlevour en janvier 2024.
Propos recueillis par Pierre Poligone et retranscrits par Marine Devin
Crédit photo : Paloma Hermine Hidalgo (c) Bona Ung

















