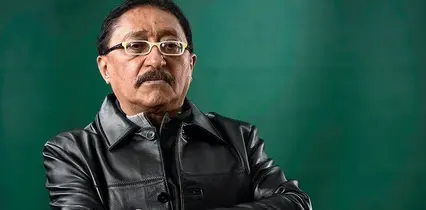Nietzsche disait des Grecs qu’ils étaient « superficiels par profondeur ». L’expression, dans un tout autre sens, semble parfaitement convenir aux Japonais. Dans Comme la lune au milieu de l’eau, sous-titré Art et spiritualité au Japon, Yoko Orimo examine les concepts connus de la culture japonaise en les éclairant d’une érudition simple et rigoureuse, dégageant les malentendus, introduisant le lecteur à goûter, paisiblement, les couleurs et les odeurs d’un pays qui excelle dans l’art délicat de la suggestion et du reflet.
« L’art japonais de l’époque Muromachi ne fut pas influencé par le zen, mais c’est le zen qui devint art »
Katô Shûichi
Au Japon, tout est relation. Voilà en substance l’idée que déploie Yoko Orimo dans ce livre fleuri de poèmes, de références ancestrales et d’images immuables. Notamment connue pour avoir traduit et interprété le Shôbôgenzô de maître Dôgen, disponible en huit tomes aux éditions Sully, Orimo nous livre ici un livre aérien et simple, au titre énigmatique, loin de la complexité des traductions précédentes. On retrouve cependant le sujet central et déjà largement défraîchi dans ses commentaires habituels : le lien inébranlable entre la nature et la spiritualité japonaise. Passant de la lumière embuée aux défilements des saisons, des waka de Shunzei, de Ryôkan ou de Kino Tomonori aux haiku du célèbre Bashô, l’ouvrage est un véritable petit traité de sensibilité nippone.
Passant de la lumière embuée aux défilements des saisons, des waka de Shunzei, de Ryôkan ou de Kino Tomonori aux haiku du célèbre Bashô, l’ouvrage est un véritable petit traité de sensibilité nippone.
« Dans ce beau pays heureux, la nature et le surnaturel ne font qu’un ». Voilà les mots de Paul Claudel, ambassadeur de France au Japon entre 1921 et 1927, que cite Yoko Orimo pour introduire son livre. Esthétique de l’éphémère et de la résonance, la nature prend ici une place centrale. Semblant hors du temps, sa beauté demeure le seul résidu de permanence dans un monde changeant. Étant dégagée des affres des chronologies réduites et des spatialisations arbitraires, la nature se fait métaphore de l’espace intérieur de l’homme. A cette nature communément admise correspond toujours la Nature de l’Éveil spirituel, car les plantes, l’éclat de la lune ou les mousses au pied des cèdres actualisent leur propre réalité. La nature, s’attestant elle-même, met en mouvement le Dharma, la Loi, répliquant son éveil. Quête des tréfonds intimes, l’art japonais contient en puissance les leçons exprimées dans le zen, il révèle la Nature voilée, cette « enceinte du secret ». Commentant Reiun Shikin, Yoko Orimo note que « la Nature ne révèle son véritable visage qu’à l’homme purifié de corps et de cœur par de longues années de pratique du dépouillement et de l’oubli de soi. La Nature n’est pas au point de départ comme chose gratuitement donnée, mais elle doit être « gagnée » comme point d’arrivée ». Si le temps prend une si grande place dans l’esthétique japonaise, c’est parce qu’il s’éprouve plutôt que ne se comprend. Il existe au Japon un proverbe bien connu, « karada de oboeru », apprendre avec le corps, qui souligne un temps autre que celui de l’intellect, un temps qui exprime le déroulement des êtres, témoignant d’une présence qui, par son fait d’être-là, exprime son altération.

La religion au Japon est à la fois « partout et nulle part ». La séparation nette entre profane et sacré s’efface, tout peut potentiellement devenir une « Voie » de la réalisation spirituelle. La religion est comme « dissoute » dans la culture. Son triomphe est invisible, sa gloire jamais circonscrite. Il est donc normal qu’elle prenne son plein droit dans le domaine artistique. Un point parfaitement synthétisé par Orimo touche à ce syncrétisme mystérieux entre l’autochtonie du shintô et le bouddhisme sinisé. L’auteur rappelle comment le shintô a incliné la perspective du bouddhisme vers une exaltation plus explicite de la vie, conduisant à affiner la compréhension de l’impermanence des phénomènes. La trace de la religion nationale n’est pas anecdotique puisque, dans le shintô, tout ce qui est beau correspond à la droiture éthique. Les kami, dont la manifestation ne saurait se concevoir sans la beauté de la nature, vont survivre en infusant le bouddhisme, devenant des expressions de l’Éveillé (doctrine de honji-suijaku). Orimo cite le théâtre nô de Zeami pour affermir son propos : le Beau n’est jamais entendu en soi mais relève d’un mouvement circonstanciel, « c’est une esthétique fondamentalement relationnelle, hors du dualisme de l’absolu et du relatif ». C’est pourquoi la beauté n’est jamais totale et définitive, mais toujours à parfaire. L’art japonais entend la beauté comme un processus ouvrant des mondes, suggérant des espaces, ne concluant jamais sur un résultat. Car, aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est de la sensation de manque que vient la plénitude, et le goût exercé pour l’inachevé conduit à l’ultime réjouissance. Ce tropisme pour l’évocation fragile des saisons qui passent, des sentiments qui se dilatent ou des gestes éphémères se retrouve dans le célèbre wabi-sabi qui nous est ici décrit en détail dans la Voie du thé. Évitant la fausse érudition sur un élément qui ne saurait faire l’objet d’un savoir livresque, Orimo restitue parfaitement cette nostalgie apaisée qui semble reposer dans le fond des cœurs japonais.
Le dernier chapitre, centré sur le lien entre l’art et la pratique du non-moi, semble essentiel pour comprendre l’ambiance spirituelle dans laquelle évoluent les habitant d’Ôyashima, ce pays mythologique des huit îles divines. Revenant sur le rôle de l’artiste en revisitant la figure du « voyant », Orimo insiste en convoquant tout autant Mozart que Rilke : « Dans l’Oeil de la personne éveillée, l’univers entier se reflète comme un tableau, et c’est ce tableau qui nous fait voir cette énergie vitale de l’univers, énergie invisible, indéfinissable en soi et insaisissable en soi, bien qu’elle remplisse tout l’univers ». Les amateurs de Tanizaki apprécieront les comparaisons régulières entre Orient et Occident ainsi que les remarques touchant au taux d’humidité atmosphérique du Japon, expliquant la lumière tamisée et voilée qui drape les milliers d’îles de l’archipel. Yoko Orimo confirme donc sa culture indéniable et son talent didactique qui ne coudoie jamais la simplification grossière. L’ouvrage ravira un public susceptible de s’intéresser à l’esthétique japonaise sans vouloir approfondir en détail les références exposées, préférant se laisser porter par l’explication abordable et l’envoûtement des nombreux poèmes. C’est une belle introduction pour entrer dans L’art japonais de Christine Shimizu, volume nettement plus académique et exhaustif. Nous regretterons cependant la courte préface de l’ouvrage, rédigée par Christian Bobin dans un phrasé verbeux et superflu, qui n’aura de vertu que d’attirer le grand public sur ce livre au toucher élégant et sensuel.
- Comme la lune au milieu de l’eau, Art et spiritualité du Japon, Yoko Orimo, préface de Christian Bobin, Editions Sully, 200 pages
- Musique : https://www.youtube.com/watch?v=zGBUcNyu22w