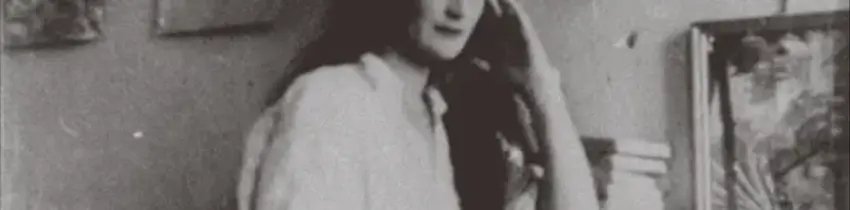C’est à grand fracas que le mauvais élève de la rentrée littéraire enfonce, le 9 janvier 2025, les portes de la littérature. Avec son nouveau roman, Philippe Vilain semble porter à son apogée ce que l’on nomme aujourd’hui « l’écriture de l’intime », qui domine le paysage littéraire français depuis plusieurs décennies déjà, avec un succès qui n’est plus à prouver. Nous en voulons pour preuve le Nobel obtenu par Annie Ernaux, elle-même maîtresse du genre, avec ses notoires Années, entre autres. Or, cette Annie Ernaux, Philippe Vilain la connaît sans doute mieux que nous tous… Et pour cause : il est Le Jeune homme, celui qui partagea la vie de son aînée de trente ans : coup de tonnerre pour le public et pour les médias.
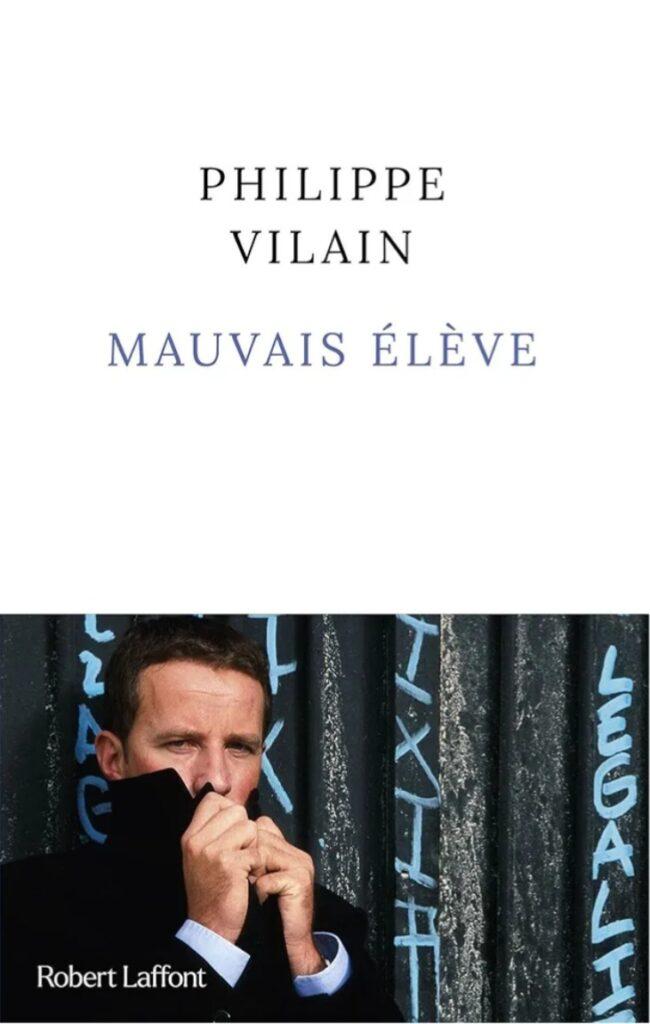
Dans Mauvais Elève, Philippe Vilain se livre comme rarement un auteur l’a fait ces derniers temps. De l’hommage poignant à ses origines ouvrières et aux pérégrinations âpres du transfuge de classe, en passant par l’accès à la notoriété, c’est un panorama époustouflant qu’offre ce roman rétrospectif qui n’hésite en rien à entrer dans ce qu’une existence peut contenir de plus intime et sensible. Un étalage de linge sale en public, un règlement de compte, un hommage et un éloge paradoxal à Annie Ernaux ; c’est ce que beaucoup de journalistes ont lu dans Mauvais Elève. Mais Zone Critique n’est pas dupe ; si la romance entre Philippe Vilain et l’autrice de La Place occupe la majeure partie de l’ouvrage, il serait éminemment réducteur de faire de ce roman la simple relation d’une passion inégale et à bien des égards dysfonctionnelle. En réalité, nous croyons plutôt que Mauvais Elève se fait le kaléidoscope compliqué et dense des jeux de société, terreau d’interrogations vertigineuses sur ce que peut la littérature pour les exploités, ce qu’elle doit et leur doit, sur la nécessité et le hasard des destins. Mauvais Elève est également, et c’est là le point nodal et passionnant de ce livre, le lieu de la question fatale que les Sorbonnards aussi bien que les cancres de fond de classe se posent : où est la vraie vie ?
“Mauvais Elève est également le lieu de la question fatale que les Sorbonnards aussi bien que les cancres de fond de classe se posent : où est la vraie vie ?”
Le transfuge et l’errance
« Transfuge » ; le mot est dans toutes les bouches. Maintenant, on n’a plus besoin de Bourdieu, on connaît, et, dirais-je même, on re-connaît enfin : il y a ceux qui naissent avec une cuillère en or dans la bouche, et ceux qui triment. Philippe Vilain a trimé. Ce n’est pas une plainte que pousse le mauvais élève, le rebut de l’école que tous et tout condamnaient à devenir dactylographe sans lui poser la question de ses désirs. C’est le cri de liberté d’un homme dont la vie a été ballottée entre violence physique, symbolique, et amour enflammé pour les en-allées qui retentit entre les pages d’un livre s’ouvrant avec audace sur une épigraphe de Sartre : « Chaque homme doit inventer son chemin. » Pour celui qui se déclare dans son ouvrage bourdieusien, cette référence est une gageure, et illustre peut-être même à elle seule toute la complexité indescriptible de ce que signifie être « transfuge de classe ». Car sauter d’une classe sociale à une autre ne revient pas à jouer aux dames, sans retour en arrière possible ; c’est jouer bien davantage à la marelle, aller et venir entre les milieux sans ne jamais savoir, du ciel ou de la terre, de quel élément on est ou (re)naît. Sujet, donc, particulièrement délicat à traiter, non pas tant pour ceux qui n’ont pas connu ce mouvement d’ascension paradoxal, mais surtout pour ceux qui l’ont expérimenté dans l’esprit et la chair. La manière dont Philippe Vilain rend hommage à sa mère et à son père dans son roman est sans doute un des éléments qui permet au mieux de toucher du doigt, si cela se peut, ce que signifie être arraché à ses origines, tout en y aillant laissé traîner de fines mais tenaces racines. L’auteur ne plaint pas ses parents, ni même ses camarades. Il les dit, et, les disant, les fait dire, et, les faisant dire, restitue sur le continent des lettres celles des dactylographes silencieux et des ouvriers muets, qui posent les pierres d’une société inique, où les gueules les plus ouvertes oublient que l’on ne parle pas la bouche pleine.
Mauvais Elève s’attaque, ainsi, à un sujet de taille et qui mérite tout l’intérêt du monde, pour la simple raison que la manière dont ce sujet est abordé l’est d’une manière originale. En effet, c’est un faisceau de questionnements, de propos parfois contradictoires – et c’est là toute la beauté du livre – qui s’organisent autour de la question de la pauvreté et de l’échappée hors d’elle. Parler la langue des opprimés et celle des dominants, ce n’est pas donné à tout le monde ; mais la confusion que cela suppose dans la construction de son identité personnelle est le prix de cette plasticité de félin qui rassemble tous ces déracinés, toutes ces histoires, souvent tues, d’errance entre tant de mondes auxquels on n’appartient pas. Car pour un arraché, pour un être qui comprend sans comprendre pourquoi lui et pas les autres, le mot « appartenir » ne veut proprement rien dire. Voilà ce qu’enseigne, avec grande douceur, humilité et délicatesse, la langue fluide de Philippe Vilain, délicate et hantée par le spectre d’une flamme incandescente.
“Parler la langue des opprimés et celle des dominants, ce n’est pas donné à tout le monde”
L’intime et l’authentique
Un mot peuple la bouche des critiques et des journalistes : « authentique ». Le récit de Philippe Vilain, de ses années initiatiques, marquées d’emballements et d’humiliations ravalées auprès d’Annie Ernaux est qualifié d’authentique, de vrai ; il ne s’agirait pas d’un règlement de compte mais d’un droit de réponse. Bien entendu, il ne fait aucun doute que c’est la seconde option qui caractérise la relation de cette passion bien étrange et floue, lorsque l’on croise les récits très différents des deux auteurs. Annie Ernaux aurait ainsi, romantisé une liaison avec un plus défavorisé qu’elle, se serait écrasée devant les normes bourgeoises du monde que la littérature lui a permis d’intégrer, tandis que Philippe Vilain serait resté au seuil de ce monde, sans que son amante ne lui laisse la possibilité d’y être ne serait-ce que respecté en tant qu’être humain. Nul doute qu’il y a du vrai dans ces aveux de l’écrivain ; il arrive bien souvent qu’une ancienne prolétaire, ou qu’un dominé sorti de sa condition oublie d’où il vient et reproduise les schémas qui l’ont elle-même ou lui-même fait souffrir dans l’enfance. A ce titre, nous n’avons pas pu nous empêcher de penser à l’admirable Parasite de Bong Joon-ho (2019), film dans lequel ces oppressions qui se jouent au sein de classes similaires ont été portées à l’écran d’une manière qui n’en finira sans doute jamais de nous marquer, et sous une esthétique qui fait date dans l’histoire du cinéma contemporain. La différence, cependant, réside dans le fait qu’Annie Ernaux et Philippe Vilain ne sont pas des transfuges au même « degré », ou, disons, pour ne pas céder aux hiérarchies qui, dans ce domaine, n’ont pas lieu d’être, de même parcours. Annie Ernaux a connu la vie paysanne et rurale, était enfant de commerçants, et a connu l’éducation austère des traditions des petits villages, tandis que Philippe Vilain est fils d’ouvriers, famille aux idéaux de gauche, et a été tout au long de son enfance et de son adolescence un cancre notoire, car ostracisé par ses camarades plus aisés. La situation initiale est donc radicalement différente, et « comparaison n’est pas raison ». La ruralité est un milieu méprisé, non pas de la même manière que le milieu ouvrier, mais il l’est ; de plus, il est particulièrement violent pour les filles et les femmes : et c’est cette condition de femme qui a fait de l’enfance et de l’adolescence d’Annie Ernaux un drame à titre essentiel. Dès lors, réduire ses problématiques sociales à de simples questions de « première de la classe », parler d’elle comme d’une déjà bourgeoise, semble curieux. Pourtant, on le comprend. Le fossé qui sépare ces deux conditions qui justifient chacune de parler, par la suite, de « transfuge », est peut-être incompréhensible, pour les deux auteurs. Il ne s’agit pas d’excuser les paroles humiliantes de l’écrivaine à l’égard de Philippe Vilain ; il s’agit simplement, nous y venons, de questionner les qualificatifs de « vrai » et « d’authentique » accolés sans recul au roman de ce dernier ; là où les mêmes mots étaient cédés aux écrits d’Ernaux. Faut-il en arriver à un procès digne de celui de Salomon et des deux mères se disputant l’authenticité de la maternité ?
L’écriture de l’intime n’est pas une écriture de l’authenticité. Mais est-ce grave ? Non. Et ce serait même plutôt joyeux et rassurant de redécouvrir, ce qui, dans le récit de l’intime, permet de le rendre réfractaire à la catégorie de l’authentique, tant cette dernière regorge de sous-entendus (discours vrai, adéquat au réel) avec lesquels l’intime ne cesse pas de jouer, de fuir, de trahir, de déserter. La seule littérature que l’on pourrait qualifier d’authentique, à la limite, serait celle de l’épanchement, c’est-à-dire celle des Confessions de Rousseau, qui consistent en des justifications, rectifications, redites perpétuelles : là, oui, par la manière dont l’auteur expose son histoire sans pudeur et sans agencement aucun de son histoire, le mot « authentique » semble justifié. Le récit de Philippe Vilain est rétrospectif et reconstitué, bien bâti, constellé de réflexions passionnantes sur les problèmes de la fatalité, de la liberté et de l’aliénation, de la trahison des siens, pour ne citer qu’eux. Mais il est illusoire de décerner un prix d’authenticité à une écriture qui n’a pas besoin de revendiquer ce terme pour être pourtant capable de dire l’intime : un intime. Il n’y a, derrière cette affirmation, aucun reproche, aucune critique : assumer que la mémoire est un puzzle dont la particularité tient à la métamorphose constante de ses pièces, ce n’est pas discréditer les auteurs qui se lancent dans les récits de leur vie. C’est assumer que l’intime est éminemment subjectif et singulier, et que ce que l’on peint est donné dans une orientation qui n’entache en rien la valeur de l’écriture.. Avec Mauvais Elève, il nous semble que le genre de « l’écriture de l’intime » atteint son zénith, et, peut-être, amorce son crépuscule, non pas dramatique, mais en tant que promesse d’une nouvelle aurore pour la littérature introspective en général.
Enfin pour répondre à l’interrogation lancée en amont de notre critique ; la vraie vie se trouve dans l’épreuve charnelle, vécue en corps à corps avec le réel, qui forge notre intimité, si belle et poignante, si singulière et capitale lorsqu’il en va de nos trajectoires ; c’est là ce qu’enseigne la lecture de cette admirable odyssée d’un destin qui ne croit pas tout à fait aux hasards, mais au mystère des nécessités contingentes.
- Mauvais élève, Philippe Vilain, Robert Laffont, 2025.