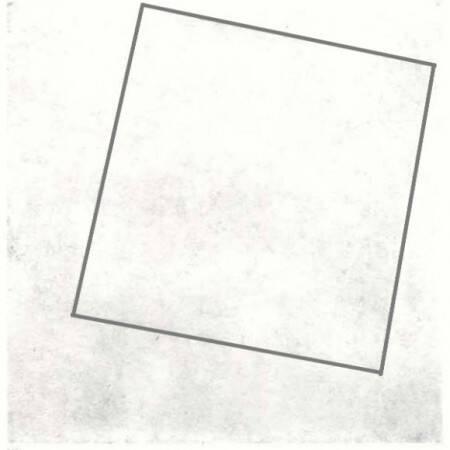À l’Autre rimbaldien, Jean-Philippe Pierron substitue le Nous dans son ouvrage Je est un nous publié aux éditions Actes Sud. Une rencontre avec un crocodile, le jeu parfois cruel d’un enfant avec des sangsues, une attention nouvelle à une montagne, ou une relation filiale avec les arbres d’un verger, son essai nous rapporte des conversions intimes et philosophiques. En traçant ce qu’il appelle des écobiographies, il nous fait part de moments de vie qui ont ébranlé les contours du sujet pour l’enrichir des liens avec ce que l’on tient d’ordinaire à distance en le nommant pudiquement « notre milieu ».
Reconnaître la force de nos liens
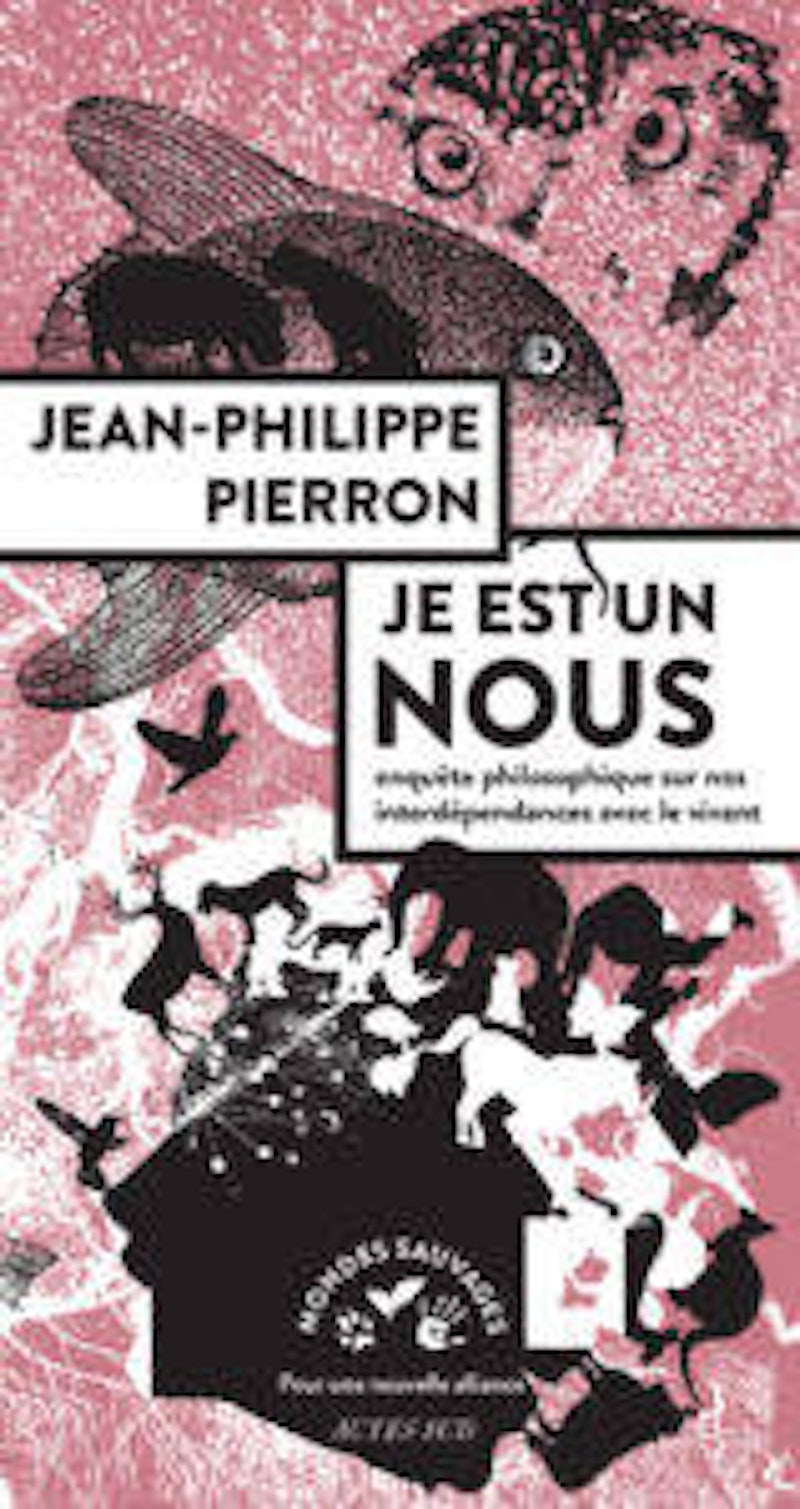
Planter un arbre devient une expérience cruciale d’inscription dans la temporalité élargie du vivant. Ce geste singulier cèle l’intrication du temps personnel et des temps longs des forêts et des vergers ; loin de se perdre ou de se diluer dans ceux-ci, il y prend consistance. Ce n’est là qu’une des nombreuses expériences sensibles dans lesquelles le sujet se laisse travailler par les liens qui le constituent, une des formes de reconnaissance de la compréhension élargie du soi qui se joue dans le « compagnonnage sensible » dont Jean-Philippe Pierron rend compte dans ce livre.
L’écobiographie comme enquête philosophique
Par ces récits, Jean-Philippe Pierron s’attache à remplacer une langue aseptisée saturée de chiffres et de décomptes par une poétique attachée aux mots et aux images,
Le soi perd en souveraineté. Il ne s’agit plus d’affirmer l’hétérogénéité, la différence humaine par rapport au reste du vivant. Il s’agit au contraire de reconnaître que nous appartenons à celui-ci, ne serait-ce que par notre corps, même si tout nous force à le nier – depuis notre enfance où l’on nous intime de mieux nous tenir à table parce que « Nous ne sommes pas des animaux ! » jusqu’à l’ultime rituel de séparation qu’est la sépulture occidentale.
Aussi, les expériences écobiographiques, en réaffirmant l’inscription de l’homme dans des temporalités et des finalités autres, soulèvent des enjeux philosophiques cruciaux. L’homme est un vivant : c’est la réponse hautement ontologique et existentielle qu’apporte l’expérience on ne peut plus concrète de la philosophe écoféministe Val Plumwood, prise pour proie par un crocodile alors qu’elle faisait du canoë sur une rivière du plateau d’Arnhem Land, dans un parc national australien. Le questionnement philosophique ancestral de l’identité humaine se trouve réduit à une évidence : « Et au moment où je me mis à me considérer comme un gibier, je me rendis compte encore avec stupéfaction que j’habitais un monde (…) qui ne ferait pas d’exception en ma faveur, aussi intelligente puissé-je être, car comme tous les vivants j’étais faite de viande – j’étais pour un autre être une denrée nutritive ».
Produire une politique du sensible
L’aménagement d’un lieu de soin interespèces plus proche de la ZAD que de l’hôpital, l’attachement à un vallon et à ses rivières ou le simple fait d’apprécier la présence d’un insecte sur le mur d’une clinique sont autant d’expériences qui construisent une nouvelle attention, non seulement à ce qui enrichit nos relations au vivant, mais aussi à ce qui les aliène. Ces chroniques écobiographiques tiennent lieu d’invitations. Elles ouvrent la voie pour chacun vers une politique de l’attention envers ses propres expériences, passées ou présentes.
Ces chroniques écobiographiques ouvrent la voie pour chacun vers une politique de l’attention envers ses propres expériences, passées ou présentes.
« La dimension relationnelle du soi écologique s’élève en critique de toutes ces relations de résonance avec le monde que le capitalisme tardif réduit au rang de rapports fonctionnels ou opérationnels. » Se laisser travailler par notre inscription dans un territoire et établir une réelle reconnaissance de notre appartenance à un ordre du vivant qui nous dépasse, c’est ressentir ses devoirs envers cet ordre. Car l’écobiographie appelle à des résistances, elle cultive des ébranlements. La radicalité des liens qu’elle produit tient à ce qu’ils révèlent au sujet la nécessité d’une éthique.
D’abord parce que se sentir proche de ce qui nous entoure, faire siennes les résonances entre soi et le monde sauvage – ordinaire ou extraordinaire, limaces ou hippopotames – c’est nécessairement aussi éprouver le besoin d’une nouvelle éthique du soin envers lui. La conscience d’appartenir que nourrit l’exercice de l’écobiographie rend saillante l’importance de protéger tout ce à quoi nous sommes liés et qui nous constitue.
Au-delà de l’expérience éthique, ou plutôt comme le prolongement impératif de celle-ci, l’écobiographie est aussi et surtout un exercice politique. Elle nous invite à interroger le socius qui prend place entre le bios et l’oikos, la socialisation qui rompt l’immédiateté de nos relations avec les autres terrestres, qui les abîme en tentant de les remplacer par des volontés de domestication ou d’avoir. Ne plus voir dans la nature « ce qui sert notre subsistance », mais « ces liens qui définissent notre substance », c’est nécessairement faire naître à son égard des passions joyeuses mobilisatrices essentielles à la construction d’une écologie profonde.
Si l’exercice de soi que constitue l’écobiographie est un geste intime, il doit ouvrir la voie vers un geste politique collectif qui manque aujourd’hui d’ancrage sensible
« Une écopoétique prépare une écopolitique », l’écobiographie doit permettre de passer de la connaissance théorique et souvent chiffrée des enjeux écologiques à une reconnaissance sensible de la valeur de ces liaisons qui nous font être. Si l’exercice de soi que constitue l’écobiographie est un geste intime, il doit ouvrir la voie vers un geste politique collectif qui manque aujourd’hui d’ancrage sensible : « l’écobiographie cultive la part de sauvage du monde en soi et hors de soi, comme une arme contre un système néolibéral, lequel système confisque les mots et les signes qui expriment notre présence au monde en les transformant, dans la novlangue de la gouvernance par les nombres, par les indicateurs et des procédures isonormées. »
Nous ne pouvons nier que l’auteur atteint son ambition en créant un outil précieux pour permettre à chacun de reconnaître la densité de ses propres attachements. Nécessaire, celui-ci est-il néanmoins suffisant pour préparer le franchissement de l’étape suivante qu’il appelle de ses vœux, toute aussi cruciale que la conversion ontologique et émotionnelle opérée par l’écobiographie ?
Si Jean-Philippe Pierron insiste sur le caractère collectif du geste auquel l’écobiographie doit servir de terreau, il gagnerait à poser les jalons nécessaires à une conversion des affects en mobilisation politique concrète. Il trancherait ainsi sans équivoque contre une interprétation de son ouvrage comme manuel de développement personnel – lecture à laquelle le « Cahier d’exercices écobiographiques » qui clôt le livre ouvre la voie.
- Jean-Philippe Pierron Je est un nous. Enquête philosophique sur nos interdépendances avec le vivant, Actes Sud, Coll. Mondes Sauvages