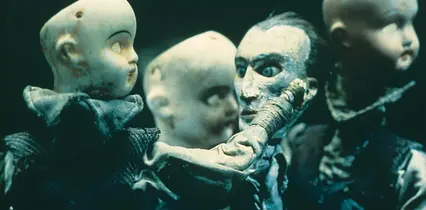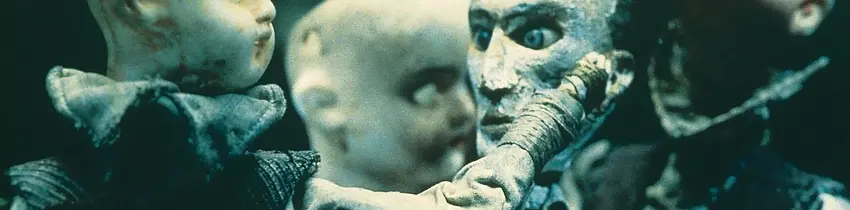Dans l’épaisse forêt qui borde le village, plusieurs jeunes hommes disparaissent. On accuse des étrangers qu’on aurait croisés. On annonce aussi l’apocalypse. Dans Rapture, deuxième volet d’une trilogie à venir, le réalisateur Dominic Sangma revient dans les montagnes du Meghalaya où il a passé son enfance. Un film subtil où la peur est filmée sur un tempo tranquille.

Rapture s’ouvre sur une scène de chasse. Dans une nuit parsemée de torches, courbé au pied des arbres, le village traque les cigales sur les troncs. Tous les arbres sont scrutés : on arrache méthodiquement les insectes de l’écorce. On les jette dans un seau. Les corps s’amassent. Pourtant, vu de l’extérieur, le spectateur assiste à une simple cueillette, à une récolte sans bain de sang. Une scène à l’image du long-métrage ; dans ces montagnes du nord-est de l’Inde, les tours de garde et la violence xénophobe ont des airs paisibles. Rapture est paradoxal sur ce point : alors qu’il raconte un moment de bascule pour le village, avec la disparition de jeunes hommes dans la forêt, la menace d’étrangers plus ou moins fictifs et l’annonciation de la fin du monde, partout, le long-métrage se concentre sur la routine.
Pour ce faire, Dominic Sangma alterne entre le point de vue presque omniscient d’une caméra qui passe d’un personnage à un autre, s’invitant dans leurs maisons et leurs intimités, et celui de Kasan, dix ans, à mi-chemin entre observateur extérieur et porte d’entrée sur ce monde clos. Réussira-t-on à capturer les étrangers responsables de la disparition des jeunes hommes ? Comment les punira-t-on ? Sont-ils vraiment annonciateurs d’une punition divine, comme l’affirme le prêtre du village ? Si l’heure est aux questions, aucun des habitants ne remettra en doute la culpabilité des étrangers, ni même leur existence. Entre chasse à l’homme et paranoïa collective, le film de Dominic Sangma frappe aussi par son analyse des comportements sociaux et des mécanismes de groupe.