
Le dernier roman de Sarah Chiche, Les Alchimies, paru en août 2023 aux éditions du Seuil, propose une réflexion autour de la connaissance à partir du parcours initiatique de Camille Cambon, médecin légiste en quête d’absolu. À l’occasion d’une soirée organisée par l’association Textes et Voix consacrée à ce livre, Margaux Mérand a choisi de poser quelques questions à Sarah Chiche.
Margaux Mérand : Les Alchimies raconte la quête de Camille Cambon, un médecin légiste de quarante-huit ans, qui va remonter aux sources de la passion de ses parents – eux-mêmes médecins et chercheurs renommés, morts alors qu’elle était enfant – pour le peintre Goya et son crâne volé après son inhumation à Bordeaux en 1828. Comment avez-vous choisi votre objet ?
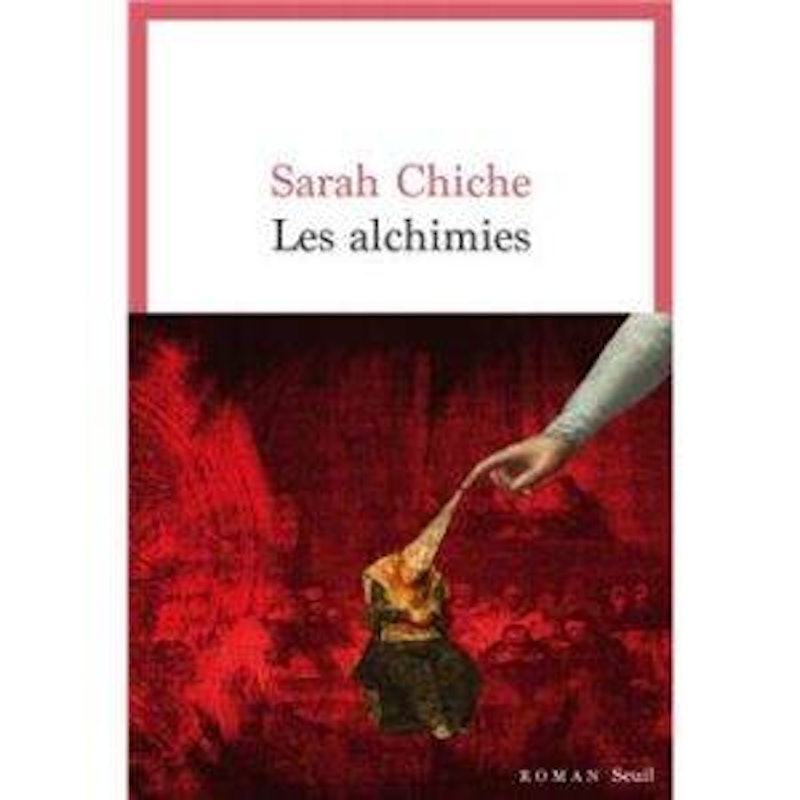
Plus tard, grâce au documentaire du cinéaste espagnol Samuel Alarcon, je découvre l’histoire rocambolesque mais strictement véridique du vol du crâne de Goya. Défenseur des Lumières, pourchassé par l’Inquisition, il s’exile à Bordeaux. Il y vit, y est heureux, y meurt en 1828. Soixante ans plus tard, au cours d’une promenade au cimetière de la Chartreuse, le Consul d’Espagne tombe par hasard sur sa tombe. Lui vient alors une idée tout autant dictée par le désespoir (il vient de perdre sa femme) que par la vanité : faire rapatrier le corps du génie espagnol dans son pays d’origine. Des démarches sont entreprises ; on procède à l’exhumation. Et c’est la stupeur : les ossements du peintre sont bien là mais son crâne a disparu. On l’aurait vu dans les sous-sols de l’université de médecine de Bordeaux. Il aurait, dans les années 1950, trôné sur le comptoir du Sol y Sombra, un cabaret prisé par la communauté espagnole tout autant que par les étudiants de l’université de médecine voisine. D’autres ont assuré que la dernière compagne de Goya, Leocadia Weiss, l’avait cédé à un médecin avide de comprendre l’origine de son génie, car adepte de la phrénologie, cette science qui, au XIXème siècle, postulait que nos vertus et nos vices étaient inscrits sur les bosses du crâne. Mais d’autres encore sont persuadés qu’un mécène de l’époque de Goya, le marquis de San Adrian, aidé de son valet, un certain Dionisio Fierros, s’est introduit dans le cimetière, pour le voler, le ramener en Espagne, avant que le petit-fils de Fierros ne l’embarque à l’Université de Salamanque et le casse lors d’un jeu entre étudiants en médecine.
Alors même que je suis immergée dans l’écriture d’un précédent roman, je découvre, atterrée, l’histoire du charnier de l’Université Paris Descartes. Immédiatement, je vois dans cette affaire de corps légués à la science mais conservés du fait d’impérities diverses, dans un triste état, au sein du plus grand laboratoire européen d’anatomie, un Goya contemporain.
La machine à penser des histoires s’enclenche ; l’imagination s’emballe. À partir de ce qui constitue l’une des grandes énigmes de l’histoire de l’art, je conçois tout le reste. Un roman d’aventures qui croise les époques, les modes de narration, et fait voyager du siècle des Lumières à notre monde contemporain, en passant par le Bordeaux des années 1960. Avec une exigence, au moment de l’écriture : la véracité. La réalité historique et la fiction devaient être nouées l’une à l’autre avec le plus de rigueur possible. Je me suis rendue dans deux services de médecine légale, dans un service de neuropathologie, longuement discuté avec des médecins légistes, des neurologues, des toxicologues. Et j’ai poussé la passion de l’enquête jusqu’à me rendre moi-même dans la partie non officielle de ces galeries souterraines, de ces catacombes dont il est question dans la seconde partie du livre.
Camille, à propos du décès brutal de ses parents, dit qu’elle n’eut, enfant, pas de mots. À cet égard, votre roman m’a rappelé Le Cri du sablier de Chloé Delaume, une histoire d’aphasie et de recouvrement progressif de la parole qui se traduit, dans l’écriture, par une syntaxe fragmentée qui se transmue en phrase continue. Camille cherche-t-elle aussi à ramener l’accident à l’ordre du dicible ?
Dans Les Alchimies, j’avais envie de raconter l’histoire d’une aventurière de la connaissance, d’un vaillant petit soldat de la médecine, une tête pensante, obsédée par le démon de la recherche
On peut, naturellement, faire des parallèles entre le travail du médecin légiste, le lecteur de cadavres, et ce qu’on peut chercher dans l’écriture. Il s’agit, dans un cas comme dans l’autre, de disséquer la nature humaine et de rendre à la lumière le fond le plus opaque de ce que nous sommes. J’ai adoré Le cri du sablier de Chloé Delaume, lu dès sa parution, tant pour son inventivité formelle que son implacabilité. Et je me souviens y avoir, à l’époque, trouvé des affinités avec ma manière de faire avec ce qui fait trou, effraction dans une vie. La question de n’avoir pas de mots pour penser la disparition d’un être cher est centrale dans Saturne. Mais dans Les Alchimies on est dans un tout autre paradigme. Il y avait l’envie de raconter l’histoire d’une aventurière de la connaissance, d’un vaillant petit soldat de la médecine, une tête pensante, obsédée par le démon de la recherche, et dont ni l’amour ni le traumatisme de la perte des parents ne sont le centre de gravité de son existence – très loin de mes précédents romans, donc. La seule chose que j’ai cherché à rendre dicible, c’est qu’il y a une opération alchimique à l’œuvre dans l’écriture – d’exhumation, de transformation et de transmutation du matériau. Tout comme en alchimie, il existe trois phases, l’œuvre au noir, au blanc, puis au rouge, pour accomplir la transmutation du plomb en or, le livre subit diverses transformations, passant d’un style à un autre… Il commence comme un roman social ; on est en pleine crise de l’hôpital public, en 2022, et le livre pastiche les codes de certaines séries médicales, de Grey’s anatomy à The Good Doctor. Puis Camille reçoit ce mail où il est question du peintre Goya, précisément, sur lequel son père a écrit, dans sa prime jeunesse, un livre, et on quitte Grey’s Anatomy pour le thriller, puis pour l’essai sur l’origine du génie Goya, puis on arrive, par la voix de Jeanne, dans le roman picaresque, qui va nous emmener de Bordeaux, jusqu’aux catacombes.
En découvrant l’histoire de ses parents, rapportée par une personne extérieure qui fut leur amie proche lorsqu’ils étaient jeunes et au seuil de leur carrière, Camille s’aperçoit de manière vertigineuse qu’ayant passé des années à ouvrir des cadavres en pratiquant leurs autopsies, elle n’a néanmoins « rien vu ». Cela fait écho à un autre passage où vous écrivez que la plus grande douleur, pour un enfant, est de voir le regard de sa mère figé « dans un abîme dont il ne sait rien ». Cette idée d’une cécité et d’une ignorance qui seraient au fondement de la relation à l’autre, et surtout de la relation enfant-parents, me fait penser que le travail de la psychanalyse est peut-être semblable à cet effort d’étrangéisation que fait un sujet en direction de parents dont une image interne, un fantasme, se sont solidifiés. Il y a comme une rencontre impossible, mais dont la prise de conscience est salutaire, déprend le sujet d’un narcissisme infantile. Le psychanalyste, aussi, pose méthodiquement le patient comme autre sans se hâter de croire qu’il le connaît. En ce sens, diriez-vous que votre écriture est mimétique de l’ambition psychanalytique, qui est toujours un désaxement ?
Il m’est impossible de parler d’écriture et de mon rapport à l’écriture en termes psychanalytiques. Je ne sais donc pas répondre à cette question. Et c’est tant mieux. Si je savais y répondre, il ne s’agirait plus de littérature.
Alexandre, le parrain de Camille, neurologue brillant, consacre sa vie à « l’étude des diverses manières dont nos cerveaux offrent un sens au monde ». Je pense notamment à Lionel Naccache, que j’ai lu récemment. Pourquoi avoir mis en avant ces travaux, cette branche de la recherche ?
Posséder le crâne d’un génie, est-ce là une façon de s’approprier un peu de son savoir ?
À l’époque du vol du crâne de Goya, la phrénologie, inventée par Franz Joseph Gall, postulait qu’on pouvait voir l’origine de nos vices comme de nos vertus, de nos tares, de nos médiocrités ou de nos grandeurs inscrites sur les bosses de nos crânes. On a ainsi pu penser qu’il y avait des criminels-nés, des prostituées-nées, comme des savants-nés. Si l’on devine sans peine les dérives eugénistes d’une telle théorie, fort heureusement depuis tombée en désuétude, il faut se souvenir qu’elle donna lieu, au XIXème siècle, à une épidémie de vol de crânes d’artistes et de génies. Beethoven, Swedenborg, Haydn, Goya…. Sur la question, je recommande vivement la lecture de l’essai génial de Colin Dickey, Cranioklepty. Posséder le crâne d’un génie, est-ce là une façon de s’approprier un peu de son savoir ? Du vol de crânes d’artistes au vol des cerveaux d’élites, un siècle se passe. Mais c’est bien pour la même raison qu’un petit malin a dérobé, post mortem, des morceaux du cerveau d’Einstein. Puisque Les Alchimies est aussi un roman sur l’origine du génie et les bases cérébrales de la conscience, il me paraissait fondamental de restituer dans le livre quelque chose de l’esprit des travaux de certains neuroscientifiques : Lionel Naccache, oui, absolument, sur le cinéma intérieur de la mémoire, mais aussi Oliver Sacks, Raphaël Gaillard, Yves Agid ou Olivier Lyon-Caen.
L’intelligence, l’esprit de recherche, semblent être un objet à part entière de votre roman. Pourquoi ?
Il y a peut-être là un brin de provocation : imaginer, dans une époque où parfois l’ignorance et la haine du savoir aiment à s’exhiber, un roman dans lequel tous les personnages sont aimantés par le démon de la recherche. J’avais en tête les chercheurs d’absolu qui ont marqué ma vie de lectrice : Louis Lambert, Raphaël de Valentin, ou Balthazar Claës dans les romans de Balzac. Et, naturellement, Zénon, le médecin et alchimiste de L’Œuvre au noir de Marguerite Yourcenar.
Enfin, le roman change régulièrement de rythme et d’atmosphère au gré des âges de la vie de Camille, qui se superposent. En composant son enfance et son adolescence, qui sont rendues de manière extrêmement vivante, dans quelles sources avez-vous puisé ? Vous faites dire à Jeanne que le désir de parler de soi, de mettre ses tripes dans un roman, procède toujours d’un « effrayant besoin d’amour ». Il semble, à la lecture du roman, que vous vous soyez vous-même décentrée. Est-ce le cas ?
J’aime assez mettre en pièces mes pires travers, moquer ce que j’ai pu écrire ou saccager mon esprit de sérieux. J’ai donc pris un certain plaisir à mettre dans la bouche de Jeanne cette critique d’une certaine littérature du « je ». Mes précédents romans, Les enténébrés et Saturne, étaient d’inspiration autobiographique. J’y ai largement écrit, et chacun peut le vérifier dans ces livres, qu’à mon sens on ne faisait pas son deuil mais qu’on est fait par le deuil et que l’écriture n’est pas une thérapie, qu’elle ne sauve pas. Ça ne veut pas dire qu’il me faut être assignée à toujours rabâcher la même histoire de livre en livre. Camille a eu une enfance et une adolescence douce, solaire, exempte de toute violence psychique ou physique, auprès de deux parents profondément aimants. Ce sont là des choses que je n’ai jamais connues. J’ai expérimenté une joie certaine à écrire sur ce que je ne connaîtrai jamais en tant que fille. Je n’ai rien réparé en donnant à cette vie de famille une épaisseur, une consistance dans Les Alchimies. Je n’ai rien réparé, mais j’ai expérimenté un degré de liberté encore plus grand.
- Sarah Chiche, Les Alchimies, Seuil, 2023.
Crédit photo : SARAH CHICHE – PHOTO © BÉNÉDICTE ROSCOT

















