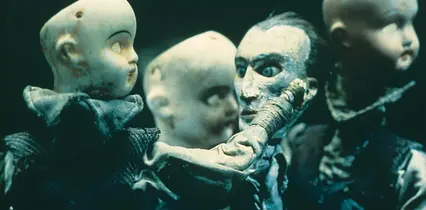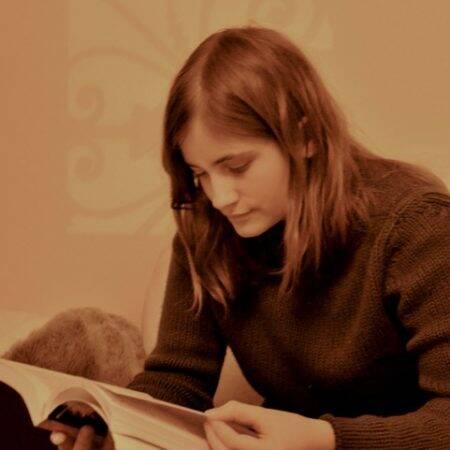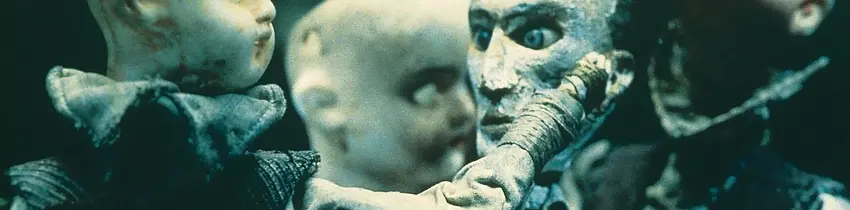Face à Agnes, ses beaux cheveux bruns, son humour pince-sans-rire et son nez effilé, difficile de ne pas voir une Fleabag qui aurait perdu son accent anglais. Mais le personnage écrit et incarné par Eva Victor a un autre point commun avec celui de la série de Phoebe Waller-Bridge: son panache cache une grande fragilité. Peu à peu, l’incident – la déviation à l’origine de tout –se dévoile.

Le cinéma américain nous a abreuvé de réunions d’anciens élèves emplies de gêne, où nerds revanchards et quarterbacks éculés comparent à demi-mot leurs trajectoires de vie. Qui a réussi ? Qui a mal fini ? Comment a vieilli la cheerleader, que devient le chouchou de la classe ? Si Sorry, Baby embrasse pleinement le malaise inhérent au fait d’entretenir des liens désormais distendus, le film nous épargne la sueur et les hormones lycéennes ; ici, on retrouve ses anciens camarades de thèse. Alors : Agnes, nerd ou jock ? Dans cet écosystème où le dernier Eastpak n’a jamais entraîné aucune jalousie, contrairement à un compliment du prof sur sa lecture hégélienne de Borges au prisme du Nouveau roman, Agnes ferait figure de rockstar. Élève modèle, poste de professeure offert au sortir d’une thèse parfaite, elle a sa carrière (prometteuse), sa maison (charmante), son bureau (spacieux) et ses élèves (investis). De quoi rouler des épaules à table. Pourtant, entre deux références à ses exploits, Agnes respire le malaise.
“D’un sujet qui ne prête pourtant pas à rire, Sorry, Baby tire une comédie dépressive au sens premier.”
Thérapie du sandwich
Pour explorer les raisons du mal-être de son personnage, Eva Victor structure son film en cinq chapitres, représentant cinq tranches de vie, avant, pendant et après. Après quoi ? Un truc merdique, répond Agnes. Si la question de la reconstruction après...