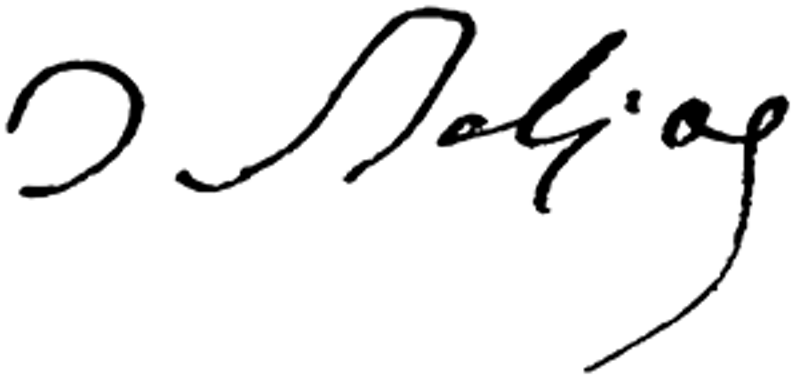Nous poursuivons ce dimanche notre série consacrée aux pastiches d’écrivains confinés en publiant les trois premiers chapitres d’un roman d’Honoré de Balzac intitulé Splendeurs et misères d’une crise sanitaire et appartenant à la section des « Scènes de la vie politique » de La Comédie humaine.
Chapitre I
Un vivant exemple du ressentiment

Madame Braconnier portait sur le visage les rides de son indignation : tout son être était voué à exprimer des pensées amères qui reflétaient les remords d’occasions manquées ou l’écho d’une indignation collective. Sa figure était plus ronde qu’ovale, et quelques boursouflures n’effaçaient pas certaines finesses de traits – lesquels, s’ils étaient anciens, avaient dû un jour éveiller un charme, même assez mince. Sa tignasse brune et négligée donnait du volume à ses humeurs sans toutefois jurer avec le chaos qu’exprimait sa personne tout entière. Les humeurs qui agitent les femmes jaillissaient toujours de ces visages expressifs. Notre héroïne avait dû ressembler à ces sublimes martyrs, sublimant la féminité lorsqu’elles menaçaient César. Elle paraissait toutefois aux yeux du monde alourdie par trois grossesses. On lui aurait ainsi donné plus de cinquante ans quoiqu’elle n’en eût pas encore quarante. Ses ongles étaient curés mais ses mains étaient sales. De tout son entourage, elle seule pouvait s’autoriser une telle négligence. Une répugnante beauté se dégageait d’elle. Le jaloux ressentiment qu’inspire la certitude ou l’aveuglement offre bien des licences – lesquelles sont d’autant moins chères, qu’on se les offre à soi-même.
Depuis sa plus tendre enfance, notre bourgeoise s’abîmait dans le ressentiment. L’aigreur marque un visage davantage que toute maladie ou que l’usure du temps. Rien n’afflige autant que les déceptions, les excès et les bas de laine qui se vident par de mauvais placements. Madame Braconnier entendait la voix du Président et feignait de ne pas y prêter attention. Les nouvelles, en vérité, la passionnaient. Elle lisait les journaux assidument, s’entretenait et entretenait ses proches du contenu de leurs colonnes. Or, toutes les voix qui comptent à Paris avaient commencé à établir entre le ciel et le chef de l’État, alors pourvu de belles victoires électorales, une entente à laquelle cet homme devait son prestige. Sa souveraineté – jupitérienne, selon ses ministres – n’était à vrai dire plus disputée et on disait sa position ferme et assise.
Hélène Braconnier pourtant, était lasse de le voir. Elle n’en pouvait plus, et « elle n’était d’ailleurs pas seule à en avoir marre ». Elle avait aussi dans ses manières, dans sa voix gutturale, dans son air souverain et dans son regard creusé un je-ne-sais-quoi ou un presque-rien qui en impose toujours.
La vacuité et la profondeur ont souvent des effets semblables auxquels se trompent le commun – pour lequel la profondeur n’est souvent que coquetterie, sophistication et cordialité mondaine. Malgré son indifférence aux réalités du monde, sa négligence perpétuelle du présent, notre héroïne émettait sur chaque nouvelle un arrêté définitif avant d’annoncer sobrement : « d’Emmanuel Macron ou de moi, il n’en restera qu’un ».
Chapitre II
Où l’on découvre les origines plébéiennes d’Hélène Braconnier
Afin de discerner l’originalité de son personnage et les ressorts de son discours, on comprendra comment tout fait divers qu’un analyste décrit comme un phénomène et qu’un sage congédie comme une contingence, devient un événement « historique » pour un petit esprit. Un événement n’est rien à lui seul : sa valeur dépend de ce que les individus – ou l’opinion publique – choisissent d’en faire.
Peindre l’origine de ce personnage peut ainsi expliquer comment Madame Braconnier se trouvait si au fait des bruits du monde – et si alerte quand des événements imprévus vinrent troubler la prose de ses jours. Son père, appelé Jacques, était le fils d’un bourrelier des environs du Bretonneau. Jacques Braconnier avait épousé en premières noces la tenancière de la place centrale dont il lavait la vaisselle l’été pour gagner trois sous. La boutique avait pignon sur rue, et son succès d’estime était réel et lui accrochait la fidélité des badauds des environs. À l’heure du déjeuner, ce noble établissement recevait une clientèle ordinaire mais également quelques personnes installées et connues pour leur honorabilité et leur situation acquise, des représentants de la chambre de commerce, ou des avocats à la cour.
Jacques eut trois filles et un garçon mort-né – alors que les soins infantiles étaient encore négligés en ces temps reculés et se faisaient de toute façon mal comprendre de ces milieux populaires. Ayant acquis du bien, admis à l’association des commerçants du bourg, Jacques Braconnier était le quincailler « chez qui on allait » et faisait commerce de toute marchandise.
Le voisinage ne leur adressait la parole que pour se plaindre des déjections canines, du bruit des enfants, des odeurs de la boulange ou du montant inflationniste des impôts locaux – alors que la taxe foncière en ville avait juste atteint le plafond de ce que lui permettait l’office à la chambre régionale des comptes. À leur exemple, Jacques avait pris le parti de commenter bruyamment tout phénomène, même le plus courant, souvent pour s’en indigner : le rouge caillé d’un panneau de circulation, la chaussée mal entretenue par les services de la ville, la rouille qui prenait la ferronnerie signalant l’entrée d’une des dernières rues médiévales du centre étaient pour lui des motifs d’indignation sans fin.
Sa sociabilité s’étendait entre deux débits de boisson, séparés de quatre-vingt mètres de rues pavées : l’un accueillait le milieu sophistiqué et mondain de province, et était l’annexe du théâtre de la ville. L’autre était une foire aux harangues : le zinc servant tout à la fois de support au café crème et de table ronde où intriguer. Il se promettait de ne jamais quitter les limites de l’ancien bourg que pour visiter les maisons où sa famille avait acquis du bien.
La première fille avait dédaigné la boutique, refusant un destin assigné alors que ses capacités lui offraient de pouvoir davantage. Elle travaillait dans une compagnie d’assurances et avait adopté la mode vestimentaire des années 1960. On commençait à admettre le pantalon chez les femmes. Lors des grandes grèves de 1968, la liberté de se vêtir était devenue – comme d’autres licences qui auraient pu sembler futiles une ou deux générations auparavant – un enjeu capital.
À l’âge de quatorze ans, la dernière de ses filles, Anne-Cécile, commençait le métier avec son père. Par dépit, elle reprendrait l’affaire. Ce n’était pourtant pas sous les meilleurs augures qu’elle allait entrer dans le monde. Ce débris de petite bourgeoisie avait une figure blême qui reflétait le soin et la patience commerciale, la cupidité diligente que réclament les affaires. On connaissait déjà de moins en moins ces vieilles familles où s’étaient conservées de précieuses traditions de mœurs et des coutumes caractéristiques de la profession. Dans la civilisation nouvelle d’après-guerre, la dignité du commerce était devenue un souvenir – et pour certains, restait encore un songe. Le chef de famille était devenu un notable à la fin de la décennie 1950 – quelques années seulement avant que l’espèce ne soit menacée. La massification du commerce, le nivellement des professions rendaient désormais désuètes et résiduelles les petites affaires. Les détaillants étaient quatre fois moins nombreux à la fin de la décennie 1960 qu’ils ne l’étaient au début – et ceci en dépit de quelques protections juridiques ou résistances syndicales inspirées par leur caractère ombrageux.
À la mort de Jacques, Hélène Braconnier avait finalement repris l’affaire. Mais il n’y avait désormais plus ni salons, ni livraisons, ni grands revenus. Quelques appartements servaient de dépôt ou de locations meublées pour des contremaîtres en mission à durée déterminée. Le bien, le métier, la condition étaient déclassés.
Chapitre III
Histoire d’une conspiration
La situation sanitaire s’aggravait. Cloitrés chez eux, les gens se transmettaient le virus dans la plus stricte intimité familiale – situation dangereuse car propice aux communications et pratiques à risques que sont la bise, la poignée de main ou la discussion cordiale entre proches. Le ministère allait envoyer des agents pour rendre plus claires encore certaines de ses recommandations. À leur arrivée, Pierre-Emmanuel, commis de bureau – dont on ne devait retenir que le prénom – et le docteur Mallet furent reçus avec égards sous les beaux plafonds du conseil municipal. Pour se présenter, ils se disaient « attachés de l’administration centrale du ministère de la santé » – terme choisi lorsqu’on précise le statut juridique de son contrat de travail – mais qui dans ce pays fruste où l’on sépare encore mal un mot d’une chose, s’entendait comme une façon de tenir la laisse des animaux domestiques.
Ces messieurs avaient des gants bleus ou verdâtres et un appareil portatif à la main dont l’écran et ses mesures courbées, oscillantes et énigmatiques, inquiétait. Ils devaient être de quelque organisme officiel dont la compétence restait une énigme pour eux-mêmes comme pour les autres. L’homme qui s’avançait le plus hardiment – et dont on devinait à la démarche assurée qu’il menait très certainement l’équipe, affichait dans sa manière de répondre à chaque problème une notable économie de paroles, et dans sa manière d’expédier toute tâche une notoire économie de gestes.
Ces fonctionnaires chérissaient toutes les étranges passions qui rendent esclaves de la fonction. Ils contemplaient tout d’un œil indifférent mais adoptaient – disait-on – une attitude éthique qui consistait essentiellement en une manière de froncer les sourcils pour adopter un regard pénétré et un air citoyen.
Pierre-Emmanuel sortit de son entretien avec le maire et harangua la multitude. Il détaillait les méthodes et les procédures des exécutants, de la connaissance et du savoir. Il disait qu’au pays de Pasteur, le théorème et la blouse blanche étaient souverains, que la science était la loi, et que la loi ne devait agir que par la science. Il disait aussi que des traitres se cachaient parmi eux. Aussitôt prononcés ces mots terribles, la foule afficha un air surpris. Des « oh… », des « quoi ? », des « comment ! » fusèrent de toute part. Un traitre refusait de suivre les consignes : de porter un masque waterproof sous la douche ou de se laver les mains avant de saisir sa savonnette. Tout en causant, les deux agents épiaient les regards flamboyants de la foule. Une passion froide enflammait le cœur insensible de ces deux êtres qui savouraient la Terreur.
Un bourgeois ordinaire, qui tempérait beaucoup d’ennui par beaucoup de réflexions, s’était approprié mille recommandations officielles : trompant les soudaines apoplexies de son esprit et de son âme, il savait quoi faire et conseillait à son entourage de suivre les flèches dans les magasins, de porter un masque seul dans sa voiture et d’obéir à tout ce que nous disait de faire Monsieur le Premier ministre lorsqu’il s’exprimait à la télévision. Il pérorait : « ce traitre transige avec les gestes barrières, consciemment ou non, il sert l’ennemi invisible ! C’est de concert avec le virus qu’il menace notre santé et retarde notre libération ! ».
Madame Braconnier était peut-être la seule qui ne fut ni surprise ni indisposée. Elle exprimait les lumineuses souffrances qu’inspirent ces soudaines volontés répandues ou concentrées par une alchimie inexplicable. Pendant quelques secondes, cette femme se sentait enfin l’impérieux pouvoir d’émettre des idées. Elle savait toutes ces choses d’instinct – d’un instinct dont elle disait d’ailleurs, qu’il ne la trompait jamais, même lorsqu’il inspirait les plus teigneux défis à la logique et à la cohérence.
Elle ne pensait en effet qu’au renversement du régime, dont le triomphe arrogant avait excité chez elle comme une rage, mais une rage désormais froide et sinueuse. Derrière tout grand pouvoir se cache un grand crime. L’exécution de ces desseins aurait expliqué bien des évènements : elle disait avoir appris la conspiration de ses ennemis. Elle serait de ces hommes qui rejoueraient la grande peur de mars 2020 et infligeraient la terreur à l’adversaire. Avant tout le monde, mieux que tout le monde, devant leur incrédulité méprisante ou hostile, Hélène Braconnier pouvait s’honorer de l’avoir dit. L’exagération naturelle à tous les déclassés ferait naître et accumuler les idées les plus fantaisistes. Sans être un Faust ou un Raspoutine, elle ne doutait pas de son projet de vengeance et répétait en congédiant toutes les sécurités et les protections : « peut-être vivrais-je assez pour libérer la France d’Emmanuel Macron ».