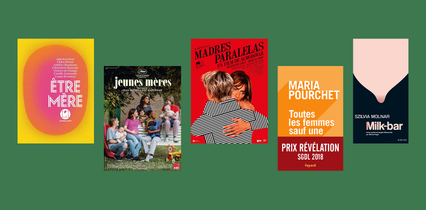Notes sur la marche en itinérance
Il est huit heures et nous avons resserré les lacets de nos chaussures, harnaché nos sacs, réajusté nos sangles.
*
Il est huit heures et nous avons resserré les lacets de nos chaussures, harnaché nos sacs, réajusté nos sangles. Pierre a fini de remplir sa bouteille dans le robinet d’eau potable qu’on a dressé Dieu sait comment sur les hauteurs d’un gros caillou. Il est temps pour nous de partir. Sur le sentier rocailleux qui descend de notre promontoire, il lève pour la dernière fois la tête vers le refuge des Bésines, et murmure : « Ça va me manquer ». Si le refuge va manquer à Pierre, c’est parce que nous y sommes restés deux nuits. Or deux nuits, c’est déjà une de trop.
Deux nuits, voilà qui aura suffit à créer chez nous le sentiment de maison. Arrivés le mardi, nous y étions le mercredi comme chez nous, avec l’étonnante aisance des anciens à qui on ne la fait pas. Nous allions et venions dans les dortoirs avec un naturel souverain, très sûrs de l’heure à laquelle nous allions manger, peu inquiets des détails du menu et tout à fait au courant que nous aurions nos places réservées au réfectoire. J’eus, le matin de notre départ, l’orgueil de ressentir une nostalgie des Bésines supérieure à celle des autres, et le regret de devoir lui dire au revoir. J’eus le sentiment de trahir le sens même de ce que nous cherchions dans la marche. Puis ma vanité a fondu au soleil, tandis que nous quittions notre foyer transitoire, en même temps que le soleil achevait de délaver la crête des montagnes.
*
Le matin, la plupart du temps, nous marchons en silence. Cela me laisse tout le loisir, alors que les syrphes et les hespéries s’évadent des buissons, de réfléchir à ce pan du geste de métaphorisation qu’englobe la marche, qui est celui du rapport à la maison. Il existe, à dire vrai, une abondante littérature à propos de la marche, et dans cette cuve on trouve à boire et à manger – une profusion de récits sur le chemin de Saint-Jacques, des Rêveries, des flâneries, des promenades, du renoncement chez Thoreau et du muscle chez Nietzsche, de la philosophie bas de gamme et quelques épiphanies brillantes. Dans mon esprit, alors que les torrents déferlent vers des tourbières boursouflées de papillons, je gage que le sens profond de l’exercice réside dans sa mise en jeu de l’idée de maison.
Soudain, un bêlement fantôme se fait entendre dans les alpages. J’ai peur des chiens, alors je quitte les entrechocs de mon esprit pour guetter le troupeau sur les arêtes, et vérifie le tracé sur ma carte.
*
Lorsque vous rencontrerez pour la première fois un randonneur autour d’une bière le soir sur votre étape, deux sujets feront inévitablement l’objet de votre conversation : le lieu depuis lequel vous venez (ou celui que vous rejoindrez le lendemain) et le poids de votre sac.
Quand je fais un tronçon de Saint-Jacques, le poids du mien m’est révélé au onzième jour à Conques, dans l’Abbatiale Sainte-Foy. Une balance à crochet y a été installée dans la ruelle des convers, qui jouxte le cloître, à l’intention des pèlerins. Le verdict est lourd : 14,6 kilos. A côté de moi, Luc, un maçon du Vexin qui a insisté pour marcher à mes côtés, se fend en remontrances. Pour me donner l’exemple, il suspend son propre bagage, tout fier de m’expliquer qu’il a pesé chacun de ses pansements afin que celui-ci n’excède pas les 13.
La règle d’usage chez les randonneurs, c’est qu’un sac à dos ne doit pas excéder les dix kilos – au-delà, chaque kilo se fait ressentir à hauteur de 20% du poids du porteur. Chez les plus expérimentés, pour ne pas dire les plus snobs, les cabotins du sentier, les héros de la marche, excéder les six kilos c’est s’encombrer déjà. Si une telle ferveur pour le frugal se justifie par la noble intention de ne pas se casser le dos, il n’empêche qu’elle interroge : au-delà des compétitions imbéciles qui, hélas, semblent bien gangréner tous les milieux possibles et imaginables, faire son sac devient dès lors un exercice pointilleux, qui conduit à s’interroger sur le nécessaire et, surtout, sur ce dont on s’accompagne.
*
La première fois que je pars marcher en itinérance, dans la Forêt Noire avec Pierre et Papa je prends dans mon sac – outre huit culottes trois brassières cinq tee-shirt quatre short un legging un coupe-vent une cape de pluie une robe pour le soir des sandales une trousse à pharmacie déchirées sur les coutures avec des médicaments pour parer à tout drame de la crème solaire et du maquillage au cas où une serviette de bain et un sac à viande Queshua – un livre de 368 pages sur l’alchimie, L’Homme rapaillé de Gaston Miron et Les Buddenbrook de Thomas Mann, qui me semble dans ce contexte être une lecture absolument indispensable. Dans le train qui nous emmène vers Strasbourg, papa me regarde l’air horrifié. Il manque de défaillir lorsque de ma poche avant j’extrais ensuite mon journal intime, un carnet de dessin, un autre de voyage, du scotch, une paire de ciseaux, un canif, une imprimante portative, et l’entièreté de mes crayons de couleur et puis bon pourquoi se priver j’avais même emporté la boîte. Sans elle, ils vont se mélanger, et j’ai passé du temps à les trier!, je louvoie. Il me dira seulement :
Tu te démerdes pour porter tout ça, je t’aiderai pas.
*
Le sac métaphorise le poids de ce que nous choisissons de transporter, autant dire notre fardeau. Au fil des années et de la pratique, j’ai appris à me dépouiller, aussi douloureux que soit pour moi l’exercice. Je continue à prendre trois livres avec moi, toujours, et continue à être surprise lorsqu’au retour je n’ai eu le temps d’en lire que vingt lignes.
La première polarité que fait tanguer la marche est celle du dedans et du dehors. Pour peu que l’on s’évade suffisamment longtemps, ou que l’on soit intentionnellement guidé par cette démarche, l’intérieur et l’extérieur s’inversent, le dehors devenant notre maison, le lieu que l’on habite ; et le dedans celui que l’on quitte, abandonné à son état de refuge transitoire.
Traverser un paysage revient à se confondre avec lui, à embrasser sa continuité et à se l’approprier lentement afin qu’ensuite il nous approprie. Il est faux de dire que pour les montagnes et la mer nous n’existons pas : au contraire, notre existence y est sans doute plus signifiante qu’ailleurs, car notre présence perturbe son vide, que nous y laissons une trace embarrassante et l’empreinte de notre passage. Un jour, sur le Dôme des Platières, je me tiens au bord d’un lac glaciaire où fleurissent des Edelweiss. Après quelques minutes d’attente immobile, une harde de chamois dégringole doucement les flancs de roche qui nous surplombent. Les cabris se donnent des coups de corne dans les brèches. Au moindre mouvement de notre part, ils fuiront – d’ici là, ils tolèrent notre souffle retenu, nous autorisent à être avec, en harmonie.
...