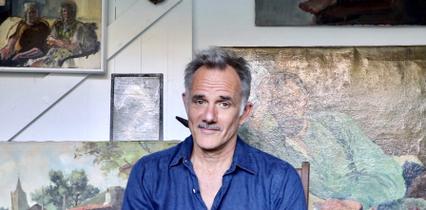Née de l’élan du collectif Othon – déjà à l’origine de documentaires et d’ouvrages collectifs – la maison d’édition Cause perdue a lancé ses premiers romans en avril dernier. Son catalogue naissant se déploie à l’intersection de l’art et de la politique, avec l’ambition de penser leurs frictions, leurs croisements et leurs zones d’ombre. Chaque texte devient ainsi une tentative de redéfinir ce que peut la littérature face aux enjeux collectifs contemporains.Yasmina Behagle est allée à leur rencontre.
Yasmina Behagle : La mainmise croissante des grands groupes sur l’offre éditoriale entraîne bien souvent une standardisation du livre. Est-ce que créer une maison d’édition était une manière de lutter contre ça ? Et dès le départ, l’idée était-elle d’allier politique et littérature ?
Stéphanie Vincent : À l’origine de la création de la maison d’édition, il y a le désir de publier des textes qu’on aime et qui ne trouvent pas d’éditeurs, et aussi des auteurices hétérogènes à la sociologie habituelle du champ littéraire – ayant moins de chance d’être publiés. Donc oui au final cela revient à lutter contre la logique de standardisation qui est forcément celle des grands groupes.
L’idée d’allier politique et littérature s’est imposée assez vite puisqu’on a toujours aimé saisir politiquement les textes, qu’on est réunis par un rapport intense à la politique comme à l’art, et parce que ça nous permettait de proposer un type de textes et une approche qui ne sont pas forcément très présents dans l’offre éditoriale, où tout ce qui relève de la réflexion politique se concentre plutôt du côté des essais. On pensait pouvoir aussi apporter par là d’autres angles d’appréhension de la politique au champ militant.
Y. B. : Comment une jeune maison comme la votre peut-elle participer à l’effort militant ? Est-ce son rôle ? Et si ça l’est, comment cela se traduit concrètement, au niveau du choix des publications, de distribution/diffusion… ?
Stéphanie Vincent : Pour prolonger la réponse précédente, participer à l’effort militant se traduit pour nous dans le fait de proposer des textes qui contribuent à nourrir la réflexion militante, en la décentrant des enjeux stratégiques ou d’action pour plutôt interroger ses soubassements, ses affects, ses contradictions. Mais concrètement cela passe aussi par le choix du diffuseur-distributeur Serendip, dont la façon de travailler résonne avec nos options politiques, par exemple en nous laissant une entière liberté de choix sur nos publications et leur nombre, en ayant le souci de faire vivre les livres sur le temps long et donc de résister à la pression infernale des flux et des rotations rapides, en travaillant avec soin la cohérence du catalogue et la présentation de chaque titre au libraire. Cela passe aussi un peu par notre façon de bricoler notre organisation ensemble et de nous présenter, par l’histoire longue de notre collectif et son origine dans le punk-rock : sans qu’on en soit forcément très conscients, on renvoie une image de l’activité d’éditeur qui peut contribuer à désacraliser un peu cette fonction et le champ éditorial.
Y. B. : Pensez-vous qu’une œuvre est politique par ce qu’elle dit sur la société ou par sa forme (en proposant par exemple quelque chose qui va à l’encontre des formes hégémoniques)?
Gaëlle Bantegnie : Si on croit profondément, comme c’est notre cas chez Cause perdue, que la politique ne se limite pas à des idées ou des positionnements idéologiques mais qu’elle relève toujours de situations réelles, concrètes où il s’agit pour un individu ou un collectif de s’émanciper de structures sociales aliénantes, alors il va de soi que seul l’art et donc la littérature peut rendre compte de cette réalité complexe. Dire que le réel est complexe revient à dire cette chose très simple que dans la réalité les idées ne sont pas séparées des affects, qu’elles ne sont pas séparées des corps vivants qui les conçoivent. Il faut donc une langue apte à saisir et exprimer ce qui se joue dans cette réalité qui charrie tout en même temps. Il est clair que qu’à ce jeu-là, l’essai conceptuel n’est pas le mieux placé puisque par sa forme, il se concentre sur les idées à l’exclusion de tout le reste.
Reste donc la littérature (l’essai littéraire, le récit, la fiction, peu importe pourvu qu’il y ait un travail sur la forme) qui doit faire face à un nouvel écueil : la langue elle-même et son incroyable tendance à se fossiliser c’est-à-dire à prendre des formes qui ne disent plus rien du réel tant l’usage (hégémonique, oui – les structures de pouvoir étant indissociables des structures langagières) en a aplati le sens. Le travail sur ce qu’on appelle la forme, revient toujours à inventer une phrase, un lexique, un mode de narration qui se tient en effet à distance de formes hégémoniques, d’abord par plaisir de s’en distinguer, mais plus simplement pour aller chercher le réel là où il se niche. En ce sens la littérature est la langue de la politique telle que nous l’entendons puisque c’est main dans la main que toutes deux s’extraient des situations et des langues instituées pour en inventer de nouvelles, par définitions singulières.
Y. B. : J’ai remarqué dans les publications mainstream que le texte politique, c’est souvent soit – si un auteur se croit un peu imaginatif – une dystopie poussive pour dénoncer les réseaux sociaux/ l’écologie /le féminisme (Devers, Koenig, Quentin), soit s’il a la flemme, une autofiction poussive pour dénoncer les réseaux sociaux/ l’écologie/ le féminisme (Beigbeder). J’en tire deux cons...