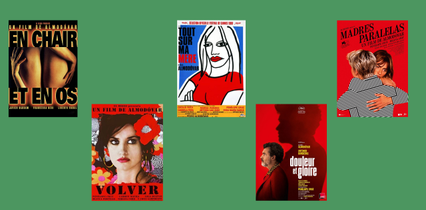Marseille ne s’est jamais cachée. Ni pour ses colères, ni pour ses vices. Depuis plus de deux millénaires, la cité se donne, rugueuse et tendre, à tous les vents, tous les corps. Portuaire et putain, elle est une ville où les draps sentent la sueur des marins et l’encens des madones. Ici, la chair s’échange comme les épices ou les cargaisons. D’un siècle à l’autre, du carré d’or à la Belle-de-Mai, la pute est une figure aussi marseillaise que le Mistral, le pastis ou la sardine que l’on pêche. À Marseille, le trottoir est aussi ancien que le quai.

Dès ses origines grecques, la ville s’installe dans un rapport lubrique au monde. Massalia, colonie fondée au VIᵉ siècle avant notre ère, est déjà un lieu de culte autant que de commerce. Dans l’Antiquité, on ne dissocie pas le sexe du sacré. Les temples d’Aphrodite sont bordés de figures féminines qu’on dit « sacrées », mais qui participent à des rites aussi sensuels que religieux. Le plaisir n’est pas honteux : il est célébré, ritualisé, parfois marchandé.
Les maisons closes antiques, si l’on peut déjà les appeler ainsi, sont signalées par des phallus sculptés à même la pierre sur les façades. À l’intérieur, on trouve des hétaïres, des courtisanes formées à l’art, aux jeux d’esprit, à la conversation autant qu’à l’art de la pipe. Certaines deviennent même des personnalités locales, écoutées, respectées. Ici, le sexe est un service, un rituel, une fonction sociale.

Marseille, ville-bordel
Au Moyen Âge, le commerce continue, moins sacré, plus brut. Le quartier du Panier, déjà, devient un haut-lieu des plaisirs populaires. Ruelles étroites, fenêtres basses, odeur de poisson, de vin et de foutre : Marseille ploie sous le désir. Les auberges des bas-fonds proposent à boire et à baiser, souvent dans la même salle. Des racoleuses aux prénoms de Saintes tiennent les murs : Sainte Pénélope, Sœur Marthe, ou la Morue de la Major.
Le Vieux-Port, lui, fonctionne comme une machine à fantasmes. On y croise toutes les nationalités. Les marins étrangers y viennent chercher la tiédeur suintante des replis féminins. Les prostituées deviennent monnaies d’échange, curiosités locales, parfois guides de fortune. Le plaisir est oral, anal, mais aussi linguistique : les valets de port développent un argot coloré, un véritable gargarisme à gonades pour désigner les filles de joie.
L’âge d’or des maisons closes
Le XIXᵉ siècle, c’est l’âge d’or. Marseille est au cœur du commerce colonial, les navires affluent, les fortunes se bâtissent, et les lupanars avec. Les établissements pullulent autour de la Canebière, à Noailles, rue Sénac, ou près de la gare Saint-Charles. On en compte plusieurs centaines, répertoriées par la mairie. Les registres sont tenus comme ceux d’un hôtel de luxe : noms, maladies, jours de repos, clients notables.
Les maisons se hiérarchisent : on y trouve la pute de palier, la michetonneuse de trottoir, la belle de salon aux faux-airs de dame. Toutes ont des regards voilés, des gestes rodés, et cette bouche fiévreuse, chargée d’un désir feint, marquée par l’attente et la fatigue, juste avant que le tarif ne tombe. Les décors vont du kitsch dégoulinant, miroirs piqués, lampes roses, moquettes grasses, à l’ambiance feutrée des lieux sélects où l’on boit du champagne tiède avant de tirer son coup.

L’illusion tient debout, maquillée comme le reste. Mais derrière les rideaux tirés et les sourires mécaniques, c’est une autre violence qui s’opère. Et dans l’ombre, la pègre s’en mêle. Paul Carbone, figure mythique du milieu marseillais, règne sur le proxénétisme local. Proche du pouvoir, il fait le lien entre le sexe tarifé, la politique et le crime organisé. Dans ses maisons, on parle plusieurs langues et on compte les billets sans trop regarder d’où ils viennent.
Marthe Richard ou l’hypocrisie légale
1946, rideaux tirés, jambes ouvertes. La fête du stupre est finie, officiellement du moins. La loi Marthe Richard impose la fermeture des maisons closes. Les devantures se ferment, les bordels sont mis au ban. Marseille obéit, en apparence. Mais la ville, fidèle à elle-même, ne change que la surface.
Les hôtels de passe prennent le relais. Les filles se dispersent dans des chambres meublées à la Belle-de-Mai, dans des arrières-cours miteuses des Réformés ou de Belsunce. Le système devient plus clandestin, moins organisé, plus dangereux aussi. On y entre par codes : un mot de passe soufflé au portier, une clef laissée à l’accueil. Les flics ferment les yeux, tant que ça reste discret, tant que le bruit ne dépasse pas les murs.
Un hôtel de passe typique marseillais ? Une enseigne minable, un escalier en colimaçon, une odeur de Javel et de fluides corporelles. Un monde à part, tapi au coin des rues, où le plaisir s’achète à la minute, et où la tendresse est un supplément.

Carnets de voyage des filles de la nuit
Aujourd’hui, la prostitution à Marseille, sœur charnelle de Babel, a muté. Elle n’a pas disparu, elle a juste changé de visage. Les talons claquent toujours sur l’asphalte, dans certains quartiers périphériques, vers les autoroutes, près des zones industrielles, à la Capelette, à la Busserine ou sur Sakakini. Rue Curiol, ce sont les travelos, souvent venus d’Amérique du Sud, qui tiennent le pavé, parfum de supermarché et perruques éclatantes sous les néons fatigués. Square Labadié, les silhouettes africaines attendent, alignées contre les murs, sacs plastiques à la main, robes moulantes, regards fixes.
On a la musique de Doc Gynéco qui résonne dans nos têtes quand on déambule entre ces tapins, aux abords des abribus. Et parfois, derrière l’Opéra, la nuit tombée, quelques ombres discrètes s’abritent dans le silence des coulisses, loin des regards. Certaines, cramées à la cam, travaillent pour payer la prochaine dose. Un cercle sordide, et pourtant, ce côté glauque en excite plus d’un. Certains ne bandent vraiment qu’à la vue des stigmates : une main maigre qui s’enroule autour d’une queue, un bras tavelé de piqûres, le sordide fait office d’aphrodisiaque.
Les « bébé » claquent en créole, les « chéri » sifflent en polonais. Des péripatéticiennes Moldaves de la patinoire, aux stations-service prises d’assaut par des roms qui vendent des passes à quelques mètres des pompes à essence ; de l’affaire des Nigérianes esclaves, marquées à vif par leur mère maquerelle adepte de pratiques vaudoues et de scarifications rituelles, Marseille connaît toutes les origines, toutes les misères, tous les trafics. D’ailleurs, la princesse d’Oradea n’est qu’une pute à Marseille.

Quelquefois, c’est un puceau timide qui vient déposer sa première fois entre leurs cuisses ; parfois, un père de famille en manque, un veuf libidineux, ou celui que ni le charme ni le physique n’aident, et qui ne peut forniquer qu’à 50 euros la demi-heure.
La ville tolère, contourne, regarde ailleurs. Même les képis se tâchent. Dans la cité phocéenne, cinq légionnaires, quatre Russes, un Ouzbek, et la compagne de l’un d’eux, Ukrainienne, se sont retrouvés sur le banc des proxos. Ils avaient monté un réseau bien huilé, qui faisait voyager les filles comme on déplace des caisses de munitions : d’une ville à l’autre, tarif unique, passe éclair.
L’affaire se fait vite, parfois, c’est entre deux pare-chocs de voiture qu’on leur love une demi-molle sous la jupe, parfois derrière un rideau mal tiré, parfois dans un appartement loué à l’heure. Parfois aussi, c’est une gamine maquillée trop vite qui tape à la vitre, pendant qu’un petit voyou l’attend.
La nuit est plus qu’un décor : elle tue. Comme ce Patrick Salameh, ogre discret condamné en 2014 pour avoir fait disparaître plusieurs femmes sous les yeux horrifiés de la Bonne Mère, la plupart prostituées. Certaines ne rentrent jamais, la rue les avale, lentement.

Du trottoir aux écrans
Mais le cœur du business est ailleurs : dans les salons de massage aux vitres teintées, où l’on achète du lubrifiant par litres, dans les applis où les escorts se présentent en photos retouchées, dans les DM sur Telegram. Le sexe est devenu digital, comme tout le reste. On commande une fille comme un Uber. On choisit, on trie, on paye par carte bancaire, on note. Mais derrière les pseudos aguicheurs, la réalité biologique ne se filtre pas. Le désir a ses revers : cystites à gogo, chtouille et autres souvenirs inflammables. Les meilleures baises d’une vie, ce sont souvent celles qui sont interdites.
La pute marseillaise 2.0 est plus libre. Moins visible, plus connectée. Elle s’annonce comme « indépendante », « expérimentée », « discrète », parfois « étudiante », souvent en galère. Elle vit dans une ville où le macadam lascif s’est déplacé sur l’écran, mais où le désir, lui, n’a jamais quitté la rue.

Sur des sites comme SexModels ou T-Escortes, l’amour se chiffre en roses. C’est plus poétique que des euros, sans doute pour mieux masquer le fait qu’il s’agit d’une transaction. Les prestations sont listées comme sur une carte de room service : fellation, rapports toutes positions, cunnilingus, annulingus, domination soft ou hard, selon l’humeur du client. Et puis viennent les suppléments, parce que même dans la luxure, il y a une option Premium : « éjac sur la poitrine » +30 roses, « fétichisme » +20, « ustensiles coquins » +50, « creampie » +80. Les refus, eux, s’appellent pudiquement « tabous ». On est dans un langage marketing qui a digéré la pornographie pour la resservir aseptisée, tarifée, prête à consommer. La plupart des annonces se ressemblent, recyclant à l’infini le même fantasme d’une femme docile et incendiaire. Le ton est toujours le même, calibré pour flatter l’ego masculin :
« Salut, je suis une bonne femme douce et très cochonne, je suis prête à réaliser tes fantasmes les plus fous, viens me rencontrer et savourer une vraie beauté, je t’attends bébé ». Une quinzaine de photos accompagne ce genre de message, comme un portfolio de mannequins en période de soldes. Tout est là pour faire croire qu’il s’agit d’un moment unique, alors que c’est exactement l’inverse.
La seconde capitale ne sera jamais une ville chaste. Elle est trop ouverte, trop portuaire, trop populaire pour ça. Trop solaire pour être pudique, trop vivante pour être prude.
Marseille est une ribaude. Elle vend son cul depuis 2600 ans, sans jamais vendre son âme. Et c’est pour ça qu’on l’aime. Salement.