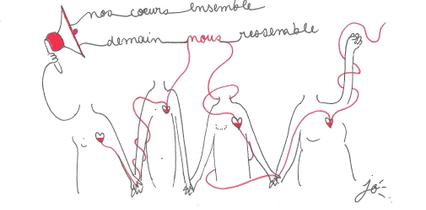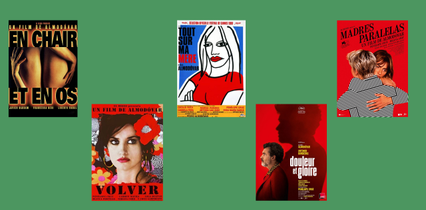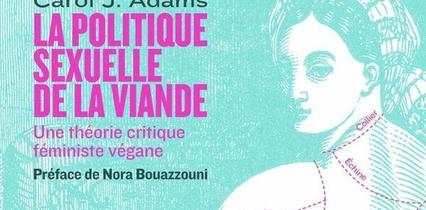Que peut la littérature quand elle ne peut ? repose sur une double affirmation : la nécessité d’écrire, de créer et d’imaginer à partir du politique, mais aussi le fait que le politique et sa prise en compte augmentent, voire permettent, la possibilité de la création et de l’imaginaire littéraire.
Sophie BENARD :Pouvez-vous développer ce double lien, ce double mouvement entre littérature et politique ?
Patrick CHAMOISEAU : Votre question nous renvoie à une distinction préalable entre « poétique » et « politique », mais d’abord entre « réalité » et « réel ».
Le « réel », c’est tout ce qui existe, que nous le connaissions ou non, et qui affecte tôt ou tard nos existences. C’est un tout-possible, inatteignable, imprévisible, parfois impensable pour notre perception limitée. Craignant le « réel », Homo sapiens s’en détourne pour habiter des « réalités », lesquelles ne sont que des conventions issues de ses imaginaires. Ces conventions lui paraissent plus stables, plus compréhensibles et plus habitables que le « réel ». Le problème, c’est qu’elles tendent à s’immobiliser sous l’effet d’une norme ou d’une force dominante.
Le « poétique » est un rapport au « réel » qui ne cherche pas à le rendre habitable. Il l’interroge, le sollicite ; il fréquente l’indicible, le mystère, l’impensable du tout-possible, et en ramène une créativité toujours renouvelée. Le poétique humain a donné naissance au chaman, au religieux, à la pensée magique. Mais c’est de ce côté qu’est venue la lignée des poètes, des artistes, des philosophes… Contrairement à la mystique inaugurale du sorcier, le poétique du poète ou de l’artiste – et donc de l’écrivain – reste alimenté par l’esprit et les découvertes de la science.
Comme le poète, les artistes – et parmi eux les écrivains – se confrontent au « réel » et en ramènent, par le biais de leurs œuvres, des saisies de matières, de formes et de forces. Ce sont des œuvres de l’art. Toute œuvre de l’art est une stimulation esthétique issue du « réel ». Quand une œuvre est puissante, elle repousse, à coups de tout-possible, les limites immobiles des petites « réalités » où reste confiné le plus grand nombre de sapiens. L’histoire des arts ou des littératures est ainsi une succession de bouleversements des fixités de nos perceptions.
L’artiste fonctionne avec une boîte à outils : sa poétique. « La poétique » est la science de la pratique des arts, mais aussi une équation esthétique propre à chaque artiste, à chaque écrivain. Dès lors, le poétique et la poétique sont puissamment « politiques », car ils transforment les « réalités » dans lesquelles nous faisons société. Ils repoussent leurs limites, leurs impossibles, leurs réductions et leurs frontières. L’art et les littératures élargissent sans cesse la conscience humaine et ses sensibilités sociétales. C’est pourquoi, comme tous les arts, les littératures sont naturellement révolutionnaires – ou mieux : révolutionnantes. Elles renouvellent infiniment nos perceptions.
Ainsi, je considère que le poétique précède le « politique », qui n’est rien d’autre que l’organisation d’une « réalité » pour le mieux-vivre humain dans le vivant. L’approfondissement de ce mieux-vivre ne peut vraiment être renouvelé que par les souffles révolutionnants qui proviennent du « réel ». Ces grands souffles bousculent nos « réalités » via les créations des grands artistes dont l’existence est purement poétique, c’est-à-dire exposée à l’extrême au « réel » et informée du tout-possible.
Tout homme politique a la charge d’administrer une « réalité ». Pour accomplir cette charge, il a recours à son imaginaire. Cet imaginaire est généralement nourri par des stimulations esthétiques, éthiques ou artistiques qui viennent de l’art, de la philosophie ou de la pensée en général. Le poétique est un mode de connaissance du « réel » qui rejoint celui des scientifiques et des philosophes. D’ailleurs, la base de la philosophie est l’étonnement et la contemplation poétique du monde.
Dès lors, une pratique artistique ou littéraire qui resterait enfermée dans une « réalité », qui n’interrogerait pas ses limites, ses normes, ses fixités ou ses impossibles, relèverait du « créatif » – parfois sympathique –, mais le simple « créatif » ne saurait être un « créateur ». Le créateur est révolutionnant : naturellement politique sans être politicien.
S. B. : Vous parlez d’un « devoir » – celui de désirer et d’imaginer un « autre monde» (un « désir-imaginant »). On comprend qu’il n’est bien sûr pas nécessairement question d’adresser directement les questions politiques, mais qu’il s’agit de penser un ailleurs possible et désirable. Pouvez-vous expliquer pourquoi il ne s’agit pas de faire de la littérature une échappatoire, mais un lieu politique – justement en se plaçant dans un ailleurs ?
P. C. : Les arts et les littératures sont naturellement révolutionnants. Ils ouvrent des fenêtres et des portes dans les bulles immobiles de nos réalités. Quand ces fenêtres laissent passer de grands souffles, l’artiste, l’écrivain, est important. Quand des littératures ne bouleversent rien de la réalité dominante, leurs fenêtres ne laissent passer que peu de choses : elles ne méritent alors ni égard ni patience, comme l’aurait dit René Char.
L’écrivain majeur nous ramène, du fond des impensables du réel, un renouvellement profond de la perception que nous avons de nos situations existentielles, du monde et de l’univers. Il nous aide à penser autrement, donc à être créateurs.
Créer, c’est l’essence même de la condition humaine. Toutes les dominations limitent l’esprit de création. Le capitalisme a desséché nos imaginaires : il a fait de nous des données économiques et des consommateurs. Notre seule alternative est d’imaginer un autre monde, de nous exposer sans cesse à des stimulations esthétiques qui renouvellent les bases immobiles de notre esprit. Ces stimulations nourrissent l’imagination et l’imaginaire, donc notre capacité à créer le monde dans lequel nous pourrons vivre au plus près de la Beauté. C’est la plus radicale des oppositions à toutes les formes de domination.
S. B. :J’ai l’impression que vous...