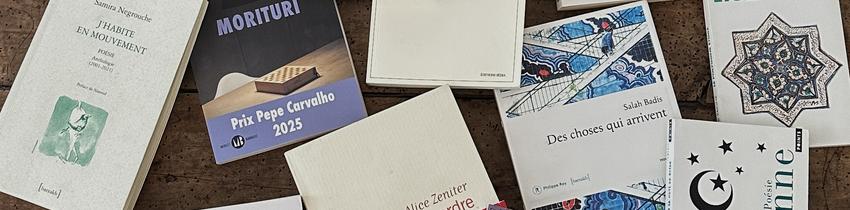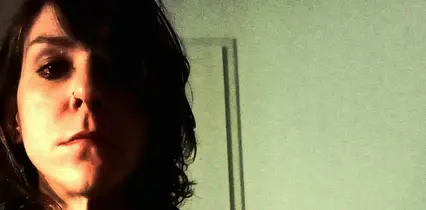On la croise en manifs, dans les AG du collectif des Travailleureuses de l’art 13, au détour d’une exposition ou encore sur les réseaux sociaux. Artiste, performeuse, réalisatrice de films X, syndiquée au SNAP-CGT et militante féministe, Robyn Chien jongle avec plusieurs casquettes. Diplômée de la Haute École des Arts du Rhin, elle prodigue de précieux conseils sur le travail et rend sexy le syndicalisme ! À travers ses performances et ses vlogs, elle nous embarque dans son quotidien et laisse apercevoir l’envers du décor, les moments d’apprentissage et de doutes, les préparations des réunions et la joie du partage avec ses collègues d’atelier. En somme, tout ce qui est habituellement invisibilisé dans le travail artistique. À l’occasion du 10 septembre, entretien fleuve avec notre It-girl révolutionnaire préférée.
Luce Giorgi: Aujourd’hui, ta production artistique semble intrinsèquement liée à la notion du travail. Je pense notamment à ta vidéo Lullabyebye a peur pour son cul (2019), mais également à ta performance-vlog We are done ! Vraiment? J’ai rompu avec l’art contemporain, et voilà ce que j’ai fait pour aller mieux (2025), dans lesquelles tu questionnes à chaque fois le contexte de création et de monstration du travail, qu’il soit pornographique ou artistique. Comment les sphères artistique et militante ont fini par s’entremêler dans ta pratique? Est-ce que c’est quelque chose qui a toujours été présent ?
Robyn Chien: Assez tôt, ce qui était très présent dans ma vie et dans ma pratique artistique, c’était la valeur de justice. Je voulais faire quelque chose d’utile, mais j’ai mis du temps à me définir comme militante. Dès l’enfance et durant toute ma scolarité, j’ai été dans des luttes collectives, mais c’est seulement avec le syndicalisme que j’ai accepté cette « casquette ».
La question du travail est arrivée après l’école d’art. Au début de ma pratique, il y avait quelques prémices, avec les notions de collectif, de commun ou de vivre-ensemble – qu’on retrouve aujourd’hui dans mon obsession pour le communisme (rires). Mais c’était une approche plus expérimentale et moins matérialiste.
En école d’art, on nous apprend à nous désaliéner du travail, alors que la première chose que l’on doit faire en tant qu’artiste, c’est de devenir une entreprise et de s’inscrire à la CFE (Centre des Formalités des entreprises). Je trouvais ça contradictoire. Avec ma société de production Puppy Please, co-fondée avec Lullabyebye et Gordon B. Rec, j’ai vraiment embrassé cette idée d’entrepreneuriat. On a été accompagné par un organisme d’aide à la création d��’entreprise (BGE), qui nous a aidé à penser un business plan, une stratégie marketing, etc. Je trouvais ça très drôle de faire tout ça pour une boîte de porno.
C’est à cette période et à travers les luttes des travailleureuses du sexe que j’ai découvert le syndicalisme. Mon associée Lullabyebye était elle-même syndiquée au STRASS (Syndicat du travail sexuel). Il y a énormément de ponts à faire entre travailleureuses du sexe et travailleureuses de l’art. D’ailleurs, en tant que travailleureuses de l’art, on s’est beaucoup inspiré du vocabulaire des travailleureuses du sexe.
L. G.: Est-ce qu’être syndiquée a modifié ta manière de faire de l’art ?
R. C. : Je conçois l’art comme un outil pour comprendre le monde. Ce qui me passionne, c’est de découvrir ce qu’il y a derrière mes a priori. L’art m’a d’abord permis de comprendre la fabrication des films pornographiques et de déconstruire l’idée violente ou sexiste que l’on peut s’en faire. Puis, de mieux comprendre mon expérience du syndicalisme. Au départ, je me suis investie au SNAP-CGT (Syndicat national des artistes plasticien·nes) de manière assez dissociée avec mon travail artistique. Ensuite, ça a pris une grande place dans ma vie et, de fait, dans mes œuvres, car j’y raconte mon quotidien.
Pendant longtemps, pour moi, la CGT, c’était Philippe Martinez (ancien secrétaire général de la CGT), la grosse moustache et la personne salariée. Alors que ce n’est pas juste ça ! Mais il me manquait une « influence syndicale », pour reprendre des termes d’Instagram. En intégrant le SNAP, j’ai eu besoin de construire une image du syndicalisme qui me ressemble et de me rattacher à des luttes qui m’inspirent, comme celles des femmes de chambre de l’Ibis Batignolles, des travailleuses du sexe aux Etats-Unis ou encore des scénaristes de Emily in Paris.
La majorité du syndicalisme communicationnel, ça va être du discours, du meeting, de la prise de parole ou des tracts. Avec les vlogs, j’avais envie de médiatiser les petites actions et de documenter le quotidien d’un syndicat : faire un compte-rendu de réunions, le bilan comptable, chercher des clefs, récupérer des banderoles au fin fond d’une salle à la Bourse du travail ou vivre une illumination en AG… J’en ai marre qu’on dise que le syndicalisme c’est chiant et épuisant. C’est aussi un endroit qui apporte beaucoup de joie et de savoirs !
Dans ma performance Unionise your life, je termine en disant que la CGT, ce n’est pas parfait. Il y a plein de choses avec lesquelles je ne suis pas du tout alignée. Mais globalement, si j’ai envie d’être utile, c’est plus efficace de se syndiquer que de faire une œuvre « politique ».
L. G.: Dans ton dernier vlog « doutes », tu questionnes ton adhésion à « l’art contemporain », entendu comme système, avec ses contextes de production et de diffusion, dans un monde capitaliste où les artistes-auteurices n’ont pas encore accès à la continuité des revenus. Est-ce que tu dirais pour autant que ta pratique s’approche d’une critique institutionnelle ?
R. C. : Je m’en sens proche. D’autant plus que, dernièrement, j’ai été invitée par Camille Martin pour faire une performance dans le cadre de sa résidence curatoriale la Maison Populaire de Montreuil. Dans sa programmation, elle met en parallèle le monde du catch et la critique institutionnelle. Pour autant, je m’en éloigne au niveau de l’esthétique. On se fait souvent une idée de la critique institutionnelle comme quelque chose de froid, sérieux, voire intello et distancié. Ça ne me correspond pas à 100%.
J’ai plutôt l’impression d’avoir le cul entre plusieurs chaises : je me retrouve dans les milieux de l’art contemporain, de l’entreprenariat et du porno, sans pour autant dire qu�’il y en ait un mieux que l’autre. Ces trois milieux fonctionnent comme une critique institutionnelle de l’un ou de l’autre.
Dans mon travail, il n’y a pas de parodie ou de cynisme. Je joue avec les codes. Quand je fais la performance Ce qu’il vous manque pour monter votre boîte de production X, j’arrive comme une coach business, en essayant de transmettre véritablement tout ce que j’ai appris dans la pornographie. Seulement, au fur et à mesure de la performance, les gens comprennent que ce qu’il leur manque, c’est de résoudre le conflit des Sex Wars (conflit qui oppose les pro-sexe et les abolitionnistes) et qu’il faut se syndiquer, faire la révolution et changer le monde ! C’est pousser le raisonnement jusqu’au bout.
L. G. : Sur tes réseaux sociaux, tu engages un dialogue avec le public, qu’on pourrait rapprocher d’une vulgarisation. Tu utilises ces plateformes afin de diffuser des informations et des outils pour se structurer en tant qu’artiste-auteur·ice. Quel est ton rapport à la transmission ?
R. C. : Le monde de l’entreprise s’interroge beaucoup sur « les besoins des client·es » et comment y répondre. En art contemporain, parfois, chez les artistes, il n’y a aucune conscience du public… Personnellement, j’ai aussi une formation de médiatrice culturelle. Je me pose donc beaucoup la question de l’adresse et du contexte.
Dans mes œuvres en général, j’envisage toujours le rapport au public comme une conversation. Je n’écris pas une performance de la même manière quand je vais à La Flèche d’Or ou à la Maison Pop, quand je m’adresse à un public de camarades, d’artistes ou de personnes que je ne connais pas. J’ai l’impression que c’est du bon sens.
À chaque fois, je fais l’effort de définir les termes que j’emploie. Dans chaque domaine, on a un jargon spécifique. Je trouve ça important d’expliquer ce qu’on entend par tel ou tel terme. C’est un exercice de transmission et de traduction. Et faire des définitions, c’est aussi l’occasion de faire des blagues !
L. G. : Dans tes vlogs, tu te mets en scène en train de lire ou de raconter facecam un documentaire que tu as vu récemment. En t’écoutant, j’ai parfois l’impression que tu nous proposes un arpentage à faire avec toi. Peut-on inscrire cette démarche de partage de références dans le sillage de l’éducation populaire ?
R. C. : L’éducation populaire, ça me plait bien ! Le fait de transmettre au fur et à mesure que j’apprends, c’est une super parade contre l’idée d’expertise. Les gens qui se positionnent comme « expert·e » de tel ou tel sujet, ça a tendance à me tendre. Dans mes performances, je partage souvent la courbe de Dunning-Kruger (schéma qui montre que les personnes les moins qualifiées ont tendance à se surestimer). Avec les vlogs ou les stories sur Instagram, je peux interagir avec le public et venir me corriger ou ajuster mon propos. C’est encore et toujours une conversation.
L. G. : Dans ta pratique, on distingue deux esthétiques complètement différentes : une esthétique de l’entreprenariat à base de carte de visite, de powerpoint ou de vision boards, où tout est lissé (même si tu le rends pop à ta manière) et une esthétique DIY ou amateure, qui rejoue les codes du documentaire en prise directe, réaliste et sans artifice (bien qu’il y en ait toujours). Dans ton film Éva et le Merkabas (2024), qui se présentecomme un «behind the scenes» d’un film porno, il y a une conversation entre l’actrice Éva (Lullabyebye) et la médium du plateau, le Merkabas, à propos de la « vérité » et de la simulation : faire semblant de jouir vs faire semblant d’entendre les esprits. Comment expliques-tu cette oscillation constante entre la « vérité» et la fiction ?
R. C. : J’ai l’impression que c’est le résultat d’une tension entre les désirs et ce qui est faisable. Sur Instagram, dans les vlogs ou dans les films pornos, je vise toujours des formes hyper mainstream. J’aimerais faire des blockbusters ou que mon compte ressemble à celui d’une entrepreneuse à succès. Mais concrètement, je n’ai pas le budget pour. Toutes mes vidéos sont filmées avec mon téléphone, donc dès qu’il y a un coup de vent, ça se barre. C’est aussi ça la vie : on a parfois une idée, et ensuite quand on fait, c’est un peu à côté. Le réel intervient et ce n’est pas parfait.
Par rapport au documentaire, j’expérimente aussi cette forme à travers les vlogs. En même temps, je les filme comme des fictions. Je me vois comme une personnage, que je construis. D’ailleurs, je travaille avec un pseudo et ma carte de visite, c’est une moi miniature. Dans l’art contemporain, on parle de docu-fictions. Mais dans la pornographie, on utilise le terme de « pro-am » ou « pro-amateur ». C’est un style à part entière, qui joue une esthétique amateure, dans une industrie professionnelle. Ce côté pro-amateur, ça correspond bien à ma pratique.
L. G. : Qui dit pornographie et militantisme, dit souvent censure. Au cours de ta carrière, est-ce que tu y as déjà été confrontée ? Comment se matérialise cette censure et quels effets cela a sur ton travail ? Et quelles stratégies sont mises en place pour l’éviter ou la contourner ?
R. C. : Lorsqu’on commence sa carrière avec le porno, en tant qu’artiste, on pose tout de suite la question de ce qu’on peut dire et de ce qu’on ne peut pas dire. Certaines curateur·ices qui m’invitent peuvent être enthousiastes à l’idée de parler de pornographie, sans directement prendre la mesure de ce que ça implique par rapport au public ou à leurs partenaires financiers. Ou ce que ça donnerait si le·a maire·sse assiste au vernissage ! Je me méfie toujours des cartes blanches ! Même si un grand nombre de personnes consomment de la pornographie, politiques y compris, ça reste un sujet dont il est difficile de parler ouvertement.
Donc oui, il y a des censures dans des lieux d’art. On peut me demander également de mettre des warnings et des –18 partout, en raison des politiques de protection de l’enfance. Ça rejoint la question de la médiation et de notre rapport au public : comment on montre les œuvres, dans quel contexte et de quelle manière on en parle ?
Cependant, à mon sens, la censure la plus importante, c’est la censure économique. Aujourd’hui, le secteur culturel fait face à une censure à grande échelle, avec des coupes budgétaires drastiques. Et ces décisions gouvernementales impactent très fortement des personnes précaires, qui subissent déjà par ailleurs des discriminations, du racisme, du validisme, du sexisme, etc. C’est ça, la vraie réduction du champ d’expression.
L. G. : Ces derniers mois, nous avons eu la chance de voir se constituer partout en France des assemblées générales “Cultures en lutte”. Intersyndicales et intersectorielles, elles ont rassemblé des travailleurs.euses autour de revendications anticapitalistes, antifascistes et intersectionnelles. Quel peut être le rôle des artistes dans les luttes sociales et politiques actuelles ?
R. C. : Cette année, il y a des lieux d’art et des artistes, qui se sont mis·es en grève. C’est historique. Jamais auparavant les artistes ne s’étaient perçu·es comme travailleureuses au point de réfléchir à comment se mettre en grève collectivement et à le revendiquer. Ça s’inscrit dans un mouvement plus global.
Les artistes, en tant travailleureuses, je pense qu’on a une énorme responsabilité. Malheureusement, on représente le modèle parfait du travailleur libéral, qui travaille de manière passionnée, gratuitement et en étant ultra flexible. Moi j’ai envie de participer à changer l’image de ce type de travailleur, qu’on s’organise collectivement et qu’on pense des enjeux de mise en commun. Réseau Salariat prend pour modèle les travailleureuses intermittent·es et les rapproche d’enjeux comme la sécurité sociale de la culture. Donc venez, on se retrouve le 10 septembre et les jours suivants, dans la rue !
L. G. : Pour les lecteur·ices de Zone Critique, un conseil de lecture ?
R. C. : Un désir de communisme, de Bernard Friot et Judith Bernard, publié aux éditions Textuel.