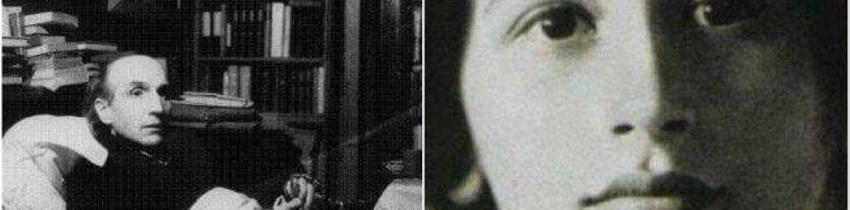La philosophie française
La philosophie française est une pâture que mit en jachère le génie de Descartes, et à quoi l’intuitif labeur de Bergson ne sut point rendre sa fertilité ancestrale, égarée, durant le petit siècle qui fit suite au Grand, parmi les stériles sillons tracés par l’araire ravageur que prirent les Lumières pour le grand véhicule du Progrès. La terre fut fendue mais ne fut point retournée ; et il y eut alors, pour les veaux et les cochons, un long double siècle de pacage exclusif, au lieu même où les aigles et les taureaux, naguère, tenaient d’altissimes conciliabules. Le sarcloir français, au temps des perruques pulvérulentes, puis au temps des révolutions, était de bois : le fer puissant et rigoureux fut à la France confisqué par les Germains qui firent, dans de perverses directions, des merveilles immenses ; l’exigence de l’intelligence était alors teutonne, et si l’on n’orait plus, l’on avait pour les labeurs de la pensée un sérieux vertigineux. Par suite, au siècle des occidences ultimes, la France à sa déliquescence trouva d’onctueux délices et s’y laissa glisser en provoquant même à la pousser aux abîmes les mille secondes petites mains de la Sophistique, entortillée toute dans un voile d’Isis acheté chez Cache-Misère. La Sophistique prit alors l’Insignifiance par le bras, et les manigances d’entremanificence purent commencer pour sembler ne vouloir cesser jamais. Quelques-uns, pourtant, s’extirpèrent de cette contredanse macabre : ils furent une petite quinte diminuée à n’être pas ensorcelés par les prestiges luxueux et luxurieux de l’ère nouvelle où Satan induit le bal en incessantes tentations.

Parmi ceux-ci : Pierre Boutang, métaphysicien de premier ordre lorsqu’il ne laissait pas son attention s’égarer hors des sentiers pensifs pour livrer ses mains à la quincaille des politiquailleries qui lui furent toujours séductrices. Esprit exubérant, trop souvent touffu pour n’être pas confus quelques fois, Boutang n’était pas homme à laisser en friche la pensée française ; mugissant, il se fit fort de transformer en une épaisse forêt cette varenne vaste où la canaille venait chercher charognes. Au mitan du vingtième siècle, tandis que l’Allemagne exprimait discontinûment des penseurs irremplaçables, Heidegger, Schmitt, Jünger, la tâche impressionne qui fut celle que s’octroya Boutang : penser. Non point, comme s’en gorge le temps des essais, penser ceci ou penser cela, donner ici ou là son étroit avis sur maintes incidences ; mais tout au contraire entreprendre d’honorer à proportion de son insistance l’originelle dimension où l’homme se tient, dont tous s’acharnent à devenir maîtres en s’efforçant d’offusquer son évidente antécédence. L’homme est convoqué à penser, plus impérativement encore que ne le furent aux noces de leur prince les vassaux de ce roi dont le Christ fait une parabole, car ceux qui refusent au festin de l’esprit leur présence sont plus que morts in tenebras exteriores, – vivants horizontaux, bétail poussif au lieu d’être pensif.
L’Origine et le secret
Pierre Boutang était un métaphysicien de premier ordre lorsqu’il ne laissait pas son attention s’égarer hors des sentiers pensifs pour livrer ses mains à la quincaille des politiquailleries qui lui furent toujours séductrices
Le souci de l’origine, constant chez Boutang, doit être compris comme celui du lieu d’où provient (orior) l’homme – non point sa cause mais son Principe bien plutôt, ce lieu in principio dont parle la Genèse, et dont le précédent empire absolu sur l’homme le fait pensant ; capable donc d’une certaine distance avec le monde alentour, qui fasse apparaître celui-ci comme tel. L’origine dit à la fois la provenance de l’homme, et la présence permanente de cette provenance à son âme qui lui ouvre l’horizon de sa propre activité, comme le soleil, lorsqu’il surgit à l’Orient, illumine soudain l’horizon tout entier et lui offre d’exister. Orior : tout ensemble « naître » et « sortir de », qu’il faut prendre ici au sens le plus littéral, car l’homme, naissant au monde, en sort par-là même ; et lorsqu’il se comprend dans le monde, il doit immédiatement s’admettre en quelque façon hors du monde, puisqu’il se trouve capable de mettre ce monde à distance et de le nommer, de se le représenter, c’est-à-dire lui conférer une certaine présence en son esprit qui se fonde et se construit sur son absence, en tant que tel, en ce même esprit. Pour que le monde puisse être, par représentation, présent en mon âme, il faut bien que cette présence emplisse un lieu d’où toute réelle présence du monde est exclue ; il faut bien, en d’autres termes, que l’être et la pensée ne se confondent point, pour qu’en l’une puisse se donner l’autre sans l’envahir. L’être se donne à la pensée, disons-nous : c’est inexact, et il conviendrait de dire plutôt que les étants, tout d’abord, se donnent, s’abandonnent et se donnent en bandes, à la pensée qui ne vit que de cette surabondante pitance dont pourtant, c’est son mystère, si elle se laisse parfois déborder, elle demeure distincte – et c’est par même cette distinction qu’elle se définit au premier abord. L’être lui-même, au contraire des étants, a pour acte premier, lorsqu’on le considère depuis l’étroit promontoire de notre âme, de se tenir en retrait, de s’obombrer dans l’illumination des choses qu’il produit à l’existence.
L’être lui-même, au contraire des étants, a pour acte premier, lorsqu’on le considère depuis l’étroit promontoire de notre âme, de se tenir en retrait, de s’obombrer dans l’illumination des choses qu’il produit à l’existence.
Telle est la plus certaine fondation du maître ouvrage de Boutang, l’Ontologie du secret, quête initiatique de « l’être tel qu’il se cache et se montre dans le secret ». Tel qu’il se cache, puisque l’être ne fait jamais que transparaître un étant ; tel qu’il se montre, puisque l’âme partant à sa recherche le doit bien deviner, de quelque façon que ce soit, en son absence explicite, toute pleine de sa présence tacite – sans quoi la pensée ne se mettrait en marche jamais. Or la pensée est toujours déjà en marche, car pour elle, tout voyage est toujours, semblable à celui d’Ulysse, un retour à l’Origine, laquelle est à la fois derrière et devant elle, avant et après elle : son origine, c’est la source de son être, qui la provoque à cheminer toujours plus loin, jusques à ses propres extrémités, et celles du monde, là où la suréminente fin coïncide avec le Principe archiprécédent. L’âme pérégrine qui suivrait Boutang au long de l’Ontologie finirait par avec lui découvrir un précis secret primordial, « analogue à celui d’Ulysse, son maître, reconnaissant une terre natale qu’ingrat, ou par quelque providence divine, il avait crue étrangère quand il y aborda ». Cette terre natale est celle où l’enfant que tous nous fûmes s’émerveillait en face des choses, et par-là même de leur faire face ; celle où cet enfant demeurait interdit « devant la consistance, la solidité des choses » (La Politique considérée comme souci), devant la consistance d’une présence, d’un être-devant incontestable qu’il accueille en la nommant – qu’il recueille donc au sein de son langage en lui offrant, tout d’abord, une place absolument singulière, celle d’un nom propre, qu’aucune autre chose, avec celle-ci, ne peut ni ne doit partager.
Le nom des choses
L’on considère parfois que nommer une chose ou un individu, c’est l’appeler, mais cela n’est pas exact, car l’on nomme bien plutôt afin de pouvoir ensuite appeler telle chose ou tel individu ; et nommer signifie donc, bien plus, une réponse par nous donnée à l’appel des choses elles-mêmes. Ainsi, le nom que l’enfant donne aux objets qui l’entourent est-il manière de réponse donnée par ces objets eux-mêmes aux naïves et natives questions qu’il leur pose. Nommer, cet « acte qui laisse intacte la chose, mais la prend cependant, la soutient dans le nom » (ibid.), c’est poser à la fois la présence de la chose en ma pensée, et son absence radicale pourtant, comme le savait bien Mallarmé : « je dis : une fleur ! et, hors l’oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d’autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l’absente de tous bouquets ». Nommer, c’est prendre et laisser tout à la fois, selon les termes de Boutang, c’est littéralement comprendre sans confondre. Ainsi, dans l’expérience enfantine du langage, dans l’expérience enfantine de la présence des choses, se tient tout entier, déjà, l’événement qui conduit l’entreprise de Boutang dans l’Ontologie du secret : penser, c’est penser tout d’abord notre propre possibilité de penser, c’est-à-dire une certaine manière de retrait de l’être derrière les choses qui sont, de sorte que la pensée trouve place où déployer sa propre présence. L’être, d’une certaine façon, laisse à la pensée une place, qui n’est point celle du pur et simple néant puisque, de toute évidence quoique sur un mode singulier et peut-être éminent, la pensée est. Retour à l’origine en maint sens, donc, et certes en ceci que toute œuvre philosophique d’importance est toujours une reprise de ces questionnements originels, car l’originel seul est toujours original. Ou plutôt : toute haute entreprise philosophique en est souventefois une simple reprise, lors qu’elle devrait au contraire se laisser par cette origine reprendre, car l’origine ne mérite point son nom qui se livre en pâture aux êtres qui en surgissent.

Le platonisme de l’enfance
Le Logos chrétien de Boutang, contrairement à l’Esprit absolu de Hegel, laisse aux choses leur propre luxe, comme un don plein et entier qui est, par définition, offert à la complète jouissance de celui qui le reçoit, dans l’effacement du donateur.
Boutang ne l’entend certes pas de cette oreille pour qui, comme pour Heidegger, l’être demeure toujours en son propre secret, en sa propre réserve, et ce secret se définit même, selon l’auteur d’Être & Temps, comme « die verbergende Bewahrung des eigentlichen Seyns » (« la sauvegarde qui réserve l’être authentique »). L’être, en livrant les étants, se pré-serve en lui-même, et réserve ainsi un lieu où la pensée se peut, en elle-même, retrancher afin que de pouvoir « peser » (car peser et penser sont d’identique origine) les choses comme elles sont, et là où elles sont. Si l’être illustrait les choses de sa pleine lumière, toute chose serait opaque, comme se manifestent obscurs quelques objets qu’un trop brillant soleil éclaire par derrière ; tout au contraire les doit-il laisser luire de leurs propres clartés, c’est-à-dire de leurs propres formes. Le Logos chrétien de Boutang, contrairement à l’Esprit absolu de Hegel, laisse aux choses leur propre luxe, comme un don plein et entier qui est, par définition, offert à la complète jouissance de celui qui le reçoit, dans l’effacement du donateur. Le secret de l’être garantit donc l’intelligibilité des choses – c’est-à-dire leur visibilité pour l’intellect dans leur forme, ou leur εἶδος, selon le très-célèbre lexique platonicien que Hegel, d’ailleurs, retrouvera à la fin de sa Logique pour définir le Concept ayant atteint l’acmé de son interne déploiement, avant que de s’exprimer tout entier dans son Autre, la Nature. L’Idée absolue, dit le §237 de l’Encyclopédie, n’a en elle « aucune déterminité qui ne serait pas fluide et transparente », car elle est « la forme pure du concept, qui intuitionne son contenu comme elle-même ». Pourquoi une telle congruence en un lieu d’une telle importance ? Pour cette raison que l’Idée absolue est le moment de la parfaite visibilité du Logos à lui-même, en lui-même ; or, εἶδος, c’est le verbe εἴδω, qui signifie à la fois « voir » et « se montrer », à la fois le regard qui voit, et l’objet qui se rend visible au regard – ce qu’est, en soi-même, l’Idée absolue, tant à elle-même translucide qu’il lui faut extérioriser son opacité dans la Nature, afin que cette transparence ne signe pas la mort de tout ce qui est à voir. De même, chez Platon, l’Idée n’est autre que la visibilité de la chose par l’intellect, elle est ce en quoi la chose se fait donnable à l’esprit ; ou plutôt : ce en quoi l’intelligence peut aller lire (inter-legere) le sens ou la vérité de la chose. Car, comme le constate amèrement la conscience à l’orée de la Phénoménologie de l’Esprit, les choses glissent et échappent aux prises de la pensée lorsqu’elle les veut saisir en leur seule consistance immédiate, ou pour mieux dire : dans leur singularité immédiate et matérielle. Ce n’est pas que l’intelligence les peut voir, ou les peut regarder – car précisément échappent-elles toujours à cette prise en garde pensive lorsque celle-ci tente d’accrocher ce que l’hylémorphisme nommera leur matière, laquelle est occulte à l’esprit.
Or, Boutang croit à un certain « platonisme de l’enfance » (La Politique considérée comme souci), une originelle intuition de l’existence de ces idées, de ces formes que malhabilement l’enfant, en ses premiers babils, tente d’apercevoir : lorsqu’il nomme, il répond ingénument à l’adresse qu’est toute chose en son existence même, à cet appel d’être que lance à toute pensée l’existence d’une moindre chose. Le nom, signe d’une idée, retient la chose, la con-tient plutôt et l’empêche d’échapper absolument à l’esprit qui la reçoit en lui et prend garde à elle : tel arbre peut ensuite bien disparaître, « arbre » demeure tel qu’en lui-même, au creux de l’âme qui le prononce. Voici l’existence : l’arbre qui naît, croît et meurt ; voici l’essence, ou l’idée : l’arbre qui jamais ne change, pareil à soi, dormant seulement en sein même de l’existence jusques à la provocation de ma voix qui l’en fait surgir et répandre sur les choses muables les splendeurs scintillantes de l’Éternité. « La parole, pas en tant qu’elle est elle-même un paraître, avec ses syllabes successives et rarement à l’image des moments de l’apparition visée, mais comme intention une, et détermination, tend, et pré-tend à coïncider avec ce qui, dans la chose même, n’échappe plus, ne glisse plus, la « vérité » de son « essence »… : ἀληθής, ce qui n’échappe plus, ἀσφαλής, ce qui ne glisse plus », écrivait Boutang dans l’Ontologie du secret. Contre l’étymologie heideggérienne, ou plus profondément, plus originellement qu’elle, Boutang ne veut pas entendre dans l’alètheia des grecs le seul non-voilement, mais le non-glissement – une eau, ou des grands de sable, qui cesseraient enfin de s’écouler entre les doigts d’une main naguère impuissante à les colliger. L’εἶδος, c’est la chose qui n’échappe plus ; c’est donc la chose comprise par la pensée, qui la tient enfin devant soi, fermement, par le bout que l’on dit intelligible puisqu’il est, dans la chose même, ce que voit et re-garde la pensée.
Il y a dans le monde des Idées un jeu d’ombres et de lumières qui obligeait déjà Platon à d’infinis raffinements, lorsqu’il méditait dans le Parménide et le Sophiste, éminemment, le rapport de l’intelligible au sensible.
Pourtant, dans l’idée même, l’être se cache, tandis que se manifeste la vérité de la chose, sa forme : lorsque s’exhibe ce qu’est la chose, son être se dissimule, et Platon doit reconnaître au-delà des Idées un Archétype singulier qui, à elles également, donne d’exister… « Forma tamen potest dici quo est, écrit saint Thomas d’Aquin, secundum quod est essendi principium ; ipsa autem tota substantia est ipsum quod est » (Contra Gentiles, II, 54) : la forme est principe de l’être, certes, en ce sens que rien n’est sans avoir une forme – autrement dit : rien n’est sans être quelque chose – mais ni la forme ni la matière ne sont une chose existante, car la substance seule, complète, est « ce qui est » ; substance entendu ici au sens d’un existant, d’une matière singulièrement informée. Il y a dans le monde des Idées un jeu d’ombres et de lumières qui obligeait déjà Platon à d’infinis raffinements, lorsqu’il méditait dans le Parménide et le Sophiste, éminemment, le rapport de l’intelligible au sensible. En arrière de la compréhension d’une chose dans sa forme, l’être s’écarte et se discerne : il demeure en son secret, et ne s’expose ni dans la pure essence formelle, ni dans la pure existence matérielle. L’être, dit encore saint Thomas, n’est ni la forme ni la matière, « sed aliquid adveniens rei per formam » (De Substantiis…, ch. 8). La forme est ce qui advient à la matière et, seule, lui permet de participer à l’être en acte « secundum proprium » ; c’est-à-dire de participer à l’être qu’elle n’est pas, mais qu’elle possède seulement, par son acte propre, – car si tel n’était pas le cas, l’être ne se donnerait point aux choses mais au contraire les envahirait de sa puissance et les finirait par confondre complètement en sa propre surabondance substantielle. La notion de participation des étants à l’Être même est au prix d’un secret toujours gardé de cet Être qui se doit d’être à la fois présent et absent aux choses qu’il soutient en leur existence : telle chose est parce qu’elle participe à l’Ipsum esse subsistens, selon une formule de saint Thomas, mais cette même chose est bel et bien, et son existence doit être, de quelque façon, sa propre existence, sans quoi la pensée n’aurait à faire qu’à des fantômes, et les Idées n’éclaireraient plus que d’indistinctes parcelles d’un Être exclusif de toute existence, semblable à ce voile tendu sur toute chose qu’évoquent les protagonistes du Parménide de Platon, pour immédiatement rejeter pareille métaphore.
Du Parménide à Parménide

La « révélation » au Parménide historique et non plus platonicien est prétexte à l’exposition, enfin, du cœur même de la pensée de Boutang, qui s’appuie là sur le huitième fragment du Poëme parménidien, fort long, dont je cite quelques vers dans la traduction de l’auteur :
« Même est penser et ce avec le consentement de quoi est le penser ;
car sans l’étant, en quoi il se trouve comme parole déjà prononcée,
tu ne découvriras pas le penser.
[…]
Par quoi tout est du nom,
de ce que les mortels ont établi, persuadés que cela ne s’échappe point,
le devenir et le se perdre, l’exister ou n’exister pas ».
Intéressante à plus d’un titre, cette traduction désigne, dans une langue rugueuse assez pour épouser toutes les inflexions hellènes sur quoi l’auteur veut attirer l’attention de son lecteur, rien moins que l’entrelacement originel de l’être et de la pensée qui fut révélée à Parménide : c’est le sens de l’identité archaïque de l’être et de la pensée (le « αὐτὸ » du fragment plus haut cité) qui se dévoile en ces quelques vers. La pensée, affirme Parménide, se trouve toujours déjà dans l’étant (ἐόντος) comme une « parole déjà prononcée » glose Boutang, tandis que le texte grec dit en sa lettre exacte : « en quoi il est énoncé » (ἐν ᾧ πεφατισμένον ἐστιν). Cette prime périphrase est une manière, pour Boutang, d’insister sur la primauté de l’être où se tient toute parole avant même que d’être entendue, puis répondue, par une âme agissante au sein de l’étant. « Parménide, écrit-il, sait donc que la pensée n’est pas saisissable hors d’une « parole », et que cette dénomination originelle se fait dans l’étant, que le λόγος dit l’être de l’étant » (Ontologie du secret), avant d’ajouter, au même endroit, que « nous savons la « liberté » de l’être qui « consent » à être pensé à travers le λόγος, et toutes les déterminations conceptuelles doivent être d’abord référées à ce pouvoir de l’être ».
Logique du secret

Aux confins maintenant de ce secret de l’ontologie, ou de cette ontologie secrète, Boutang retrouve, somptueux et patient, qui semblait toujours l’attendre et tendre vers lui son âme ambulante, le mystère de l’Actus essendi, tel que seul le formula saint Thomas d’Aquin. Une autre révélation couronne celle, naturelle, de Parménide : la Révélation du Nom divin par excellence, Celui qui est, faite à Moïse au sommet du Sinaï ; Révélation qui vient, d’une certaine façon, confirmer en première personne les intuitions de Parménide, et qui eût sans doute comblé son désir bien au-delà des lieux païens où ses cavales le transportent, galopant sur la voie de la divinité. Plus loin, et plus haut, et plus obscur encore, que le secret de l’être, il y a le secret de Dieu, le secret de l’Ipsum esse subsistens, l’être compris non plus en son rapport intime avec l’étant, mais en lui-même seulement, au cœur de sa subsistance singulière et absolue, que l’intellect eût été incapable de même entrevoir si cette Subsistance n’était venue se dire à lui, ’entrouvrir à ses yeux infirmes, – bref, si cet Être n’avait pas toujours déjà pensé à lui, et pensé vers lui, comme Dieu, du milieu de Son buisson ardent, appelle Moïse puis lui révèle Son Nom le plus propre. Dieu S’énonce et à l’homme Se prononce ainsi : sum qui sum, je suis qui je suis, ou je suis Celui qui est, ce qui revient au même. Dieu Se révèle en Sa toute précédence à l’homme qui lui demande son nom ; à cette provocation innocente de Moïse, Il répond et déjà, bien avant de Se livrer en Son Fils unique, Il Se livre à cet homme en lui faisant grâce de Son Nom. « La révélation, écrit Boutang, est institution d’un secret ; il « devient » impossible d’attribuer pleinement l’être à ce qui n’est pas Dieu ; jusqu’alors il n’y avait pas réellement de sacrilège ni idolâtrie, tout ce qui est sous le ciel, et le ciel, se pouvaient prétendre – ou « même pas » se prétendre – être par essence, innocence impérieuse du devenir ; maintenant l’interdiction est prononcée, sans que le positif pour chaque étant, la réponse à la question naïve « qui es-tu ? » soit abolie, au contraire : chaque étant est désormais en mesure de répondre, non plus le dérisoire « je suis moi », ou « ceci », mais « je suis ; et je ne suis pas celui qui est » ; je suis finitude, et finitude fondée en l’être qui est par essence » (ibid.).
Boutang jusqu’au bout

Ainsi se résolvent, au dénouement de cette odyssée ontologique, les naïves interrogations de l’enfant et du monde alentour ; dans la secrète révélation d’une présence des choses, pleine et entière, qui se dit dans l’absolu comme cette absence même qui la creuse en son intimité, cette absence de l’Être même subsistant qui porte en lui ce paradoxe d’être tout à la fois le seul qui est, et d’être par-là même celui avec qui, par lui, et en lui, toutes choses sont. Que dire, alors et en fin, sinon que l’Ontologie du secret est ce sinueux sentier que l’intelligence d’un homme suivit au long du vingtième siècle, avec pour acolytes Parménide, Platon, Heidegger et surtout saint Thomas d’Aquin, afin de remonter aux sources sombres de l’existence et de la pensée, jusques à ce lieu qui est une terra sancta, où Moïse lui-même, prince des prophètes, dût retirer ses souliers pour n’approcher pas même de l’Incandescence essentielle ?
Au-delà, Boutang semble s’en remettre au maître Dominicain, et laisse à d’autres le soin de méditer le mystère de l’Ipsum esse subsistens ; car il n’ira jamais plus loin, et son « dénouement » n’en est pas un qui advient bien plutôt aux lisières du Lieu Saint qu’en ses profondeurs. Et les ultimes lignes du livre sont alors laissées à Mme de La Fayette, qui écrivait : « c’est assez que d’être ». Ah ! la philosophie française est donc bien encore avec Boutang cette terre de l’esprit en quoi la France toujours finit par rattraper la philosophie pour l’asseoir dans le vaste salon où l’authentique et rigoureuse pensée, avant d’avoir conclu, se dissout en conversations apéritives, – car pour les nombreux convives de ce festin sans fin, il se vaut mieux vautrer que penser extrêmement. Le destin de l’esprit occidental semble être, vespéral, de s’endormir en ses courtes vues : comme l’on fait son livre, l’on se couche… Nonobstant, il convient de ne juger point trop sévèrement Boutang, car s’il se coucha bel et bien, ce fut devant ce Dieu dont, trop pascalien peut-être, il crut profaner le mystère en allant, par la philosophie, outre la lettre même de Sa Révélation à Moïse.
- Ontologie du secret, Pierre Boutang, Paris, PUF, 1973 ; réédition en 2009 avec une préface de Jean-François Mattéi, PUF, collection « Quadrige ».