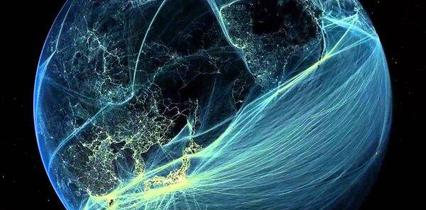Zone Critique a pu assister à la dernière création de la compagnie rouennaise Chiendent, présentée au Centquatre dans la cadre du Festival Impatience. Inconsolable(s), Un jeu dangereux est une dissection à vif du couple, une séparation en direct, où l’intime devient universel et le trivial, sublime.
« Je cherche quelqu’un. J’ai cru que c’était toi. »
Nadège et Julien sont tout nus. Comme la vérité, toute la vérité. Et ils viennent nous parler d’eux, d’eux tout seuls, d’eux ensemble. D’eux séparément. Inconsolable(s), Un jeu dangereux est la mise en scène et la représentation d’un couple qui (se) rompt face public, dix ans de vie commune coupée au couteau en une heure et vingt minutes.
Il y a ici, et ce pendant toute la durée de la pièce, tous les supports qui font souvent office de passages obligés dans les mises en scène contemporaines et le théâtre émergent : voix susurrées ou murmurées au micro, lumières stroboscopiques, changements de décors et de costumes à vue, scénographie quasi nue mise en place tout au long du spectacle par les acteurs eux-mêmes, corps nus, texte d’inspiration autobiographique dans laquelle les personnages s’appellent comme les acteurs, partie publique utilisée comme extension de plateau, interpellation directe des spectateurs par les acteurs, musique électronique qui fait boum boum. Et pourtant tout marche. Pourquoi ? Pourquoi ce qui a généralement tendance à m’irriter parce c’est « trop facile », « déjà-vu », « comme tout le monde », « gratuit », ou tout simplement parce que cela vient trop chercher la crise d’épilepsie de la spectatrice bon public que je suis, pourquoi, là, ai-je été touchée ?
Nadège résume la quête de l’amour, l’amour de l’amour, la mort de l’amour.
Parce qu’au-delà de la dimension spectaculaire (il y a des gélatines bleues et rouges sur les projecteurs, des chansons chantées à l’auto-tune, un décor qui se détruit, de l’eau, du plastique qui fond, de l’huile noire qui envahit le fond de scène), il y a deux êtres qui nous parlent. Qui me parlent. Ils me racontent leur histoire et pourtant, parfois, souvent, il y a comme des flashs dans le texte qui me sortent de ma condition de spectatrice passive, enthousiaste certes mais passive tout de même, qui m’éveillent et me font dire : « C’est moi. » C’est moi qui ai pensé très fort, qui aurait pu dire : « Je cherche quelqu’un. J’ai cru que c’était toi. Je me suis trompée. » Sur un rythme ternaire hyper efficace, Nadège résume en un triptyque lumineux de simplicité la quête de l’amour, l’amour de l’amour, la mort de l’amour. Un chemin qu’il semble que nous ayons tous pris. Ils sont là tous les deux, en colère, amers, aigris parfois, tristes, épuisés, désireux, désirants, amoureux, suppliants, lointains, si proches, là, à nous raconter leur histoire qui nous semble la nôtre, à s’écharper entre eux, à se dire qu’ils s’aiment, qu’ils se haïssent, que c’est la fin, que ça va aller.

« Montre-moi ta crasse. »
Quand nous ne pouvons plus nous toucher, nous embrasser, pas même nous approcher, quand les salles de théâtre, de cinéma, de culture de manière générale sont closes, nous mettons naturellement la vie à distance. Et à bien plus d’un mètre cinquante. Qu’est-ce que cela fait de nous retrouver à nouveau ensemble dans l’obscurité d’une salle, et dans les personnages qui s’aiment et se déchirent au plateau ? J’avais oublié à quel point l’art est une échappatoire hautement nécessaire. Avec Inconsolable(s), avec Nadège, avec Julien, je me souviens : cela fait un bien fou de vivre, le moment d’un spectacle et à travers la représentation vivante des crises, des angoisses, des amours fracassantes, des folies dévastatrices, un bien fou de hurler, de pleurer, de cracher, d’ahaner. De montrer sa crasse enfin, comme l’exige Julien de Nadège dans le processus de séparation : montrons-nous animaux, bestiaux, au plus près de ce qui nous rend, de ce qui nous fait sauvages. Vidons-nous – au sens propre comme au sens figuré – pour mieux nous aimer. Nous aimer plus fort, plus juste, plus proche. La catharsis au temps du Covid-19 est on ne peut plus salvatrice.
J’avais oublié qu’il était bon de partager des flux.
J’avais oublié qu’il était bon de partager des flux. Alors oui, cela part un peu dans tous les sens, les acteurs gueulent, gesticulent, s’époumonent, brisent les décors, vomissent, postillonnent, donnent le sein, se baladent nus ou déguisés en ersatz de cosmonautes. Mais on reconnaît là la route amoureuse, désirante. Le Groupe Chiendent dessine une nouvelle carte du Tendre : avec ses crevasses et ses plaines extatiques, un pays sinueux où nos corps, nos voix, nos idéaux, nos rêves se transforment, se fécondent, s’affaissent, se meurent. Un chemin qui nous rappelle que nous sommes terriblement vivants.
- Inconsolable(s), Un jeu dangereux de Nadège Cathelineau et Julien Frégé / Le Groupe Chiendent. Site de la Compagnie : http://groupechiendent.fr/
- Sélectionné au sein du Festival Impatience. Site du Festival : https://www.104.fr/fiche-evenement/impatience-2020.html
- Les visages pâles de Farrokh Mahdavi : https://dastan.gallery/artists/49-farrokh-mahdavi/
- La Charité romaine de Jean-Jacques Bachelier : https://www.alimentarium.org/fr/system/files/styles/full_wide/private/ealimentarium/emag4_d1e_jean_jacques_bachelier_la_charite_romaine_800.png?itok=YZVLgo6
- Pietà de Gustave Moreau : https://eclecticlightdotcom.files.wordpress.com/2016/12/moreaupieta1867.jpeg