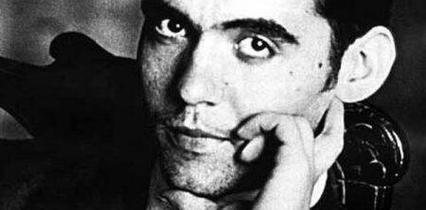Entièrement délocalisée en ligne, la 43ème édition du Cinéma du Réel, le festival international du documentaire, se tient du 12 au 21 mars. L’occasion pour Zone Critique de tenir un petit journal des compétitions françaises et internationales, et avec les films présentés, de prendre le pouls du monde et de ses habitants. Au programme du jour (ou plus exactement, de la veille) : la City au temps du confinement, les émeutes de 2005, un activisme poétique et un garage provençal.
- Courts métrages #1 : Cital de John Smith (2020, Royaume-Uni), Kindertotenlieder de Virgil Vernier (2021, France) et un souvenir d’archives de Christophe Bisson

Citadel ouvre ce premier programme de courts-métrages par un jeu de lumière poético-politique. Film de confinement tourné exclusivement depuis la fenêtre du réalisateur, donnant aussi bien sur son voisinage que sur la menaçante City d’émeraudes plus loin à l’horizon, la parole cajolante et bonimenteuse de Boris Johnson y vient rythmer le montage, tout en y creusant la perspective. Ces extraits de discours prononcés lors du printemps dernier, alors que le gouvernement britannique faisait le choix de préserver son économie au détriment de la vie de ses concitoyens, sont le socle narratif sur lequel s’appuie le dispositif expérimental de John Smith. Récit anthropomorphique où buildings et fenêtres rejouent une lutte des classes à l’ère néo-libérale et à la tonalité fantastique, qui figure la CBD londonienne telle qu’elle est, en ogresse insatiable dévoreuse d’innocents.
On continue avec Kindertotenlieder, dernière livraison du prolifique Virgil Vernier, qui cette fois se confronte à un matériau historique très contemporain, mythologique déjà avant même que le regard du cinéaste ne vienne le façonner. À l’automne 2005, deux gamins de Clichy meurent électrocutés en voulant fuir la police lancée à leur poursuite. L’embrasement sur plusieurs jours qui a suivi constitue le cadre du court, dans lequel Vernier se plonge dans les archives de TF1 pour en extraire tout ce que la chaîne a pu produire en images durant ces émeutes. Le montage y est brut et contemplatif, sans aucune voix-off ni accompagnement musical. Des morceaux de réalité nus, effarés et sidérants, qui ramènent l’événement médiatique à sa réalité concrète et primitive. En cela, le film figure un envers à la démarche formelle à laquelle Virgil Vernier nous a habitués, œuvrant à ramener le récit mythique à sa substance humaine, prosaïque, contextuelle. Une tragédie sans Moloch donc, sans forces mystiques surplombantes. Le réel n’en a pas usage, il compose avec ses propres démons : ici, un sombre et obscur Ministre de l’Intérieur.
Un souvenir d’archives, le film de Christophe Bisson qui conclut ce programme, est le plus long et aussi le moins convaincant du lot. Il pâtit du décalage trop grand qui existe entre l’ambition esthétique qu’il semble afficher et les moyens qu’il se donne pour la mettre en oeuvre. Assemblé avec des plans très serrés, à la frontière de l’illisible, sur des bouts de visages et des bribes de carnets manuscrits, le court est avant tout peu engageant visuellement. On me rétorquera que c’est tout à fait cohérent pour un projet qui travaille sur la mémoire de la tragédie humaine, son évanescence inévitable aussi bien que son inaltérable persévérance, principalement à travers les documents attestant de son existence. Et bien sûr, on aura raison. Cependant, on pourra aussi noter qu’il est plus que difficile de faire émerger une émotion esthétique marquante et durable de la cohérence seule.
Rediffusion du programme : aujourd’hui à 13h à cette adresse
- The Inheritance d’Ephraim Asili (2020, États-Unis)

Je n’ai pas de lieu. Je me pose enfin chez un ami. Je lance The Inheritance d’Ephraim Asili. Ça me frappe comme une évidence : Ephraim Asili est un Godard noir. L’affiche, par deux fois, de La Chinoise, viendra en confirmer l’intuition. D’abord : des références. Un tissu de renvois livresques constituant le faisceau d’une toile qui soutient tout l’inframonde mineur des afro-américains. Celui des black struggles. Une caisse d’armes inscrite du mot Armour est lentement vidée de ses Malcolm X, Muntu, Baldwin, Mingus (etc.) : l’arsenal tactique des densités noires. Puis suivent des comités de témoins récitant les textes phares des subalternes studies ou de la fierté noire sous de grandes citations à la craie. N’Krumah : « Practice without thought is blind ; though without practice is empty. » (Détournement d’un énoncé de Kant). Où suis-je ? Invité dans une fiction narrative représentant une communauté radicale de Philadelphie dans nos années 20 : murs colorés vifs, textes révolutionnaires. Esthétique 68. On s’organise pour une collocation. Mais l’organisation de l’espace social du présent est en même temps organisation de la mémoire. Du récit semi-fictif se dégage la référence cardinale : l’histoire réelle de la communauté anarcho-primitiviste noire de John Africa. L’archive surgit et entrecoupe les scénettes diégétiques en touches de reconstruction d’un passé puissant. Celui du MOVE de Philadelphie. En 1985, la communauté autonome, sobre, inspirée des principes de John Africa – non pas un mentor, un gourou, mais un homme aux principes effectifs (Christian movement for life), a été littéralement bombardée par le département de police de Philadelphie. Le feu a emporté avec lui des hommes, des enfants, et une soixantaine d’habitations alentour. L’histoire du MOVE est évoquée comme on évoque l’origine mystique des lois : les fondations philadelphiennes d’une autre vision du monde écrasée dans le sang. Mais alors que l’archive soulève la part obscure des densités noires ; le présent coloré de l’organisation, où jouent acteurs et témoins sous la caméra d’Ephraim Asili, s’exalte sous les lueurs joueuses de la poésie et de la politique étudiante. Le contraste entre la mémoire en noir et blanc du MOVE, sa sobriété primitive, et le présent du document éclatant de musiques, de lectures et de jeunesses est aussi, en lui-même, une radicalité. Et si je ne sais pas où je vais dormir demain soir, ce soir je dormirai en compagnie des cendres festives de deux générations. Je dormirai auprès des cendres du MOVE et de son Phoenix : les unes dispersant l’exigence trop suprême de pauvreté volontaire ; les autres coulées dans la peinture d’un monde qui se lève en couleur.
Rediffusion du film : aujourd’hui à 16h30 à cette adresse
- Garage, des moteurs et des hommes de Claire Simon (2021, France)

En posant sa caméra dans un petit garage d’un tout aussi petit village du Sud de la France, Claire Simon impose un double mouvement à son cinéma documentaire. Il y a d’abord, la voix-off nous le signale d’emblée, une forme de retour aux sources, puisque ce village est celui qui l’a vu grandir, même si les devantures et les visages d’autrefois se sont envolés. Il y a aussi un changement d’échelle, une réduction du champ d’exploration à une taille humaine : on est loin, par exemple, de l’immensité secrète du Bois dont les rêves sont faits (2016). Ici, il n’y a que Christophe, garagiste parfois soupe au lait, surtout avec les machines qui lui résistent, mais toujours sémillant et prompt à rendre service à ses nombreux clients. Il travaille en même temps qu’il le forme aux côtés de Romaric, son apprenti, qu’on sent un peu distrait par la présence régulière de sa petite-amie.
Pour eux, le garage est le lieu du labeur et de l’effort, et chaque nouvelle panne est un nouveau souci, et l’occasion de proférer ses plus beaux jurons. Il y avait là une belle matière, dans ce rapport des corps aux machines, de la chair au métal, dans cet artisanat humain et mécanique, son jargon, ses us et ses coutumes. Pourtant, la représentation du travail est rapidement évacuée, le documentaire préférant s’attarder sur la dimension sociale du garage, véritable agora moderne où les discussions, les rumeurs et même les embrouilles vont bon train. Car ce qui intéresse avant tout Claire Simon dans ce garage, c’est qu’il est simultanément un point de passage obligé (chacun ici se déplace en voiture), un des derniers reliquats de la vie communale et un univers quasiment exclusivement masculin, où les femmes existent en périphérie.
Est-ce une question de distance ou de regard, curieux mais jamais vraiment fasciné par son objet ? Est-ce un problème de confiance entre filmés et filmeuse, qu’on sent toujours tenue à l’écart, comme incapable d’établir un dialogue, d’amorcer le début d’un récit ? Reste que le programme de Garage, des moteurs et des hommes restera théorique, achoppant sur un réel qui lui résiste et qu’il n’a pas su révéler – quitte à y trouver autre chose que ce qu’il était venu chercher, et à se laisser surprendre et décevoir par le mystère qui se cache au cœur des êtres et des machines.
Rediffusion du film : aujourd’hui à 20h à cette adresse