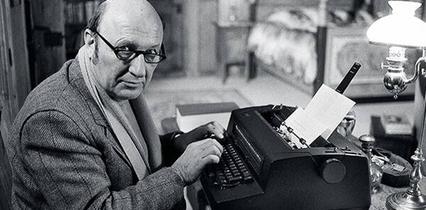« Si quelqu’un parvenait à une brève description des fleurs d’amandier, la brume se rétracterait des collines et un peuple dirait à l’unisson : Les voici, les paroles de notre hymne national ! » : on pourrait faire de ces mots du grand poète palestinien Mahmoud Darwich un prélude au premier roman de son jeune compatriote Karim Kattan. Comment décrire ces amandiers en fleurs qui portent sur leurs branches un rêve de pays ? Que révèle la brume qui enveloppe les collines sur la mémoire d’un peuple aux mille blessures ? Dans un roman aux frontières du réel et du songe, Kattan restitue une Palestine à la fois gracieuse et endolorie, portée par la voix d’un jeune exilé qui revient chercher des réponses dans un univers spectral et délabré. Entre les ruines, s’élève une mélodie palestinienne dont les notes troublantes murmurent aussi bien l’amour de la terre que les éclats de ses défaites et de ses non-dits.
Écrire dans l’intervalle
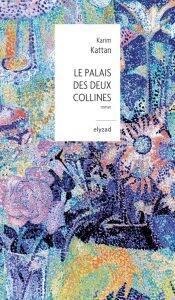
Indocile et lumineux, le récit de Kattan refuse les réponses univoques. Écrire la Palestine c’est d’abord suivre cette ligne de crête entre l’avalanche des événements subis et les fragments de récits étouffés, entre le feu de la réalité, crépitant dans le lit des défaites et des échecs successifs, et la mélodie de l’imaginaire, autre manière de raconter un pays, une terre, un peuple. Dès la première page, la fiction vient naturellement hanter le texte : « tout a disparu », constate Faysal, « il ne s’est rien passé pourtant, rien, et je n’ai rien fait, et ce que j’ai fait, je l’ai imaginé ». Le Palais des deux collines serait-il le roman d’un pays rêvé, le livre d’une quête solitaire à la frontière du réel et de l’imaginaire ?
Des spectres et des épaves
Écrire la Palestine c’est d’abord suivre cette ligne de crête entre l’avalanche des événements subis et les fragments de récits étouffés
Derrière les portes du palais, la solitude de Faysal n’a d’égal que les ruines d’une généalogie obscure et fascinante. Le grand-père Ibrahim, patriarche mort dans les années 1980, est le symbole d’une « grandeur » insondable. L’oncle Ayoub, fils d’Ibrahim, a probablement bâti sa fortune « à coups de combines mafieuses » aux quatre coins du globe. Joséphine, amante d’Ayoub, est à la fois « une sorcière » et une deuxième mère, « un être hybride » qui habite une maison en fleurs. La grand-mère Nawal, femme d’Ibrahim et gardienne du palais, est tantôt « une créature maléfique, une ogresse » tantôt « ce pauvre fantôme neurasthénique et terrorisé » qui hante les lieux. Les personnages de Kattan sont des êtres incertains, des tranches de vie nébuleuses qui ne cessent de s’éclipser et de rejaillir sur la page. La culmination de cet univers vacillant est cette Tante Rita dont le décès est à l’origine du retour de Faysal et qui n’est peut-être qu’« une ombre parmi les ombres », un énième spectre dans la trame complexe du récit.
On en vient à se demander : qui est Faysal, au juste ? Le simple « rejeton des hommes d’affaires et des grandes bourgeoises » d’une Palestine révolue ou le spectre d’un scribe qui dévoile et consigne des blessures longtemps refoulées ? Dans le palais, Nawal s’emploie à le retenir, l’incitant à sauver l’âme des lieux, à défendre la mémoire des siens contre l’ombre de plus en plus menaçante des colons israéliens. Or, le palais est à l’image du pays, « un abri suspendu aux rochers et au bord du précipice ». La chute paraît inéluctable, la défaite presque écrite d’avance. Comme pour retarder la catastrophe, l’enfance de Faysal remonte par bribes à la surface : ici l’écho de ces fêtes fastueuses où « les assiettes sont d’une blancheur irréelle », là la violence brutale d’une punition ou le vague souvenir d’un Noël « dans un pays vide » et ce goût égaré de « la barbe à papa à Bethléem ». Face aux dédales de la mémoire, le palais se fait musée intime : une fresque de la Palestine, des figurines de Dresde, une boîte en bois ornée de formes animales, un vase envoûtant et d’autres objets encore, « des épaves du temps » échouées sur cet « atlas compliqué, illisible » que tissent les désirs et les désillusions de personnages en mal de pays.
Un « chagrin d’amour » nommé Palestine
Mais de quel pays s’agit-il ? Celui dont l’existence est reportée, réduite à une mémoire en fragments, ou celui dont le territoire se rétrécit chaque jour sous le regard impassible du monde ? Réponse mélodieuse de Nawal : « Mon pays est flamme mon pays est océan mon pays est un cantique qui parcourt les collines, un murmure qui disparaît, se perd dans le vacarme ». Mais pour Faysal, la Palestine de Nawal est plutôt « un désolant théâtre de marionnettes, des ombres projetées sur un mur, dont elle est l’unique spectatrice ». Loin de tout paradoxe, les deux images cohabitent dans un texte oscillant sans cesse entre la description réaliste et la reconstruction poétique. Kattan réussit la prouesse de dire une Palestine à la fois gracieuse et affligée, meurtrie dans sa chair mais renaissant sans cesse sur la page. Comme souvent dans la littérature palestinienne, cette régénération s’appuie notamment sur la fusion des corps et de la terre : les clavicules d’Ayoub « sont comme des vallées. Des précipices ». Le sujet palestinien n’existe que dans la topographie intériorisée de sa terre natale.
On comprend dès lors la prééminence de l’élément naturel dans le roman de Kattan. Pour dire son amour à Joséphine, Ayoub lui murmure « les noms de toutes les fleurs, de tous les fruits, de chaque plante des deux collines ». La nature imprègne l’écriture et façonne les personnages. Le parallèle avec le monde animal est particulièrement révélateur : Ayoub a « une bestialité dans le visage », Tante Jeannette ressemble à « un raton laveur », Tante Rita est « comme un lézard qu’on aurait découvert dans un pays lointain » et Faysal lui-même se compare à un autre « lézard échoué sur une île perdue de l’univers ». Le bestiaire de Kattan enracine le texte dans un environnement salutaire qui ranime, par-delà la métaphore, le sens d’une vie et d’une résistance en partage : « Nous nous ferons cafards s’il le faut, innombrables et impossibles à tuer ». Et si la seule renaissance possible était celle du vivant, organique et imperturbable ? Rien de plus sûr car les liens avec la terre sont loin d’être paisibles. Jihad, qui tient un restaurant sur l’une des deux collines, éprouve « un profond mépris pour la pierre et pour les oliviers ». À un moment donné, Faysal reproche même à la terre son « inconstance » et sa « laideur ». La Palestine est ce « chagrin d’amour » niché dans l’intervalle entre le pays « improvisé et idéal » et le pays tel qu’il est ou pourrait être. Au cœur de cet intervalle, il y a la question lancinante de l’héritage et de la transmission.
Pour Nawal, la terre perdue en 1948 « était d’une tendresse que [Faysal] ne comprendr[a] pas ». Pourquoi donc s’obstiner à méditer le présent et fouiller les arcanes du passé ? Que cherche Faysal au juste sinon constater pour la énième fois l’ampleur des dégâts ? Face à une affiche annonçant la construction d’un musée à Haïfa dédié à la culture palestinienne, on a un début de réponse : « S’ils nous mémorialisent, c’est qu’ils ont gagné ; c’est que, par ce travail de mémoire prospectif, ils présidaient déjà à notre anéantissement […] ils nous ont posés derrière des vitres avec des robes brodées et un pressoir à olives. Ils ont réussi leur tour de magie : nous sommes vraiment devenus des êtres de fiction ». Kattan écrit contre l’accaparement de la mémoire palestinienne, contre les clichés et les raccourcis en vogue, contre les manœuvres politiques et les tentatives d’étouffer, de maquiller, voire de détourner, le visage d’une nation. Parallèlement, le texte met en lumière cette impuissance qui taraude le sujet palestinien, hanté depuis toujours par l’effacement de son identité : « Je savais être né pour constater l’extinction de ma race ». Le processus est d’une cruauté sans nom et Faysal en arrive parfois à accepter son sort et dériver aux limites de l’existence : « Je désire ardemment la disparition. Être une table rase ». L’une des forces du roman est sa capacité à dire ce malaise profond, à en retracer, d’une manière résolument complexe, les origines et les ramifications.
Généalogie de la défaite
Dans le double miroir de la société et de l’histoire, Kattan mène un travail d’autocritique sans complaisance
Dans le double miroir de la société et de l’histoire, Kattan mène un travail d’autocritique sans complaisance. Ici, on croise des bourgeois palestiniens aigris ou nostalgiques, attachés à leur confort ou retranchés dans un silence rarement interrompu, sinon par « l’occasionnelle blague idiote, la rare analyse politique débile ». Au détour des pages, une révolutionnaire s’improvise « Madame la patronne des arts » et des aïeules sans scrupules « se lavent les mains des crimes de leurs époux ». Avec une rage à peine contenue, Faysal s’insurge contre « ce même sang médiocre » qui irrigue son arbre généalogique, charriant cette défaite colportée d’une génération à une autre : « Toute notre histoire, au fond, était celle de leur nullité. Tous ceux qui m’ont précédé étaient incorrigiblement nuls et m’ont laissé en héritage cette maison (palais, mon cul) et leur nullité. Ils ont tout perdu, tout, leurs guerres, leurs combats, leurs maisons et jusqu’à leur courage. Pour ma part, je me suis rendu à ma nullité ». À y voir de près, les personnages de Kattan accumulent les tares : Tante Jeannette prône la lutte armée depuis « les canapés dorés de son papa » ; Jihad, dont le prénom suggère la résistance et l’abnégation, est plus proche du domaine du rêve que de celui de l’action. Kattan montre que l’embourgeoisement d’une certaine frange de la société palestinienne a engendré une perte de repères, une déstabilisation des assises éthiques et des valeurs partagées, un glissement tragique vers le domaine des apparences figées dans le cortège des portraits et des albums photos.
Aiguisant ses mots, Kattan n’épargne ni le pouvoir politique, « une bande de bons à rien, des administrateurs sans aucune compétence, qui vendraient la maison au plus offrant » ni les instances religieuses, à l’image de ce prêtre « léonin et féroce », qui « aime le confort et les caresses, l’or et la soie ». Le roman ne dit rien d’autre que l’échec des doctrines et la chute des institutions : le clergé, le nationalisme, la résistance, l’ascension sociale. « Toute notre histoire était une concaténation de catastrophes » : le constat est amer mais d’une lucidité désarmante.
Sur ce tableau des défaites plane la menace de la colonisation imminente du palais et du village. Ici, plutôt que de ressasser les discours convenus et les slogans éculés, Kattan choisit la démystification : « On n’imagine pas la rapidité de l’homme à créer une colonie. C’est facile, il suffit de construire sur le même modèle une centaine de maisons toutes pareilles et toutes moches ». Face aux Forces Armées de Judée-Samarie qui avancent au rythme des raids et des expropriations, la Cisjordanie, « ce bout de terre qui n’a même pas le nom d’un pays », se trouve réduite à « un terrain de jeu ». Reste-t-il, dans ce contexte, une place pour la paix ? Oui, répond Nawal, « c’est la paix que nous voulons mais pas cette paix inique qu’ils nous imposent. Pas cette paix à genoux ». Pour garder une fenêtre entrouverte sur le devenir de la Palestine, Kattan sait qu’il faut écrire avec vigilance et dignité, faire de la mémoire le creuset où se forge une vision sans concessions de soi et de la patrie.
De l’éternité de l’instant à la forme des jours
Par conséquent, on peut certainement aborder le roman de Kattan à travers le lien ténu qu’il noue avec habileté entre le temps et l’écriture. À de nombreuses reprises, le passé revient s’immiscer dans le présent, les souvenirs se juxtaposent, la transition d’une temporalité à une autre réactualise d’anciennes blessures : « Auparavant, les matins dans cette maison étaient peuplés de mondes chatoyants, de promesses dépliées devant moi dans toute leur consistance. L’avenir, dans mon enfance, avait la teneur particulière de la fiction à laquelle on croit – on aurait pu mordre dedans ». La Palestine est cette terre qui voit défiler les générations tout en restant figée, immuable, comme si « le flux s’était arrêté, les fleuves immobilisés, les fleurs stupéfiées, l’air lui-même figé en un instant éternel ». C’est vers cette éternité de l’instant que tend l’écriture de Kattan, glissant souvent à la limite du flottement, comme pour dire à la fois son ancrage et sa fragilité.
D’une page à l’autre, l’écriture efface, revient sur ses pas, rectifie, sème le doute, tourne sur elle-même. À défaut d’entrevoir la paix pour soi et les siens, Faysal s’acharne à écrire pour « imposer une forme aux jours ». Souvent, le roman prend des allures de journal. Il s’agit non seulement d’ausculter le présent à la lumière du passé mais aussi de dissiper, par le rituel de l’écriture journalière, la somme des incompréhensions et des confusions : « Ma hantise », rectifie Faysal, « ce n’est pas l’anéantissement mais le malentendu ». Le roman de Kattan est ce journal d’un retour à la terre natale qui met en scène le besoin d’un destinataire alerte pour partager les blessures, d’une oreille attentive pour démêler les voix du passé, d’une main délicate pour ramasser et réorganiser les débris du récit. Par un effet troublant, le texte n’en finit pas de se remodeler sous l’œil du lecteur, libérant l’âme vacillante d’une Palestine vécue et réinventée au jour le jour.
Par-delà les murmures
Derrière les spectres qui traversent le roman, il y a ainsi comme une mélodie qui s’obstine à ressasser la beauté au cœur du chaos
Sans surprise, l’instant vers lequel tend l’écriture de Kattan se heurte au destin du pays, condensé dans cette expression paysanne qui veut dire « jamais » et pointe vers une temporalité condamnée : « demain les abricots qu’on va libérer la Palestine ». Est-ce à dire que l’échec est inscrit à même la langue ? « Oui, sans doute que les fleurs d’amandier sont difficiles à décrire », reconnaît Faysal en écho au poème de Darwich, rajoutant ailleurs qu’« il n’y a pas assez de métaphores, pas assez d’analogies » pour décrire Jérusalem. Dans le roman, ce questionnement de la langue se traduit par la récurrence des « wiswis », des gémissements qui disent autant la déstructuration du matériau linguistique que la permanence des menaces qui pèsent sur l’histoire et l’imaginaire palestiniens. Leitmotiv du récit, ces �« murmures démoniaques » qui « chantent la mort » à l’oreille de Faysal génèrent une tension irréductible au cœur du récit. Pour la contrecarrer, Faysal rappelle que « les gens de [son] pays ont le parler maritime. Dans leurs syllabes, il y a le fracas des vagues et dans leur rire l’écume ». Les « wiswis » ont beau nourrir la peur et relancer la souffrance, ils sont « comme un murmure marin » rattrapé par les racines du pays. Derrière les spectres qui traversent le roman, il y a ainsi comme une mélodie qui s’obstine à ressasser la beauté au cœur du chaos, à dénicher une douceur insoupçonnée dans ce mélange vertigineux de nostalgie et de colère, d’aigreur et d’enchantement.
À un moment du récit, Nawal reproche à Faysal d’être porté sur « l’introspection oisive de l’individualiste ». Comment peut-il en être autrement ? Comme sa terre natale, Faysal a besoin de ce travail d’introspection oscillant entre la quête radicale de soi et la libre déambulation de l’écrit, entre un réalisme exigeant et intransigeant, et un autre léger, éthéré, presque magique. D’une page à l’autre, on assiste au miracle de cette oscillation guidée par une lumière omniprésente, marquant la naissance du romancier et irradiant le texte de visions oniriques, à l’image de cette évocation de Bethléem, « logée dans les vallées » comme « un éclat tamisé, un tronçon de carotte glacée posé sur le monde ». Il y a là la musicalité d’une écriture prodigieuse, résolument tournée vers la clarté du jour qui vient. « Je vis dans l’avenir », dit Nawal, « quand nos mondes seront réparés, quand le pays sera rendu à la pureté d’un matin qui palpite ». Et si le matin de cette Palestine à venir valait toutes les descriptions possibles des fleurs d’amandier ?
Bibliographie :
Kattan, Karim Le Palais des deux collines , Elyzad, 2021.