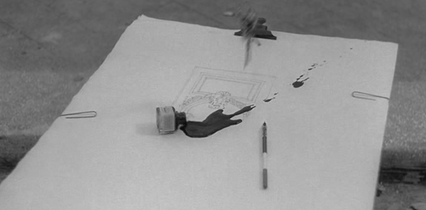« Prenez garde , on ne sait pas jusqu’où l’âme s’étend autour des hommes » dit un vieillard dans Intérieur, la pièce de théâtre de Maurice Maeterlinck. Et si la photographie était le médium susceptible de la surprendre ? Langage fait d’ombres et de lumière, l’appareil photo fige les silences, et va au-delà des mots. Dans l’intime, il dessine la profondeur des corps qui s’abandonnent, la vérité des regards qui s’aiment, leurs incidences sur les objets qui les entourent.
La MEP présente plusieurs séries de photographies autour de l’intime dans lesquelles les amoureux sont leur propre paysage. Love Songs, ce sont ces clichés qui montrent les extases et les tragédies du quotidien, celles-là mêmes qui nous embrasent ou nous engloutissent, celles qu’inéluctablement nous traversons, et que nous devinons chez les autres. De la fièvre à la tendresse, de l’ennui à la violence des relations d’amour, la MEP expose du 30 mars au 21 août 2022 des instants qui nouent la gorge, qui chuchotent au creux du ventre.
Eurydice et Orphée
Eurydice s’appelle Edith, Thierry, Yoko ou Larry. D’abord, on ne connaît rien d’eux. Mais on les devine par leurs gestes alanguis, leurs respirations heurtées. À travers leurs portraits, on croit sentir la chaleur de leur cou, la douceur de leur peau. On les découvre avec les sens. Les Orphée disent l’amour qui les consume en le cristallisant dans des photographies. Les aimés y répondent : ils ont levé leurs prunelles enfiévrées vers l’appareil, ils offrent la pesanteur de leur corps nu. Eux, ne peuvent nous voir. Ils ne savent pas, alors, que d’autres les regardent : on partage un peu de leurs frissons. Et, dans ce dialogue complexe, se sont fichés des fragments d’âme et des morceaux du temps.C’est précisément ce qui nous tient pendant toute l’exposition.
La nudité livrée sous les yeux du photographe n’est ni gênante, ni vulgaire. Au contraire, dans ce contexte, elle est une preuve d’amour. Le fiancé, décliné plusieurs fois devant l’objectif d’Hervé Guibert, est un des clichés qui marque. L’amoureux, Thierry, couvert d’un voile presque transparent se tient là, debout. Il est nu. La posture n’a rien d’inédit. Mais, sous le tissu léger perce son regard vif, de ces regards qui brûlent. Dans le silence qui n’est pas mutisme et dans l’immobilité apparente, il fait paraître le bouillonnement de son âme. Ils s’aiment. La nudité sublime plus encore la scène : elle est un aveu d’authenticité.

Dans l’intimité, l’appareil photo fige la fragilité des hommes. Il la sublime. C’est pourquoi, la photographe Sally Mann altère un peu la peau de son époux, Larry, dans la série Proud Flesh. En effet, elle utilise une technique d’impression différente qui crée des cicatrices, des reliefs, des formes nébuleuses sur le corps de son mari. L’artiste encense la beauté du torse, des mains, du dos de celui qu’elle aime parce qu’elle le sait vulnérable : il souffre d’une maladie qui le paralyse doucement. Dans le cliché Hephaestus réalisé en 2008, un sillon aux larges volutes entaille le buste de Larry ; mieux, il le morcelle, il marque la frontière entre la lumière et l’obscurité qui habillent son corps nu. Cette impression abîme et magnifie l’aimé. Sally Mann donne à voir dans cet arrangement un au-delà : la photographie est visiblement corrompue, non pas le corps. L’époux, en contraste, se donne plus fort. Hephaestus illustre une vitalité qui dépasse la chair, c’est l’image de l’ardeur des émotions.

L’amour photographié se vit aussi dans le temps qui passe. La fulgurance des présents s’immobilise sur l’image. Emmet Gowin consacre la beauté d’Edith dans l’accumulation des instants de vie à deux, de 1967 à 2012. La femme aimée pose nue ou presque, debout, la tête toujours légèrement inclinée. Il capture ainsi la transformation de son corps mis à l’épreuve du temps et la permanence d’un regard qui, invariablement, dit “je t’aime”. Chacun de ces clichés expose la douceur, la tendresse des sentiments de l’artiste. Le corps d’Edith qui évolue est enveloppé à tous les âges d’une lumière douce, chaleureuse qui déclare à son tour “je t’aime”. Ce dialogue amoureux fait fi du vieillissement, c’est une transe qui absorbe la temporalité.
L’omniprésence et les vides
Le photographe qui suspend dans son œuvre l’amour, le désir, la tendresse présente nécessairement un pan de sa propre vie. Il ouvre une brèche dans un monde clos : celui que le “je” partage intimement avec un “tu”. C’est ainsi que Nobuyoshi Araki conçoit ses impressions : il les présente comme un roman autobiographique. Les séries Sentimental journey (1971), et Winter journey (1989-1990) s’entrechoquent : la première déploie les instants heureux, le mariage avec Yoko et la lune de miel à Kyoto, tandis que la seconde présente la mort de son épouse et l’absence terrible. L’artiste met de fait, en écho l’omniprésence de l’amour et le vide de la disparition. Deux temps, deux états d’âme se heurtent et donnent à voir les deux facettes de l’amour : la béatitude et la souffrance.

La solitude est cristallisée par plusieurs prises de vue d’une terrasse immuable à l’épreuve du soleil ou de la neige. Un chat discret, funambule, s’y promène. La vie disparaît abruptement de l’œil du photographe. Et le silence recouvre tout : la dernière photographie présente le cercueil dans lequel repose l’aimée. Une même douceur, une même lumière passe sur son visage. Elle est belle. Il montre l’indicible.

Parfois la présence et l’absence se lisent dans les objets qui entourent le couple. Ainsi, Alix Cléo Roubaud scelle l’amour qu’elle partage avec Jacques en photographiant les draps défaits, froids et froissés qui ont vu naître et mourir leurs étreintes. Les objets complices sont érigés comme des symboles. Et, la photographie elle-même, pensée comme un objet, permet de faire un lien entre ce qui a été et ce qui est pour réduire un peu l’espace qui sépare de l’être aimé. Elle est un petit bout de l’âme qui se partage. Les photographes RongRong et Inri vivent leur relation à distance : il est chinois, elle est japonaise. Privés d’eux-mêmes, loin l’un de l’autre, ils communiquent à travers leurs clichés glosés de mots d’amour qui ornent et font briller plus encore leurs portraits. C’est la série Personal letters (2000).
Ce cliché multiplie les images d’Inri. C’est une quête de l’omniprésence. Cette quête s’illustre aussi à travers le reflet : les photographes abondent du visage, de la silhouette, du corps de l’être aimé. Comme en pensée, quand on aime, on voit l’autre partout. La grimace de Thierry que fige Hervé Guibert se lit trois fois, en face du photographe, mais aussi dans le miroir et dans la fenêtre. Rita qu’aime René Groebli dont il fait le portrait dans sa série L’oeil de l’amour en 1952, est partout aussi. Elle étend son linge à la fenêtre, à demi-nue, et se dédouble dans le miroir. Elle est aussi présente à travers le Cupidon qui orne les rideaux.
La flamme : amour et violence
La MEP, dans cette exposition, illustre plusieurs facettes de l’amour, plusieurs chansons, de la plus douce et inoffensive à la plus virulente. La violence sourde d’un amour qui disparaît est bientôt remplacée par une complainte plus débordante et difficile à masquer qui plombe le cœur et marque la peau. The ballad of sexual de Nan Goldin développe l’amour à travers la dépendance et fait une analogie avec la drogue. Accro à l’héroïne et à la cocaïne, l’artiste débrouille avec ses clichés les images floues qu’elle a d’elle-même et de ceux qui l’entourent. Une lumière vive, saturée recouvre chacun de ses clichés, éclabousse les corps comme pour montrer crues les intempérances qu’elle peine à voir à l’œil nu. Brian, son amant, se tient à côté d’elle, si proche, si loin aussi. Ils partagent le même lit, mais après l’amour, les corps disent leur désunion. Il lui tourne le dos, son regard s’enfuit ailleurs, tandis que Nan allongée, près de lui concrétise leur distance dans un regard de biais, lourd et froid. Ils montrent leur solide simultanément, l’échec d’une relation qui s’étouffera dans les coups.

*
Love songs offre un cheminement dans lequel chacun s’identifie. Les différentes couleurs de l’amour sont représentées dans les démarches et les expériences bigarrées des artistes. On accède de salle en salle, de série en série, à cet éternel tumulte amoureux vivifiant et destructeur. Cette irruption dans le dissimulé, dans l’intime fait écho à notre intérieur. Elle l’interroge, l’enthousiasme ou le bride.